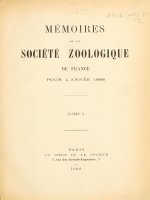Annales de la Société Entomologique de France V21-1843
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (20.84 MB, 467 trang )
Cj
V
NNALE
s
DE LA SOCIETE
ENTOMOLOGIQUE
DE FRANCE.
îVatuia inaximè niirancla in minimig.
Deuxième
série.
TOME PREMIER.
PARIS,
CHEZ LE TRÉSORIER DE LA SOCIÉTÉ,
RUE DAUPHINE,
1843
35.
A1NJV4LES
,4
^'
SOCI L
r
li
l'INTO VIOLOG \QU\i
DE FRANCE.
NOTE
SUR QUELQUES j4Uîca CONFONDUES SOUS LE
NOM
d'AUica oleracea.
Par
iM. le
doclcur Ch.
ADBÉ.
(Séance du 18 Janvier 1843.)
Sans partager entièrement l'opinion des entomologistes,
qui veulent voir fonder la base de
la
méthode sur
naissance des larves, je suis convaincu que
la
la
con-
connaissance
des insectes sous leurs premiers états peut aider considéra
blement dans
la
réunion ou séparation de
telles
ou
toiles
espèces; non seulement l'entomologiste doit s'attacher à
cette étude, mais
il
ne doit pas négliger
d'existence des insectes et
le rôle qu'ils
les conditions
ont à remplir dans
ANNALES
6
le
grand cercle des êtres organisés. La science toute entière
dans ces connaissances réunies.
est
Voici un exemple des avantages obtenus de l'élude des
conditions d'existence
ma
collection
gistes
:
j'avais depuis
longtemps
quatre espèces à^Altica que
les
isolé
dans
entomolo-
modernes ont réunies comme des variétés de VAUica
oleracea, j'avais la conscience
que toutes ces prétendues
variétés étaient autant d'espèces distinctes. La différence
observée dans
la
taille, la
couleur
et la
ponctuation
vaient décidé à les séparer. Mais aujourd'hui que
même
de
faire
,
m'a-
j'ai
été à
quelques observations sur leur manière de
vivre, je n'ai plus
aucun doute sur
la
nécessité de les sé-
parer.
La première, qui constitue
mune aux
environs de Paris,
cifères et surtout sur le
la
véritable oleracea, très-com-
vit
principalement sur les Cru
Synapis arvensis
,
si
répandu dans
nos champs cultivés. La seconde, qui doit être rapportée à
Verucœ de Fabricius,
elle
dévore
thrum
Chêne, dont
La troisième se trouve dans
aux dépens de la Salicaire, Ly-
les feuilles tendres.
humides, où
les prés
est très-abondante sur le
elle vit
salicaria, et enfin la
quatrième que
j'ai
prise en Savoie
smV Hippophae rhamnoides.TCd. jamais, que je sache, été prise
ailleurs
quel
que sur cet arbuste. M. Chevrier, de Genève, au-
j'ai
communiqué mes
des recherches dont
observations, a bien voulu faire
le résultat est
venu confirmer ce que
je
viens d'avancer.
Je possède encore deux ^/
je
ne puis rien décider sur leur compte, tant que
séderai pas
les
mômes
une
je
ne pos-
série d'individus identiques pris tous
dans
conditions d'existence. Aussi ne saurais-je trop
recommander aux entomologistes de noter avec
soin,
pour
DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE.
les insectes
ils
phytophages,
auront trouvées
les
;
le
nom
c'est, si
7
des plantes sur lesquelles
non
le
moyen unique de
re-
du moins un excellent auxiliaire.
Cette étude peut avoir aussi d'immenses résultats pour l'agriculture, car en effet, si r^/ftca que M.Feisth;im«^l(l)nous
lever quelques erreurs,
a assuré causer heaucoup de dommages à
quelques contrées de l'Espagne, et
doute cependant à
la
vigne dans
qu'il a rapportée
ne pourrait-on pas par une culture raisonnée de
tarde ou de
la
avec
l'o/eracea, était réellement cette dernière,
navette dans
le
la
mou-
voisinage des vignes, attirer
cet insecte qui, dans notre pays, parait affeciionner particu-
lièrement les Crucifères?
On
m'objectera peut-être, au sujet de
la
séparation de ces
prétendues variétés de VJltica oleracea, que je pousse un peu
loin la division spécifique, et
rente,
la
surtout
que
la taille
légèrement diffé-
densité plus ou moins grande de la ponctuation et
le
bleu en remplacement
du
ne peuvent servir
vert,
à constituer des espèces différentes; ce à quoi je répondrai
que nous ne sommes pas les maîtres de
limiter le
espèces et que notre rôle se borne entièrement à
nombre des
les constater.
y a quelques années, avant que nous n'ayons poussé
moyens d'investigation la plupart des Stenus
Il
aussi loin nos
,
noirs qui ont été
si
bien étudiés par
M
Erichson, passaient
tous pour des variétés d'une seule et
même
on
construction des der-
a
cherché des différences dans
par
là
et
;
depuis
on a été amené
à diviser toutes ces variétés en autant d'espèces dis-
tinctes.
Le
ture, offre
(i)
la
anneaux de l'abdomen des mâles,
niers
espèce
travail
que je présente
ici,
sans être de
cependant quelqu'analogie.
J'ai
même
cherché des
Observation verbale coniinuniquéeà une séance de
lors de la lecture
du mémoire de M. Walckonaër sur
fioisiblcs à la vigne.
la
nadif-
Société
les insecte»
.
ANNALES
8
férences partout où
il
m'a été possible d'en découvrir
me suis appuyé
le
mode
sur
pèces. Je ne saurais trop
constater les
faits,
mais
le
et je
d'existence de chacune des es-
le répéter,
champ
nous ne devons que
est vaste et sans bornes.
Altica oleracka.
Chrysomela oleracea. Lin. Syst. nat
2.
295. 51.
Oblongo-ovata, convexa, sparsim punctulata, nitida, virescens
antennis
;
tarsisque nigricantibus
,
thorace sulco
transverso impresso.
Long, de 3 à 4
Larg. de 2 à 2 1/2 mill.
mill.
Elle vit sur plusieurs espèces de plantes et principalement
sur les Crucifères qui croissent dans nos champs cultivés.
Altica lythri.
Oblongo-ovata
,
convexa
sparsim punctulata
,
nitidula,
,
cyanea; antennis longioribus tarsisque nigricantibus ; thorace sulco transverso leviter impresso.
Long, de 4
à 5 mill.
Larg. de 2 1/â à 3 mill.
beaucoup à V oleracea., mais elle en diffère
toujours un peu plus grande, les antennes un
Elle ressemble
par une
taille
peu plus longues,
brillante
,
la
couleur constamment bleue et moins
et le sillon transversal
du
corselet
un peu moins
profond
Elle vit dans les prés sur le
Lythrum
salicaria.
Altica hippophaes.
Oblongo-ovata, convexa punctis minutissimis, vix con,
spicuis impressa, ferè
opaca
,
cyanea vel cyaneo-virescens,-
DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE
-
antennis tarsisquc nigricantibm
9
ihorace siilco transverso
;
profundè impresso.
Lonj;. de
grande analogie avec
Elle a la plus
couleur et
5 miil. Larg. de 2 1/2 à 3
à
-i
la laille; elle
la
rnill.
précédente pour
la
est un peu moins convexe, mais ce
qui la distingue essenliellemant, c'est
la
ponctuation qui est
presque imperceptible; le sillon du
corselet est aussi plus profondément enfoncé, d'avantage
même que dans toutes ses congénères, elle est aussi presque
beaucoup plus
fine et
terne.
Elle se trouve sur V Hippophae rhamnoides
très-communément
l'on trouve
Alpes et
le
,
arbuste que
long des torrents dans les
Jura.
le
Alt ICA
ERUCTE.
Galleruca erucœ, Fab. Ent. syst.
Altica erucœ, Oliv. Ent. T. VI.
2. 28.
p.
705,
?
pi. 4,
f.
67. [l)
Oblongo-ovata, convexiuscula, punclulata , nitida, cyaneovirescens; antennis
tarsisque
niyricantibu^; thorace
stilco
transverso impresso; elytris plicâ unicâ ad I (itéra elevatia.
Long. 4 mill Larg. 2 1/2
Elle
ressemble beaucoup à Voleracea par
(1) J*i
insecte,
"
.le
n'ai
je n'ai pas
premier et
il
garde
même
seul peut-être, a parlé du petit
indiqué Fabricius qu'avec doute, car
le silence
niment trop courte
laquelle
il
forme
pu cependant négliger de mentionner Oli-
le
bien se faire (jue réellement ce ne soit pas
car
la laille, la
pas clierchéàcilcr tous les aulcuis(iui oui ccril siiiccl
i>i
mais
vier, qui, le
tre.
mil!.
:
sur ce
pli
là
l'espèce
(|u'il
pli
il
de
l'ély-
peut très-
a désignée,
et se contente de celle phrase inli-
snltuloria, ccemlea, nitida, iinlcnnis nigrà, par
peut tout aussi bien signaler
les lythri et
hippophaes.
ANNALES
10
et la couleur,
cependant
moins convexe
peu sur
c'est
un
le
et
elle est
bleu, mais ce qui
la
elle lire
un
distingue essentiellement,
petit pli qu'elle offre sur
en dehors
chaque élytre, tout à
fait
et en arrière.
Elle vit sur les jeunes pousses
ment commune au
de juin.
généralement plus grande,
moins franchement verdâtre;
bois do
du Chêne
Boulogne dans
,
et est
les
extrême-
premiers jours
J3E
LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE.
aX*^-\^VW'V\^VX'»\\^%A'> V'V%'W% %v*'\A\
V\.'»'V\^'XV^
W\'V\'*'W V\x V\'%
'^
1
V \\ "XA ^ 'W^ /VV>
1
'^
DESCRIPTION
de trois nouvelles espècf.s dr coléoptères de
l'océame.
\\u-
M.
LÉON FAIHMAIRE.
(Séance du 18 Janvier 1843
)
Chtœnius ophonoides, L. Faiiinaiie.
PL
I,
II".
ii,rig. 1.
Capite thoraceque viridi-ceneis; thorace pmictatissimo; elytris
viridibus,
cum
disco obscure metallico fulvis, striato-
punctatis, interstitiis punclatis
;
antennis. pnlpis pcdibuaque
pallidè testaceis.
Long. 14 milL Larg. 5 milL
Cet insecte a
la tête
d'un vert métallique assez brillant,
marquée de quelques points enfoncés, peu
rides légères à la base des antennes
les
palpes sont d'un jaune pâle,
plus foncé
;
les
la
tète
à
la
serrés, avec des
lèvre supérieure et
bouche
reste de la
antennes sont plus foncées que
pes et un peu plus longues que
saillants,
le
:
le
corselet: les
jaune pâle. Le corselet est
moins
cause de sa forte ponctuation
:
il
les
yeux sont
brillant
a
est
pal-
que
une légère
12
ANNALES
'
aux bords latéraux
teinte fauve
cit
un peu en avant
serrés vers
la
et
est
il
et postérieurs
:
il
se rétré-
cou vert de points enfoncés, plus
ligne médiane et dans les impressions des an-
gles postérieurs, qui se joignent au
moyen d'une autre im-
pression transversale aussi très-ponctuée. L'écusson est
Les éiytres, un peu plus larges que
angulaire.
le
tri-
corselet
sont assez allongées, a peu près parallèles, et légèrement
si-
nuées à leur extrémité
les
striessont ponctuées,
les
intervalles
elles
:
sont à peine pubescentes
elles
-,
médiocrement enfoncées et assez égales;
sont presque planes, finement
sont d'un vert bleuâtre
mais
,
le
pointillés;
disque est d'un fauve
obscurément métallique: cette couleur ne forme pas
tache, elle se perd avec
la teinte
luie
générale des éiytres. Le
dessous du corps est brun, noirâtre par endroits, particuliènient à l'extrémité de l'abdomen. Les pattes sont d'un jaune
pâle.
Cet insecte est remarquable par
la
forme de son corps et
sa coloration, qui pourraient faire croire
qu'il n'est pas aiTivé à
son état parfait.
Chl. australis, Dejean; ce qui
Greyianus
nant à
la
Il
au premier abord
doit être voisin
forme maintenant avec
du
le Chl.
Ad. White; trois espèces de Chlœnius apparte-
,
Nouvelle-Hollande.
Je dois cet insecte et les deux suivants à
M. Fred. Lefebvre, capitaine de corvette.
Ânchomenus Novœ-Zelandiœ,
PI.
yipterus
j
I,
n".
II, fig.
la
générosité de
L. Fairmaire.
2 à
(i.
nigerj thorace cordato, sulcato,
margine subre-
flexa; elyiris ovatis, depressis, striatis; antennis
,
pal pis tar-
sisque rufo piceù.
Long. 12
mill.
Cet insecte est noir luisant
Larg. 5 mill.
,
la tète est
assez grosse, point
DE LA SOCIÉTÉ ENTO^lOLOGIQUi:.
rétrécie postérieuroment
quées entre
les
:
antennes
y a
il
:
deux impressions pou mar-
antennes,
les
13
les palpes et l'ex-
trémité des mandibules sont d'un brun fauve
le corselet est
;
assez grand, presque cordiforme, léi^èrement arrondi: ses
bords sont relevés et
la
médiane est bien marquée. Les
ligne
élytres sont ovales, assez planes, sinuées vers l'extrémité; le
bord antérieur est un peu relevé, et l'espace entre celui
la
première
strie
fortement ponctuée;
est
il
tres entre la
deuxième
Il
la
le
n'y a point
Il
quatrième ar-
Nouvelle Zélande.
me
semble devoir être séparé des ^)Jc/iomenMs,
former un nouveau genre que
peigne,
(xtek;,
intervalles
fortement bilobé.
vient de
Cet insecte
et
et la troisième strie.
Les tarses sont d'un fauve obscur,
ticle est
ci et
y a un point enfoncé à l'extrémité des ély-
sont planes:
d'ailes.
les
y^'oidoç,
mâcboire.
je
)
nommerai Ctenognathus
Ses caractères sont
mâ-
:
choires pectinées; palpes filiformes, le dernier article ovoïde,
aigu; corps déprimé; point d'ailes.
Genre Brachycaulus,
L. Fairmaire.
(BpayuxauXoç, taille ramassée)
Ce genre
le
corselet;
dans
la
a
pour caractères
:
Tête verticale enfoncée dans
yeux faiblement échancrés; antennes en
dernière partie de leur longueur, filiformes à
la
scie
base,
se repliant sous le corselet et ne le dépassant pas en lon-
gueur
;
corps court et épais.
Ce genre rappelle beaucoup par son
mys:
il
le
comme dans celui-ci
le
faciès, le
genre Chla-
corps est épais, irrégulier; mais
s'en distingue facilement par les antennes et les élytresdont
bord externe est à peine sinué.
Il
doit faire partie de ce
groupe d'insectes australiens qui séparent
les
Cyaniris des
U
ANNALl-S
Pachyhrachis. Je crois qu'il faut
placer avant
le
genre
le
Cadmus, Chevrolat; dont les antennes sont légèrement serri
formes
et
presque aussi longues que
Brachycaulus ferrugineus,
PI.
I,
n«.
II,
lig.
L.
le
corps.
Fairmaire.
7 à 9.
Pubescens, ferrugineus; corpore crasso
.
antennis dentlcu-
brevibuSfUsque ad extremitatem incrassantibus
latis^
race inflato
xima;
,
cum
elytris
tribus nigris maculis, qiiarum
tho-
;
média ma-
ad scutellum cum duobus tubercuUs
et
fascie
transiter sali, obscuris.
Long
7 mill. Larg. 4 1/2 mill
Cet insecte est ferrugineux en dessus, recouvert dans
les
parties les plus claires d'un duvet court, soyeux, paraissant
doré à
la
loupe; les antennes sont de
la
quatre premiers articles sont filiformes
bien prononcée
longitudinale:
:
le
la tête
est
le reste est
:
les
en scie
corselet est dilaté dans sa partie supérieure
coupé droit antérieurement
médiane; ce renflement
et
un peu déprimé au milieu où
est
se trouve
cée, pentagonale, d'un noir velouté;
brun assez foncé;
très-clair, ainsi
,
couleur
brunâtre avec une impression
et
est d'un
môme
que
le
celui des
la
une tache enfon-
couleur du corselet
tour de la tache médiane est
deux points
noirs latéraux
:
sur les élytres, de chaque côté de l'écusson, s'élève un tu-
bercule obtus, de couleur brune
ture,
où
elle s'élargit
,
:
cette couleur suit la su-
vers les deux tiers de
la
longueur en
un peu interrompue les épaules sont
prononcées, brunes, et, de même que les deux tubercules,
couvertes de fines granulations, et moins pubescentes que
une
fascie nébuleuse,
le reste
des élytres
:
celles-ci sont
:
grossièrement réticulées,
DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE
très-ponctuées
,
15
surtout dans l'intervalle des réticulations.
Les pattes sont d'un ferrugineux foncé, aplaties;
sont assez larges;
les pattes
Le dessous du corps
est
tarses
les
antérieures sont les plus fortes.
d'un jaune pâle, plus foncé sur
les
côtés du thorax.
Il
vient de
Nouvelle Hollande.
la
Explication des figures de la planche
Fig.
I.
flilœniîis
tié
Fig 2
à G.
:
t't
N*'. //.
ophonoides,L. Fairmaire. grossi de moià côté
mesure de
sa grandeur naturelle.
Anchomenus Novœ-Zelandiœ,
2.
/,
Insecte grossi de moitié
:
L.
Fairm.
et à côté
mesure
de sa grandeur naturelle.
3.
Tibia antérieur très-grossi.
4.
Patte antérieure.
5. Patte postérieure.
6.
Fig. * à \h
Bouche.
Brachycaulus ferrui/ineus^
7.
L.
Fairm.
Insecte grossi de moitié et à côté mesure
:
de
sa
grandeur naturelle.
8.
Patte antérieure très grossie.
9.
Antenne.
ANNALES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE.
17
DESCRIPTION
DE DEUX NOUVELLES ESPÈCES DE BUPRESTIDES DU GENRE
Hyperantha, Gistl. Manuerheim.
(
Pœcilonota, Solier, Dejean, etc.)
(
Eschschollz
DESMAREST.
M. EuLàMie
P;.i
Séance du 18 Janvier 1843.
(1),
a créé dans
la
)
tribu des Biiprestides,
un
nom
de Pœcilonota pour y placer les Bupresrutilans, Fabricius,et conspersa, Gyllenhal. M. Solier,
genre sous
tis
dans son
le
essai sur les Buprestides (2), adopta le
lonota d'Eschscholtz
;
rutilans et conspersa,
gationis
,
Klug
différents.
(J)
,
dont
M. Dejean
mais au
prit
il
lieu d'y
pour type
les caractères
(3), ainsi
que
genre Pœci-
comprendre
le
les
B.
Buprestis interro-
génériques sont très
MM.
de Castelnau et
Eschschollz. Zoologischer Allas, enlhalteiui Abbildungen
und
liesciireibungen neuer Tliierarlen, watireiid des Flott Capitains von
Kotzebue zweiter Reise uiu die Welt,
lin,
etc.
i
Hefi., p. 8 et 9.
Ber-
1829.
(2) Solier.
mière
(3)
série,
Annales de
tome
ii,
la
Sociélé enloniologiqne de France. Pre-
page 26i. Paris,
Catalogue des Coléoptères de
la
i8.'33.
collection de
M,
le
comte De-
jean. 2» édition, p. 76. Paris, 1833. et 5« édition, p. 86. Paris. «836.
âe Série,
.
Ti.
2.
ANNALES
18
Gory
suivirent l'exemple de
(1),
genre Pœcilonota comprend
M.
Solier, et
pour eux
le
B. interrogationis et quel-
le
ques autres espèces ayant avec lui de nombreux rapports.
M.Gisll (2), donna le nom iV H yperantha au B. interrogationis et à des espèces voisines
de celui-ci. Plus tard M.
le
comte
Mannerheim (3), adopta le nom créé par M. Gistl et il restitua aux B. rutilans et conspersa le nom générique de Pœcilonota qui leur avait été appliqué par Eçchscholtz et qui
avait été remplacé dans quelques ouvrages par le
nom de
Lampra, Megerle. Enfin M. Chevrolat (4), en décrivant deux
espèces du genre qui nous occupe, suivit la classification
de M. Mannerheim, et
il
leur appliqua
ii'Hyperantha. Je crois devoir adopter
la
le
nom
générique
dénomination (ÏHy-
perantha proposée par M. Gistl et je pense qu'on doit placer
dans ce genre
les
espèces décrites ou indiquées parla plu-
part des entomologistes français sous le
pour moi
le
nom de
Pœcilonota; al
genre Pœcilonota d'Eschsclioltz correspondra au
genre Lampra de Megerle
et
comprendra
les
B. rutilans,
conspersa, etc.
Les Hyperantha doivent être placés au commencement
du groupe des Jgrilites ; plusieurs auteurs les ont caractérisés d'une
(i)
manière plus ou moins complète, parmi eux on doit
De Caslclnau
cl
iiscoics Colcoplères.
ota.
(2)
Tome
ii
et
Gory. Histoire nauirelie cl iconographie des
Monographie des Biiprestides, genre Pœalo-
Tomeiv. (supplément)
Gistl. Insecien
p. <9i, pi. 32. Paris,
i84<.
Doublelten von Graf Jenison-Walworlh zn
egcnsbnrg. îMunich. i834.
(;^)
Enuméiaiion des Buprestides
nouvelles espèces de celle tribu, de
collection de
M.
le
la
et
description
de quelques
famille des Sternoxes, de la
comte Mannerheim, page 99
et suivantes.
(4) Chevrolat. Centurie de Buprestides. Revue entomologique de
Silbermann. Tome v, page 4i. Strasbourg, i858.
DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE.
citer
MM.
nait
aujourd'hui
MM.
Klug
Solier (l);de Caslelnau et
une ([uinzaine
Mannerheim
(3),
décrit quelques unes, et
leur
(4;
MM.
Gory
(2). etc.
d'espèces
(le
Clievrolat
,
lO
de Caslelnau
(5)
et
On congenre.
C(!
,
en
ont
Gory, dans
monographie des Buprestides, en ont indiqué neuC dont
cinq nouvelles à cette époque. Je vais faire connaître
deux
espèces de ce genre; l'une a été trouvée enColombie
au Brésil, l'autre
f/yperantha vittaticollis
1.
et
rap()ortée de Cordova.
a été
PI.
1.
n».
I,
.,
fig.
E. Desmarest.
1.
Lutea; capite antennisque œne.o-viridibus; ihorace vitta ni-
gra; scutello pentagonali, angulis obtusis; elytris striatis,
denticulatis; corpore sublùs pedibusque œneis.
Long. 22
La
tête est
mill. Larg.
9 mill.
pubescente, d'une couleur bronzée;
les
anten-
nes sont également bronzées-, les yeux sont gros, d'un marron
clair.
Le
corselet est d'un jaune obscur, avec
d'un noir mat sur
le
disque;
sion assez grande se
il
une large bande
est élargi, court,
remarque vers
le
une dépres-
milieu; les angles
postérieurs se prolongent de manière à embrasser la base
(i) Solier.
Annales de
mière série, tome
ii,
la
Société enlomologique de France. Pre-
page 298. Paris, <833.
Genre Pœcilonota.
(2)
De Castelnau
(3)
Klug. Entomologiae brasiliame, spécimen allerum sistens in-
et
Gory, op.
cit.
sectorum Coleopteroruni nondum descriptorum cenluriam. Nova
Acia Acad.
Cœs
suiv. et pi.
XL,
(4)
L. C. Naturaî
fig
3 et
Mannerheim,
(5) Clievrolat,
op
Curiosornm. T. xii, pari,
ii,
4-
op. cit, pages
cit.
99
à i02.
Espèces C8 et 69, page 81
et suiv.
p.
421 et
.
ANNALES
20
des élytres. L'écusson
et
que
,
de
même
la
avec
les clytres, est peiitagonal
émoussés;
il
est
bordé par une
Les élylres, larges
couleur que
très légère
bamlo brunâtre
vont en se rétrécissant d'une
à la base,
manière assez sensible vers leur extrémité;
elles offrent
stries longitudinales, fortes, ponctuées, et se
six dentelures bien distinctes-, les
procliées de la
suture sont
corsoict
le
angles légèrement
les
de.-,
terminent par
deux dents
les plus ra()-
en-
les plus fortes-, les élytres sont
tièrement d'un jaune obscur. Le dessous du corps est d'un
bronzé brillant une ligne de couleur jaune obscur sépare en
;
dessous
la tête
du thorax
tent vers le milieu
les
;
segments abdominaux
préseii-
une tache allongée, jaune fauve; des points
de
môme
le
dernier segment abdominal seul n'offre pas de taches
couleur se trouvent de chaque côté des segments
Les pattes sont d'un bronzé noirâtre.
latérales.
Cette espèce est assez voisine de VHyperantha laiicoUis,
Castelnau et Gory
;
elle
en
diffère principalement: 1°. par
large bande noire au lieu de
la
une
tête qui est pubescente-, 1^. par le corselet qui présente
deux taches irrégulièrement
moins allongé et qui a
triangulaires,- 3°. par l'écusson qui est
une forme presque pentagonale;
moins parallèles, etc.
4".
par les élytres qui sont
Je ne connais que deux individus de cette espèce
:
le
pre-
mier, qui m'a servi pour cette description, a été trouvé en
Colombie par M. Lemoineetil
M
lection de
quer
:
le
second appartient à
toire naturelle
de Saint-Paul,
Je dois
confrères,
le
fait
partie de la riche col-
Rfiiche qui a bien voulu
de Paris
et
il
la
collection
vient
me le communidu Muséum d'his-
du nord de
la capitainerie
(Brésil).
dessin de cet insecte à l'amitié de l'un de nos
M. Léon Fairmaire. Le
représente V Ilijperantha
grandeur naturelle de
dessin
viltalicollis
,
(
pi. i, n°. i, lig. 1.)
grossi de moitié
l'insecte est indiquée à côté.
:
la
DE LA SOCIETE ENTOMOLOf.IQL E.
21
/fyperanthn aligmaticoUis, E. Desmarost.
S.
2
PI.
n".
I,
1,
fig. 2.
Flava; eapitc, an tennis pedibmque œneis
;
thorace maculis
nigris; scutello rotundato; elytris valide striatis, denliculalis,
duabus 7naculis
La
posticis nigris; apice rubro.
2
Long. 25
mill. Larg.
rT
Long. 22
mill. Larg. 8 mill.
lèlc est pubescente,
9 mill.
ponctuée, d'une couleur bronzée;
antennes sont également bronzées;
j-es
d'un brun
yeux sont gros,
les
marron. Le corselet est plus large que long,
ponctué, déprimé vers
nent en avant;
le
le
milieu qui est légèrement proémi-
disque présente chez
la
femelle, trois ta-
ches d'un noir brillant, deux assez grandes, irrégulières,
placées parallèlement vers
longée, à
la
base
-,
chez
le
le
milieu et une plus petite, al-
màle celte dernière tache se réu-
nit aux deux autres,- deux points noirs assez petits se remarquent près des angles postérieurs du corselet qui est
d'un jaune un peu moins foncé que celui du reste du corps;
les
angles du corselet débordent un peu
la
base des élytres.
L'ccusson est arrondi, plus large que long, de
même couleur
que
le
le corselet.
Les élyires, aussi larges que
corselet à
la
base, vont en se rétrécissant légèrement jusqu'à leur extrémité, et présentent desstries longitudinales très fortes et ponc-
tuées; elles sont dentelées à leur extrémités,
rapprochée de
la
suture et celle qui
la
la
dent
la
femelle
au nombre de huit, sont entièrement rouges
à
;
ces dents
l'exception
des deux plus grandes dont l'extrémité est noire;
:
plus
suit sont surtout for-
tement marquées, principalement chez
sont d'une couleur jaune
la
les élytres
vers leur exirémité, qui
est
ANNALES
22
teintée de rouge,
ment
deux taches noires
voit
Le dessous du corselet
suture.
Chez
on
la
domen,
ainsi
que
le
jaune; chez
poitrine et de l'ab-
la
dernier segment abdominal sont d'une
le
le
jaune
entièrement
est
femelle, les pattes, les côtés de
couleur bronzée obscure, et
est
irrégulière-
triangulaires, n'atteignant ni le bord extérieur, ni la
mâle,
le
le
milieu des autres segments
dernier segment présente vers
milieu et à son insertion avec le pénultième, une tache
jaune, de forme ovalaire, faisant suite aux taches des autres
segments.
VHyperantha
sUgmaticollis diffère
Vff. laticollis C'Asielnau et
,
marqué de
qu'il n'y
1^. lecorseletest
plusieurs taches noires dans le premier, tandis
en a que deux dans Vff.
moins allongé
et
il
a
laticollis; 2". l'écusson est
une forme arrondie;
teintées de rouge postérieurement et
ches noires dans 1'^. sUgmaticollis
VH.
de
essentiellement
Gory, en ce que:
,
3". les ély très
sont
marquées de deux
ce qui n'a pas
lieu
ta-
dans
laticollis, etc.
Je n'ai vu que deux individus de cette espèce qui tous
deux ont
été pris
aux environs de Cordova, dans l'Amérique
méridionale. L'un de ces individus, le mâle, appartient à
notre collègue M. Dupont; l'autre, qui est une femelle
partie de
ma
collection et a été
sène Isabelle, chancelier royal
mon
,
fait
M. Arattaché au consulat de Mondonné
à
père par
tevideo.
Mon
ami M. Léon Fairmaire a bien voulu dessiner
peindre cet msecte, et je
le
prie de recevoir
mercîments. La figure que je donne
(
PI.
ici
i,
tous
n
•.
i,
mes
et
re-
fig. 2.)
représente VHyperantha stigmaticollis femelle, grossi de
moitié
:
à côté se
trouve
la
mesure de sa grandeur
naturelle-
DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE.
23
.\-*%*\ l\«\^^vv\'\
NOTE
POUI5 sr.KVin a i.'iiistoikk di. L' ./{irilus hiqutlalm.
Par M. (.OIJUEAU.
(Séance Ju
Nous
\''
.
Février 1}>45.
}
coiiuiioiiçuns à coimaîlre l'Iiistoire des coléoptères
dos liupreslidcs; car déjà deux espèces ont été
observées et décrites sons leurs trois états, de larve, de
chrysalide et d'insecte parfait.
M.
à
la
le
docteur Aube, dans une note qu'il a communiquée
Société, le
1*'
mars 1837, nous a donné
grilus viridis. CallQ note est
l'histoire
accompagnée de
de
VA-
figures grossies
représentant lesdeiix premiers étatsde l'insecte, ainsi que les
détails
de
la
bouche de
la larve,
qui ne laissent rien à désirer
sur les formes de cet organe. La larve vit sous
les
écorcesdes
bouleaux qui croissent au bois de Boulogne et y subit ses
métamorphoses Elle y était très commune en 1837.
La seconde espèce bien connue
.so.s/ir/mrt,
dont
est le Chryaobolhris chry-
l'histoire est insérée
dans
sciences naturelles du mois de juillet 1840.
les
auteur du mémoire qui nous a
fait
donné des dessins grossis de
chrysalide, de
parties de
la
bouche de
la
Annales des
M. Léon Dufour,
connaître cette espèce, a
la
larve et des
cette dernière. L'insecte vit et subit
ses évolutions sous les écorces des
chênes morts dans
les
en-
virons de Saint-Séver.
J'ai
observé dans
le
pays de Gex, une troisième espèce,
VÂ(jrilus biyutlatus, qui fait l'objet de cette note. Cet insecte
ANNALES
24
à l'élat
de larve,
vit
dans
les
écorces du chùne où on
trouve pendant l'automne, l'hiver et
on
le
cherche sur
dans toutes
entourent
les
les
môme temps. On
bois, l'eau
de
auparavant;
pour nourrir
la
le
chercher
la
les
années précé-
chaleur, se détachent
abondamment qu'elle
le fai-
sont alors convenablement disposées
larves de VJgrilus biguttatus et celles de
les
En détachant
venues
si
trouve sous
pluie s'introduit dans l'ouverture, la sève
elles
beaucoup d'autres
et l'hiver,
ne doit pas
souches des arbres coupés
s'altère et cesse d'y circuler aussi
sait
l'y
écorces indifféremment, mais dans celles qui
dentes. Ces écorces, par l'effet de
du
le
printemps-, mais
du mois de mai, on
la lin
ses trois form-js en
le
insectes.
rompant ces écorces pendant l'automne
on y trouve des larves d'Jgrilus non encore paret
à toute leur croissance;
mais au printemps de cer-
taines années elles y sont très nombreuses. Elles ne pénétrent pas jusqu'au bois; elles se tiennent toujours dans
l'é-
paisseur de l'écorce. La femelle de VJgritus biguttatus est
pourvue d'un oviducte
nue ses œufs dans
elle
met
les
très long
gerçures
ainsi les larves qui
au moyen duquel
les plus
elle insi-
profondes de l'écorce;
en sortiront dans une position
favorable pour s'introduire dans les couches encore tendres
et
imprégnées des sucs qui conviennent à leur nourriture.
Ces sucs ne sont pas ceux produits par une végétation saine
et vigoureuse, c'est-à-dire,
térée,
comme
on
l'a
une sève pure; mais une sève
Les larves ne creusent pas dans
galeries à
la
al-
déjà dit plus haut.
les
manière des Scolytes, dont
écorces de longues
la
partie
abandonnée
est remplie de poussière de bois desséchée; elles se tiennent
dans unesortede cellule qu'elles agrandissent au fur et à mesure de leur croissance cette cellule est cependant toujours
;
pluslongue et plus largeque
la
larvequi peut y exécuterquel-
ques mouvements. Cette dernière n'a pour tout alimentque
la
DE LA SOCIETE
ENT().M()I.()(xIO[IE.
2r>
sève qui arrive autour de sa loge elqu'elle extraiten en
chant
les parois.
salide, elle reste
mâ-
Lorsqu'elle doit se métamorphoser en chry-
dans une immobilité absolue
tracte peu à peu de
manière à perdre environ
et se
la
con-
moitié de
sa longueur^ de plate, molle et llasque qu'elle était, elle devient un peu plus ronde et plus ferme. L'insecte reste peu
de temps sous sa forme intermédiaire, puisque
à l'époque
du 26 mai, dans
les
mêmes
des ch; ysalides et des insectes ailés prêts
essort; njais avant de voir
grand ouvrage
à
exécuter,
la
il
l'on
trouve
écorces; des larves,
à
prendre leur
lumière ces derniers ont un
leur ftmt s'ouvrir
un passage à
travers l'écorce qui les couvre; ce qu'ils ne peuvent entre-
prendre qu'après que leurs mâchoires se sont durcies et que
leurs muscles se sont afTermis.
les
On
trouve quebiuefois dans
écorces les cadavres de ceux qui n'ont pu achever cette
opération et qui sont morts misérablement avant d'avoir
le
va
jour.
Les femelles , immédiatement après leur métamorphose de
chrysalide en insecte parfait, ont leur oviducte hors du corps,
entièrement dégagé;
le
dos des élytres;
il
il
est plié à
sa racine et
couché sur
rentre dans l'abdomen lorsqu'elles se
«ont affermies et qu'ayant percé l'écorce elles sont prêtes
à s'envoler.
Cet oviducte paraît déprimé, son extrémité est
arrondie et
terminée par deux appendices membraneux;
on distingue dans toute son étendue de x
traits
représentent, à ce que l'on peut conjecturer,
lequel sortent les œufs à l'époque de
Les Acjrilus higuitatus sont très
la
le
bruns qui
canal par
ponte.
communs dans
certai-
nes années; leurs larves envahissent les écorces des sou-
ches de chêne répandues dans
creusées et rongées dans tous
le.s
les forêts;
après les avoir
sens, elles s'y changent en
insectes parfaits qui les percent d'une multitude de trous
ronds pour en sortir et se livrer aux derniers actes de leur
ANNALES
26
vie.N(3 jieut-oii pas dire, d'après ces
destinées à hâter
la
qu'elles scinblcnl
laits,
ruine des vieilles écorces,
en débaras-
à
que ces dernières livrées aux influences
aux autres insectes destructeurs, tombent
ser les souches; afin
de l'atmosphère et
bientôt en décomposition et laissent
la
amen-
place libre et
dée pour de nouveaux végétaux qui viendront
Les Agrilus et autres Buprestides ne sont pas
s'y établir?
les seuls
qui
travaillent à débarrasser les forêts des troncs inutiles et à
les
convertir en terreau
;
y a une multitude d'autres in-
il
sectes qui les percent en tout sens, qui hâtent leur
décom-
position, qui les divisent lorsqu'elles sont à peu près
décom-
posées.
Tous ces
petits êtres
semblent avoir
nation dans l'ordre général de
semble
y entretenir la vie et
à
la
on
la retire
la
une jeunesse
de sa loge, avant
croirait morte.
de tout son long: d'autres
touche
le
que
tient,
éternelle.
comme
je
l'ai dit,
le
temps de sa contrac-
Quelquefois
elle
fois elle est pliée
y est étendue
en deux,
la tête
dernier anneau. Lorsqu'elle est parvenue à tout son
développement, qu'elle
celle
desti-
souches de chêne. Elle est lente, molle, flasque;
les
lorsqu'on
tion,
même
nature, et concourir en-
La larve de VJririlusbigutlatus se
dans
la
j'ai
tiouvee
le
a
commencé
26 mai,
à se contracter
elle a
comme
15 millimètres de long
sur 3 millimètres de large. Elle est un peu déprimée, formée
de douze anneaux arrondis pardessus, blanchâtres, séparés
par des incisions fortement prononcées. Les trois premiers
qui correspondent au thorax sont plus petits que les autres
le
dernier est rugueux
,
;
terminé par deux épines droites,
cornées, brunes, portant au côté interne deux petites dents.
Elle est privée de pattes.
chaque côté;
le
On
y distingue neuf stigmates de
second anneau et
privés; les neuf autres en ont
les
deux derniers en sont
paire. Ce que
chacun une
cette larve otTre de plus remarquable, c'est sa tête
beaucoup
plus grosse que les anneaux du corps; elle est sphérique,
DE LA SOCIÉTÉ ENÏOMOLOGIQUE.
marquée d'un
blanchâtre,
trait
longitudinal l)run;
peron est varié de brun et de blanchâtre
est
les
brune
ainsi
que
que deux
même
la
Je n'ai pas distingué à
inoins
mandibules;
les
mâchoires sont de
la
27
la
;
la lèvre
le
cha-
supérieure
lèvre inférieure et
nuance, mais moins foncée.
loupe les palpes et les antennes, à
petits tubercules
que Ton
voit à la racine
des mandibules ne soient ces derniers.
Je suppose que le dernier anneau de l'abdomiMi, corné, rugueux comme une râpe, terminé par deux épines armées
chacune de deux dents saillantes l'une en dessus, l'autre en
dessous; je suppose dis-je, que ce dernier anneau lui sert à se
mouvoir, que
la larve,
avec son aide, prend un point d'appui
dans sa loge pour se pousser en avant ou pour exécuter
d'autres mouvements.
Cette larve a
la
,
Ce célèbre entomologiste y
a
observée par M. Léon Dufour.
reconnu un caractère qu'il a
trouvé dans d'autres larves, caractère dont
les classer
;
il
c'est-à dire,
du
plus grande ressemblance avec celle
Chrysobothris chrysostigma
il
re-
pour
s'est servi
placecelle-ci dans la division des Hémicèphalées,
dans celle destinée aux larves dont
la tête est
premier anneau Ihoracique et
en partie rentrée dans
le
dans laquelle, à ce que
suppose, on peut ranger celles des
longicornes; car
je
semble au premier coup d'œil que leur
il
tête est en partie rentrée
nière de voir, ce que
est
pour
ce que
le
j'ai
j'ai
dans
le
thorax. D'après cette
appelé précédemment
le
célèbre entomologiste de Saint Séver,
appelé
la
tête est le prothorax.
En
ma-
chaperon,
la tète; et
suivant
la
même
idée, la première paire de stigmates se trouve située
entre
le
prothorax et
le
mésothorax;
privé de ces ouvertures. Lorsque
en chrysalide,
naire; car
avant
la
le
il
la
le
larve se
s'opère un changement
métathorax est
métamorphose
bien extraordi-
thorax qui n'avait qu'une paire de stigmate
transformation en possède deux paires après
;
et