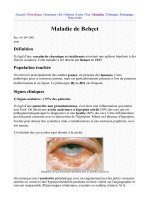Cachier d urologie - part 2 pptx
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (108.64 KB, 18 trang )
cahier
d'
urologie
16
Cancer de la prostate
être normal (< à 4 ng/ml) dans les 3 à 6 mois. Le suivi des patients est ensuite important autant sur le plan
clinique que par les dosages succéssifs de PSA. Il permet de faire le diagnostic de croissance des métastases
et d’un prévenir les complications (compressions neurologiques et fractures pathologiques, CIVD ) bien que
l’évolution soit la plus souvent fatale dans les 6 mois suivant le diagnostic de l’échappement hormonal.
Le traitement de l’échappement hormonal
L’échappement hormonal constitue la phase terminale du cancer de prostate lorsque la progression se
poursuit indépendamment de la présence d’androgène.
1) Les patients avec un échappement hormonal doivent être traités symptomatiquement par le traitement
de l’obstruction urétérale (drainage).
2) Utilisation de la radiothérapie pour les douleurs osseuses en relation avec des métastases et plus
rarement la chimiothérapie dans le cadre d’essai thérapeutique.
POUR EN SAVOIR PLUS
1) Chatelin, C. Ressources thérapeutiques actuelles dans le cancer de la prostate. Progrès en Urologie. 1994, 4:651-670
2) Jidiliuski, P. Indications de la prostatectomoe radicale dans le cancer de la prostate. Annales d’Urologie. 1994, 28:184-189
3) Boccon-Gibod, L. Progrès en onco-urologie. Progrès en Urologie. 1991, 1:17-21.
cahier
d'
urologie
17
Lithiase urinaire
Lithiase Urinaire
La maladie lithiasique est la manifestation clinique de la présence de concrétions dans la voie excrétrice
urinaire. Son incidence est de 2 à 3 % dans la population générale. Elle touche trois hommes pour une
femme, entre 30 et 50 ans.
Le risque de récidive à 5 ans est de 30 à 50 %.
I - PHYSIOPATHOLOGIE ET ETIOLOGIES
La physiopathologie concernant la formation des calculs est mal connue. On admet cependant trois phases
(la nucléation qui est le passage des sels dissous en phase liquide à une phase solide, la croissance des
cristaux et la croissance du calcul).
Le déroulement de ces étapes est schématiquement conditionné par les facteurs suivants :
- augmentation de la concentration urinaire des substances cristallisables (hypercalciurie,
hyperoxaliurie, hyperuricurie)
- diminution des inhibiteurs de la cristallisation (citrate pyrophosphate) influencés par les variations du
pH.
- existence de facteurs anatomiques (uropathies) favorisant la formation de calculs :
* stase urinaire rénale (reins en " éponge " de la maladie de Cacci Ricci, diverticule caliciel, syndrome
de la jonction pyélo-urétérale) ou du bas appareil (obstacle cervico-prostatique, vessie neurologique, sténose
urétrale)
* urine infectée (reflux vésico-rénal)
* kyste simple du rein, polykystose rénale, calcul sur corps étranger.
Le calcul produit dans les cavités rénales va ensuite avoir la possibilité soit de croitre in situ soit de migrer
dans les voies urinaires.
Lors de sa migration, le calcul peut obstruer la voie urinaire en différents points : tige calicielle, jonction pyélo-
urétérale, uretère, jonction urétéro-vésicale. En cas d'obstacle prolongé, l'hypertension réalisée dans les
cavités va entraîner un amincissement de parenchyme rénal, puis une destruction progressive de celui-ci. En
cas d'infection ??? tableau de Rétention d'Urines furulentes puis de véritable bionéphrose va se constituer.
En cas d'obstruction, il se crée un oedème au contact du calcul tendant à favoriser son enclavement.
En amont de l'obstacle se crée une accumulation d'urine avec dilatation des cavités et hyperpression
intracavitaire.
Souvent aucune étiologie n'est retrouvée.
Les calculs sont constitués de sels de calcium, d'acide urique, de cystine ou de sels phospho-
cahier
d'
urologie
18
Lithiase urinaire
ammoniacomagnésiens (tableau 1). Les lithiases calciques sont le plus fréquemment en cause (oxalate de
calcium et/ou phosphate de calcium), représentant 75 % des cas et souvent accessibles à un traitement.
Tableau 1 : principaux types de lithiases
Nature Chimique Fréquence approximative
Oxalate de phosphate de calcium 30 à 40 %
Oxalate de calcium 26 %
Phosphate de calcium 7 %
Acide urique 5 % à 15 %
Cystine 1 %
Sel phospho-ammoniacomagnésien 20 %
LITHIASE CALCIQUE
Très fréquente, la lithiase calcique survient habituellement chez le sujet jeune et, en l'absence de traitement,
tend à récidiver dans les 3 à 5 ans suivant le premier épisode.
Les profils évolutifs varient d'un malade à l'autre, de même que la fréquence des épisodes cliniques.
Certaints patients ont à la fois des calculs calciques et des calculs d'acide urique. Ils ont un taux de récidive
deux fois plus élevé que les autres.
Les calculs d'oxalate de calcium (monohydratés ou dihydratés) et phosphocalciques sont radio-opaques
blancs, gris ou noirs, hérissés, se formant à pH variable, favorisés par l'hypercalciurie, l'hyperuricurie et
l'hyperoxalurie.
De nombreuses étiologies peuvent être à l'origine de la formation de lithiases calciques (voir endacré "
étiologies de lithiases calciques ").
Etiologies des lithiases calciques
Lithiase calcique avec hypercalciurie (30 à 40 % des cas)
- Idiopathiques :
- sporadique : par fuite urinaire du calcium ? par
augmentation de l'absorption du calcium ?
- familiale, autosomique dominante
- Secondaire :
- hyperparathyroïde
- acidose tubulaire distale de type I (sporadique, familiale)
- sarcoïdose
- intoxication à la vitamine D
- maladie de Paget
- fuite urinaire des phosphatases
Lithiase calcique sans hypercalciurie
- Avec hyperuricosurie
- Avec hyperoxalurie
- primitive, héréditaire
- secondaire : maladie de Crohn, maladie coeliaque, résection iléale,
insuffisance pancréatique
- Lithiase calcique idiopathique
cahier
d'
urologie
19
Lithiase urinaire
LITHIASE URIQUE
La formation de cristaux d'acide urique peut entraîner une cristallurie, des calculs, une obstruction de la voie
excrétrice.
L'hyperuricémie peut se compliquer de néphrite interstitielle par dépôt d'acide urique.
Le pH urinaire acide favorise la formation de cristaux d'acide urique, surtout s'il abaisse en dessous de 6.
La lithiase urique représente environ 5 à 15 % des lithiases dans les pays occidentaux.
Elle est plus fréquente chez les malades atteints de goutte et chez l'homme (cinq à dix hommes pour une
femme) après 50 ans.
La déshydratation chronique et l'acidose favorisent la concentration des urines en acide urique et abaissent
le pH.
L'augmentation d'apport protidique est source d'une augmentation de l'uricosurie.
C'est un calcul brun, lisse et radiotransparent.
LITHIASE DE CYSTINE
La lithiase de cystine est une maladie héréditaire, rare, du transport des acides aminés par l'épithélium
intestinal et les cellules tubulaires rénales, entraînant une excrétion anormalement élevée de cystine dans
l'urine.
Dans la forme récessive, les calculs apparaissent dans la quatrième décennie.
L'obstruction de la voie excrétrice, l'infection et l'insuffisance rénale sont fréquentes, particulièrement chez les
hommes.
Les calculs sont peu radio-opaques et bilatéraux.
Même sous traitement, la récidive est difficile à éviter.
LITHIASE PHOSPHO-AMMONIACOMAGNÉSIENNE
La lithiase phospho-ammoniacomagnésienne n'apparait que si l'urine est infectée, alcaline, habituellement
par des germes produisant une uréase, tels que le protéus et Providencia. Plus rarement pour les Klebsiella,
Serratia ou Enterobacter, mais jamais pour E.Coli.
La formation de calcul débute dans l'environnement immédiat des bactéries et les calculs contiennent en leur
centre des germes inaccessibles au traitement. le traitement de l'infection passe par le traitement de la "
pierre ". Il existe souvent une cause urologique associée, entraînant une stagnation de l'urine favorisant la
formation calculeuse.
La croissance de ces calculs radio-opaques est rapide et la récidive fréquente.
Les lésions rénales sont dues à l'obstruction et l'infection.
II - DIAGNOSTIC POSITIF
1 - Colique néphrétique : douleur aiguë
La colique néphrétique est le symptôme le plus caractéristique, traduisant l'hyperpression brutale de la voie
excrétrice en amont d'un obstacle.
- A début brutal, elle est favorisée par un voyage, un écart de régime, une prise de boisson abondante,
une période de déshydratation.
- D'intensité très violente (crise " frénétique "), elle siège classiquement dans la fosse lombaire et irradie
en avant ou dans la direction abdomino-inguinale (racine de la cuisse et organes génitaux externes), mais
aussi à l'hypocondre, l'ombilic et diffuse à tout l'abdomen.
- Elle peut s'installer progressivement, atteindre son paroxysme, décroître et s'amplifier de nouveau. La
répétition des crises donne le classique tableau d'état de mal néphrétique (crises subintrantes).
- A ces symptomes, peuvent être associés :
- des signes d'irritation péritonéale (nausées, vomissements, arrêt du transit, ballonnements)
- des signes pelviens fréquents vésicaux (pollakiurie, dysurie, douleurs mictionnelles, voire
rétention d'urine) ou rectaux (ténesme), qui ont une signification de localisation du calcul (calcul pelvien, ou
méatique).
cahier
d'
urologie
20
Lithiase urinaire
2 - Autres symptomes
- Les douleurs chroniques :
- peuvent alterner avec les crises de coliques néphrétiques ou être isolées
- sont calmées par le repos ou le décubitus.
- L'hématurie microscopique est quasi constante à la bandelette urinaire ; elle peut être macroscopique mais
elle est en général peu abondante.
- La fièvre traduit une infection d'importance variable, pouvant aller jusqu'au grand choc toxinique
incontrôlable : obstacle urinaire complet avec rétention d'urine infectée, qui est une urgence vitale, obligeant
à un drainage externe ou interne de l'urine et une antibiothérapie.
- L'insuffisance rénale peut traduire une lithiase, s'il y a un obstacle sur un rein unique (anatomique ou
fonctionnel) ou si elle est bilatérale.
Une lithiase peut être latente et être révélée de façon fortuite lors d'un ASP et d'une échographie.
3 - Examen clinique
- Interrogatoire rapide (antécédents personnels et familiaux lithiasiques, hyperuricémie)
- L'examen physique est pauvre, mais doit être complet avec recherche de signes de gravité (hyperthermie,
hydronéphrose comblant la fosse lombaire : contact.
- Le patient souffre et doit être calmé. Il faut, sans tarder, effectuer des examens complémentaires de
débrouillage et traiter la crise.
4 - Examens radiologiques
• Radiographie de l'abdomen sans préparation
L'ASP est un examen primordial, qui :
- visualise les calculs radio-opaques (90 % des lithiases)
- précise leur siège
- peut montrer des signes d'irritation digestive (iléus et gastrographie gazeuse)
Cependant cet examen a des limites.
- Par défaut, l'ASP ne visualise pas
- les calculs se projetant sur une pièce osseuse
- les lithiases radiotransparentes (uriques)
- les obstacles non lithiasiques de la lumière urétérale (caillot, polype), les causes pariétales obstructives
(tuberculose, syndrome de la jonction, bilharziose), les compression extrinsèques (tumeur digestive,
gynécologique, lymphome, fibrose rétropéritonéale ).
- Par excès : phlébolithes et ganglions mésentériques calcifiés par exemple.
• Urographie intraveineuse
Contre-indication
Avant de pratiquer une UIV, il faut s'assurer de la normalité de la créatininémie et de l'absence de contre-
indication absolue (allergie à l'iode, prise de biguanides dans les 48 heures précédant l'examen, myélome).
La grossesse n'est pas une contre-indication absolue (trois clichés peuvent être tolérés au troisième
trimestre).
Diagnostic
L'UIV est un examen clé :
comprenant un ASP, des clichés des trois quarts voire des tomographies, réalisés à 30 secondres, 3, 10 et
30 minutes, ainsi qu'un cliché tardif 1 ou 2 heures après ou plus tardivement (jusqu'à 24 heures) selon le
degré de sidération du rein
Localisation : l'UIV permet de :
- visualiser avec certitude le niveau et le degré de l'obstacle,
- de mettre en évidence un calcul radiotransparent (image lacunaire)
- éliminer les calcifications extra-urinaires.
Retentissement
- L'UIV apprécie le retentissement sur la voie excrétrice d'amont et sur la valeur fonctionnelle des reins
(distension modérée ou hydronéphrose inquiétante) :
cahier
d'
urologie
21
Lithiase urinaire
- le rein de stase s'opacifie avec retard par rapport au rein opposé. Ce retard n'est pas proportionnel à
la stase
- le rein peut ne pas excréter (parenchymographie, mais pas de pyélographie). C'est un rein dit " muet
" par abus de langage
- l'importance de la stase ne dépend pas forcément de la taille du calcul (un gros calcul coralliforme
n'entraîne pas de stase, contrairement à une lithiase enclavée dans le méat urétéro-vésical.
- Autres signes de retentissement :
- sténose inflammatoire de la voie excrétrice, source de difficulté et d'échec du traitement
- atonie de la voie excrétrice sus-jacente et sous-jacente (uretère visible sur toute sa longueur sur un
même cliché : image de " trop bel uretère "). Dans des conditions physiologiques, l'uretère est animé de
contractions péristaltiques, conduisant le bol urinaire, donnant un aspect discontinu sur les clichés d'UIV
- urétérite pseudo-kystique : chapelet de lithiases radio-transparentes ou stigmates oedémateux du
parcours de la lithiase dans la voie excrétrice
- oedème périméatique pseudo-tumoral (signe de Vespiniani), lorsque la lithiase est enclavée dans la
portion intramurale de l'uretère.
Tous ces éléments sont fondamentaux pour la conduite thérapeutique à adopter.
• Echographie rénale
L'échographie rénale est un examen non invasif, reproductible, mais opérateur-dépendant.
Elle peut montrer :
- des signes directs (image hyper-échogène au niveau du rein ou dans l'uretère juxtavésical si la vessie
est remplie)
- et des signes indirects ( distension du haut appareil avec cavités trop visibles ou dilatées).
L'échographie n'explore pas l'uretère en raison des interpositions digestives (sauf les régions sous pyélique
et intramurale).
Cet examen est utile pour les cas où il existe une contre-indication absolue ou relative à d'autres examens et
peut mettre en évidence la présence d'une tumeur.
• En pratique
Dans la pratique quotidienne, l'ASP et l'échographie sont réalisées en première intention.
L'UIV gardant son indication dans le cas d'un obstacle non visible ou lorsqu'un traitement chirurgical ou par
ondes de choc est envisagé.
En cas de doute, on peut réaliser :
- un uroscanner qui permet, grâce aux échelles de densité, de faire la différence entre une tumeur (isodense
à 20 unités Houndsfield) et un calcul d'acide urique (près de 100 UH)
- une urétéro-pyélographie rétrograde qui permet d'évaluer l'état de la voie excrétrice, si celle-ci n'a pu être
appréciée par l'UIV.
- une pyélographie par ponction percutanée, visant à drainer la voie excrétrice, et à faire des prélèvements si
nécessaire
- une scintigraphie rénale, qui apprécie la valeur fonctionnelle comparée des reins.
5 - Examens biologiques
• Bilan biologique de base
Un bilan biologique de base est pratiqué, comprenant :
- un ionogramme sanguin : créatininémie, calcémie, phosphorémie, uricémie
- un pH urinaire
- un ECBU (stérilité indispensable si un traitement chirurgical ou par ondes de choc est envisagé, recherche
de germes uréasiques)
Si l'ECBU est positif, une antibiothérapie est débutée.
L'analyse chimique de la composition du calcul est réalisée si celui-ci a été éliminé ou extrait par un geste
chirurgical.
• Bilan plus approfondi
Si le bilan de base est perturbé ou la lithiase récidivante, un bilan plus approfondi doit être entrepris (calciurie
des 24 heures, PTH, échographie cervicale à la recherche d'un adénome parathyroïdien ).
cahier
d'
urologie
22
Lithiase urinaire
III - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE
- les autres calcifications : vésiculaires, ganglionnaires, costales, phlébolithes, etc
- les images lacunaires de la voie excrétrice : caillots, tumeurs, etc
DIAGNOSTIC CLINIQUE
La douleur peut tromper le clinicien, l'orienter à tort vers une lithiase, alors qu'il s'agit :
- d'une colique hépatique (irradiation à l'épaule droite, post-prandiale déclenchée par l'ingestion de graisse)
- d'une appendicite aiguë (signe de McBurney avec défense)
- ou d'une cause gynécologique (rupture, torsion d'un kyste de l'ovaire ou grossesse extra-utérine)
- ou surtout une fissuration d'anévrisme
IV - EVOLUTION
EVOLUTION SIMPLE
Il peut s'agir de l'élimination spontanée du calcul (95 % des cas quand les dimensions de lithiase sont
inférieures ou égales à 5 mm) ou favorisée par le traitement médical (cure de boisson, alcalinisation des
lithiases uriques).
Le calcul peut être bien toléré : caliciel, coralliforme.
EVOLUTION COMPLIQUÉE
- Une récidive demande qu'un bilan biochimique approfondi soit réalisé
- Obstruction partielle ou complète qui, si elle devient menaçante (rein unique fonctionnel ou anatomique, ou
infection), impliquera, en urgence, une dérivation urinaire externe (néphrostomie) ou interne (sonde urétérale
ou sonde à double J).
V - TRAITEMENT
Le patient souffre, il faut le traiter, sans délai, sans " trop " attendre les examens complémentaires, surtout s'il
existe des antécédents lithiasiques.
1 - Traitement de la crise
La douleur est due à une hyperpression brutale, dans la voie excrétrice supérieure, en amont d'un obstacle.
L'attitude thérapeutique à deux objectifs :
- diminuer la pression intrapyélique par réduction des apports hydriques
- favoriser l'écoulement urinaire autour de la lithiase par l'effet anti-oedémateux des anti-inflammatoires non
stéroïdiens.
2 - Schéma thérapeutique
Clamer la douleur en prescrivant
- anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie intraveineuse lente ou dans une perfusion de glucosé 5 % à
passer en 30 minutes (Profenid 100, Indocid, Voltarène)
- antispasmodiques (Spasfon).
Ces deux médicaments peuvent être administrés dans la même perfusion.
Si la douleur ne cède pas en une demi-heure, on peut renouveler l'injection.
Dans certaines crises rebelles, on peut être amené à administrer des antalgiques " périphériques " majeurs
(Viscéralgine Forte, Baralgine, Avafortan), voire des analgésiques " centraux " de type morphinique.
cahier
d'
urologie
23
Lithiase urinaire
Restriction hydrique
Arrêt des boissons pendant la crise, puis reprise d'une hydratation abondante après la crise.
3 - Traitement de la cause : la lithiase
• Traitement médical
Le traitement médical est indiqué en cas de colique néphrétique non compliquée (ou de latence), et lorsque
le calcul peut être dissous (lithiase urique ou cystinique)
• Lithiase urique
En cas de lithiase urique, il faut réduire l'uricosurie et augmenter la diurèse et le pH urinaire.
- le pH urinaire doit toujours être supérieur à une valeur située entre 6 et 6,5 par ingestion de bicarbonate de
sodium (eau de vichy, un demi-litre en plus des 2 litres d'eau quotidiens) et d'un mélange de citrate de
potassium et d'acide citrique (Foncitril 4000, 3 sachets par 24 heures, Alcaphor, 3 cuillères à soupe par 24
heures)
- le pH urinaire sera surveillé par des tests à la bandelette urinaire
- s'il existe une hyperuricurie et/ou une hyperuricémie, un régime pauvre en purines sera prescrit (anchois,
abats, asperges ) et l'apport protidique sera restreint.
• Lithiase cystine
Le traitement d'une lithiase de cystine ne peut inclure une réduction des apports en méthionine, précurseur
de la cystine, car il s'agit d'un acide aminé essentiel
- la cure de diurèse permet de diminuer la concentration urinaire en cystine, si elle est supérieure à 4 l/24 h.
- l'alcalinisation des urines au delà du pH 7,5 est nécessaire, mais difficile à obtenir.
- la D-pénicillamine est indiquée au long cours en cas de récidive des calculs, malgré la diurèse alcaline (fixe
la cystine et empêche sa précipitation). Cependant, les effets secondaires sont importants (anosmie et
agueusie justifiant la supplémentation en zinc). Un " rash " cutané ou un syndrome néphrotique peuvent
imposer l'arrêt du traitement. Le Thiola (αmercapto propionyl glycine) a remplacé la D Penicillamine. Il impose
un contrôle régulier de la Protéinurie et de 10 numération formule.
Traitement chirurgical
Le traitement chirurgical est indiqué pour les calculs non compliqués et/ou - en cas d'échec de la dissolution
(les lithiases de diamètre inférieur à 5 mm ont plus de 80 % de chances d'élimination spontanée ou favorisée
par le traitement médical).
Plusieurs traitements chirurgicaux sont possibles.
Lithotritie extra corporelle par ondes de choc
- Principe de la lithotritie extra-corporelle (LEC) : l'onde de choc est créée au foyer F1 par un arc électrique
(dans une cuve remplie d'eau ou par un coussin appliqué sur le coprs) puis réfléchie au foyer F2 (calcul) par
l'intermédiaire d'une ellipsoïde. L'onde de choc générée va traverser l'eau et les tissus mous (assimilés à
l'eau), sans dommage et frapper le calcul.
- Elle est effectuée en traitement ambulatoire ou pendant une courte hospitalisation (24 à 48 heures).
- Les calculs sont fragmentés et s'éliminent dans les jours ou les semaines qui suivent. Les patients ont en
général une hématurie macroscopique pendant 24 à 48 heures et quelques douleurs lombaires parfois
violentes.
- Les complications sont rares (1 à 2 % des cas) si l'on respecte les contre-indications (infection urinaire et
trouble de la coagulation). La complication la plus fréquente est la colique néphrétique rebelle, qui peut
nécessiter un geste complémentaire (urétéroscopie).
Extraction par voie endoscopique
- L'urétéroscopie traite la lithiase en la détruisant in situ par ondes de choc (Lithoclast) ou ultrasons
(Sonotrode). Cette technique est très efficace pour les calculs pelviens (plus de 95 %).
- Néphrolithotomie percutanée (NLPC) : le néphroscope est introduit par voie lombaire au travers de la paroi
et va permettre le traitement de calculs volumineux par les méthodes physiques précitées.
- La chirurgie à ciel ouvert (exceptionnel et efficace) est réservée aux volumineuses lithiases (coralliforme,
lithiase piégée par une uropathie avec atrophie parenchymateuse). Une néphrotomie, une pyélotomie, ou une
néphrectomie partielle sera réalisée selon le cas.
cahier
d'
urologie
24
Lithiase urinaire
Tableau 2 : les différentes formes du traitement chirurgical
Siège de la lithiase Diamètre Traitement
Rénal Inférieur à 1,5 cm Lithotritie extra corporelle
Supérieur à 1,5 cm Lithotritie extra corporelle et
et inférieur à 3 cm sonde double J
Supérieur à 3 cm Néphrolithotomie percutanée
Urétéral Lombaire Lithotritie extra corporelle
Iliaque " Flush " ou urétéroscopie
Pelvien Urétéroscopie (lithotritie extra corporelle)
Coralliforme Néphrolithotomie percutanée et/ou lihotritie
extra corporelle
Chirurgie
Traitement curatif de la lithiase compliquée
Complications mécaniques
- l'anurie lithiasique (rein unique anatomique ou fonctionnel) nécessite une levée de l'obstacle en urgence
(externe par néphrostomie ou interne par sonde urétérale)
- obstructoin incomplète : le traitement est identique à celui de la lithiase non compliquée mais doit être
effectué sans trop attendre.
- un obstacle complet unilatéral impose un drainage urgent, puis un traitement différé de la lithiase qui sera
facilité par la diminution des conditions inflammatoires et oedémateuses locales.
Complications infectieuses
Les complications infectieuses sont une urgence médico-chirurgicale imposant le démarrage de
l'antibiothérapie et, en fonction du degré de dilatation, le drainage (de préférence percutané) de l'urine
(soulage le rein et prélèvement bactériologique).
• Traitement préventif de la récidive
Apport hydrique
Dans tous les cas, augmenter l'apport hydrique quotidien
Répartir l'apport sur la journée (c'est à dire une diurèse supérieure à 2 l/24 h).
En dehors des cas où l'alcalinisation est nécessaire ou lorsqu'il existe une hypercalciurie, l'eau du robinet est
tout à fait indiquée.
Anomalie métabolique
En cas d'anomalie métabolique
- lithiase urique et cystinique (voir plus haut)
- hypercalciurie (avec ou sans hypercalcémie) : traitement de l'étiologie (hyperparathyroïdie, sarcoïdose,
immobilisation prolongée des malades neurologiques)
- hypercalciurie absorptive idiopathique : régime pauvre en Ca, eau peu minéralisée (Volvic, Evian)
- hypercalciurie rénale idiopathique : diurétique thiazidique
- hyperoxalurie secondaire (réduire l'apport d'aliments riches en oxalates : thé, chocolat, café, asperge,
oseille), primitive (peu de traitement, vitamine B6).
• Uropathie
En cas d'uropathie
- traitement chirurgical chaque fois que possible (traitement antireflux chirugical ou endoscopique, traitement
du syndrome de la jonction chirurgicale ou endoscopique)
- traitement des infections à germes uréasiques par antibiothérapie séquentielle au long cours.
cahier
d'
urologie
25
La tuberculose urogénitale (TUG)
La tuberculose urogénitale (TUG)
I - INTRODUCTION
La tuberculose urogénitale fait partie des infections spécifiques au même titre que la syphilis et la
bilharziose (infections spécifiques : produisent des lésions tissulaires caractéristiques et propres à chacune
d'elles).
La tuberculose urinaire demeure fréquente ; elle est dangereuse car elle expose à des retards
diagnostiques d'autant plus graves que le traitement médical antituberculeux est remarquablement efficace.
II - PHYSIOPATHOLOGIE
La TUG correspond à une atteinte rénale par voie hématogène en provenance des poumons ou de
l'appareil digestif. (Cf SCHEMA 1).
C'est une maladie d'organes atteignant :
- chez l'homme : les 2 reins, les uretères, la vessie, la prostate, les déférents, les épididymes, les
testicules
- chez la femme : l'appareil génital peut être indemne de tuberculose.
FAIT important : l'atteinte est en général bilatérale d'emblée.
La localisation rénale est secondaire dans l'histoire de la tuberculose, postérieure à un complexe primaire
le plus souvent pulmonaire passé inaperçu ou insuffisamment traité.
Le délai entre l'atteinte primaire et l'atteinte urinaire est très variable.
La tuberculose urinaire peut se voir à tout âge.
cahier
d'
urologie
26
La tuberculose urogénitale (TUG)
III - ANAPATHOLOGIE
A - Lésions rénales
On observe de petits tubercules dans le cortex rénal ; tuberculomes qui s'accroissent peu à peu, puis se
caséifient et enfin se rompent dans le système pyélocaliciel. (en somme, on a au centre d'un tubercule une
nécrose caséeuse et à la périphérie une réaction inflammatoire).
Les principaux aspects en sont donc la caséification puis la cicatrisation.
B - Lésions des voies excrétrices
1) Uretères
La tuberculose aboutit à une sténose, à une périurétérite et à une fibrose murale. La localisation des
lésions est principalement à la jonction pyélo-urétérale et à la jonction urétéro-vésicale. Parfois l'uretère entier
est atteint (par uretérite).
2) Vessie
On observe une atteinte du DETRUSOR qui va se scléroser et donner une petite vessie tuberculeuse
au niveau de laquelle le trigone sera respecté : petite vessie urétrotrigonale.
3) Urètre
Atteinte rare ; chez l'homme l'atteinte urétrale produit un rétrécissement d'ordinaire au niveau du bulbe ;
les complications habituelles en sont des abcès périurétraux et fistules.
C - Lésions génitales
La tuberculose génitale peut intéresser la prostate, les vésicules séminales et les épididymes, isolément
ou associées à une tuberculose rénale.
La prostate est augmentée de volume nodulaire et de consistance irrégulière.
Les vésicules séminales sont fibreuses et augmentées de volume.
On retiendra que les lésions tuberculeuses :
- sont creusantes dans le parenchyme rénal et qu'elles peuvent ou non communiquer
avec la voie excrétrice
- sont sténosantes sur la voie excrétrice ; le traitement n'améliore pas ces sténoses ; au
contraire leur cicatrisation se fait sur un mode scléreux.
IV - CLINIQUE
1) Période d'invasion
Les symptômes sont ceux de l'imprégnation tuberculeuse :
- baisse de l'état général
- asthénie, anorexie, amaigrissement
- fébricule vespéral
- sueurs nocturnes
- VS augmentée
cahier
d'
urologie
27
La tuberculose urogénitale (TUG)
2) Période d'état
a) Signes fonctionnels
Etude du passé urologique et tuberculeux du patient.
TROUBLES UROLOGIQUES (du ⊕ fréquent au - fréquent).
- La CYSTITE est le symptôme révélateur le plus habituel chez la femme.
Le BK doit être recherché avec acharnement si l'on découvre une pyurie "aseptique" et une hématurie
microscopique.
Cette cystite s'accompagne de pallakiurie, brûlures mictionnelles d'intensité forte, elle est parfois rebelle
au traitement habituel et récidivante.
- Douleurs lombaires sourdes continues ou intermittentes
- Hématurie totale d'origine rénale
- Colique néphrétique.
TROUBLES GENITAUX
- Nodule épididymaire froid
- Epididymite chronique ou aiguë (résistante au traitement)
- Nodule froid intraprostatique
- Fistule scrotale
et aussi hydrocèle, vésicule séminale épaissie, hémospermie LA TUBERCULOSE génitale, précède
accompagne ou suit, la tuberculose rénale.
TROUBLES NEPHROLOGIQUES
Insuffisance rénale découverte lors d'une protéinurie.
3) Examens complémentaires
a) Biologie : l'ECBU
L'examen bactériologique est l'examen clé du diagnostic.
3 recherches (au moins), 3 jours de suite, recueillies à mi-jet, sur les urines du matin (restriction hydrique
du patient depuis la veille).
- A l'examen direct, coloration de Ziehl (présence de bacilles acido-alcoolo-résistants)
- Culture sur milieu spécial
- Inoculation au cobaye exceptionnellement (si pyurie abactérienne).
L'examen bactériologique est complété d'un antibiogramme.
Une pyurie abactérienne doit rendre méfiant et faire rechercher une tuberculose.
Biologie : bilan urologique :
On étudie le retentissement de la maladie sur la fonction rénale ; on mesure
- l'azotémie
- la créatinémie
cahier
d'
urologie
28
La tuberculose urogénitale (TUG)
- concentration de l'urée et de la créatinine urinaire
- ionogramme sanguin et urinaire.
On recherche systématiquement par les urocultures l'existence d'une surinfection par des germes banals.
b) L'UIV
• l'ASP recherche :
- un rein mastic (opacité franche) complètement détruit
- des calcifications, des lithiases
- une image osseuse (POTT, coxarthrose)
• Cliché de sécrétion : apprécie la valeur fonctionnelle du rein.
• Cliché précoce :
- au niveau du rein (Cf. SCHEMA 2)
. image d'addition : caverne
. image d'amputation de groupes caliciels
. image de soustraction due à des sténoses (image en épine, calice gommé, rétraction pyélique)
. encoches : déformation des contours des reins
. rarement le rein peut être normal.
- au niveau de l'uretère (atteinte dans 50 % des cas)
. sténose de la jonction urétérovésicale (8/10) soit de la jonction pyélourétérale (2/10)
. "trop belle image" secondaire à des lésions diffuses ou localisées.
- au niveau de la vessie, les lésions évoluent en plusieurs temps :
. au début il s'agit d'une vessie ronde, crispée par la cystite (réversible par le traitement) médical
puis elle peut devenir irrégulière rétractée et destruction irréversible responsable de la petite vessie
tuberculeuse, nécessitant un traitement chirurgical.
• Clichés mictionnels
Caverne prostatique ou sténose urétrale.
Il existe un reflux vésico-urétéral.
L'UIV est le 2ème examen paraclinique clé mais il faut savoir qu'elle peut être normale ce qui ne permet
pas de rejeter le diagnostic. A l'opposé l'un des 2 reins peut être muet.
c) Autres examens
- L'écho rénale : permet de rectifier le diagnostic en excluant une tumeur en cas de rein muet
- Cutiréaction toujours positive
- Cystoscopie : à éviter car risque de surinfection
- VS augmentée
- UPR : en cas de rein non fonctionnel, même risque infectieux que la cystoscopie
- UCRM : indispensable pour vérifier le bas appareil, en cas d'indication chirurgicale
- Scintigraphie rénale
- Examen général : fonction hépatique, rénale, radiopulmonaire.
4) Diagnostic positif
- BK dans les urines radio évocatrices d'une tuberculose.
Diagnostic évident le traitement s'impose.
- BK présent UIV et cystoscopie normale.
Refaire les prélèvements, et les cultures pour bien s'assurer qu'il s'agit de BK. Répéter les UIV. S'il s'agit
bien de BK, mettre en place le traitement.
- BK absent dans les urines. Radio positive. Cutiréaction et/ou IDR phlycténulaire.
Traitement si radio très caractéristique.
cahier
d'
urologie
29
La tuberculose urogénitale (TUG)
5) Diagnostic différenciel
- Cystite et pyélonéphrite chronique
- Epididymite aiguë ou chronique (pas de BK dans les urines)
- Bilharziose urogénitale.
V - EVOLUTION - COMPLICATIONS
1) Non traitée
- Destruction progressive du parenchyme rénal de la vessie et du rein controlatéral
- Mort par insuffisance rénale ou tuberculose généralisée
- Quelques cas de guérison spontanée, mais récidive possible.
2) Traitée par ATB
- Stérilisation de l'urine et amélioration des lésions avec des séquelles (cavernes, sténoses )
- Le pronostic des lésions unilatérales est meilleur
- Récidive possible.
VI - TRAITEMENT
1) Méthodes
a) Médical
Le traitement médical est le même qu'il s'agisse d'une tuberculose pulmonaire, osseuse ou rénale.
Le polychimiothérapie permet d'éviter la sélection des germes mutants.
Le traitement médical dure 6 mois.
a1) Médicaments antituberculeux
α) antituberculeux majeurs
α1) Isoniazide = RIMIFON*
5 mg/kg/j (en général 3 comprimés de 150 mg/j)
Posologie à adapter en fonction de la vitesse d'acétylation du sujet : soit rapide (doses élevées), soit lente
(doses faibles).
Toxicité neurologique (polynévrite) d'où association systématique à la vitamine B6.
Toxicité hépatique si association à Rifadine*.
Risque d'agitation.
CI à hautes doses : tératogène
• insuffisance hépato-cellulaire grave
• psychose sévère
• polynévrite
• alcool
α2) Rifampicine = RIFADINE*
10 mg/kg/j (en général 2 cp à 300 mg/j)
Toxicité :
• hépatique, si association à Rimifon*
• troubles digestifs
• accidents immuno-allergiques ⊕ risque fœtotoxicité
cahier
d'
urologie
30
La tuberculose urogénitale (TUG)
CI : insuffisance hépato-cellulaire grave.
Interaction médicamenteuse car inducteur enzymatique : baisse de l'effet des anticoagulants, des
corticoïdes, de la digitaline, des contraceptifs oraux.
α3) Ethambutol = DEXAMBUTOL*
15 mg/kg/j (cp de 250 et 500 mg)
Toxicité : névrite optique rétro-bulbaire (rare), accidents cutanés (rares)
CI : perte de la vision d'un œil.
α4) Pyrazinamide = PIRILENE*
30 mg/kg/j (par voie orale)
Toxicité : hépatotoxicité, allergie cutanée, fièvre, troubles digestifs, hypermicénie
β) Formes associées
β1)
- Rifatex* 1 comprimé
= 120 mg de Rifampicine + 50 mg de Rimifon + 300 mg de Pyrazinamide
β2)
- Rifinols 1 comprimé
= Rifampicine 300 mg + Rimifon 150 mg
Ces formes associées simplifient la prise médicamenteuse et facilitent l'observance du traitement.
γ) Autres antituberculeux
Streptomycine, Amikacine, Fluoroquinolones (Ofloxocine, Sparfloxocine) ou Rifabutine sont utilisées dans les
formes multirésistantes ou en cas d'intolérance sévère aux antituberculeux majeurs.
δ) Corticoïdes :
utilisés sous contrôle urologique.
a2) Modalités pratiques :
Le traitement comporte 2 mois de quadrithérapie (Isoniazide, Rifampicine, Pyrazinamide, Ethambutol), puis
4 mois de bithérapie (Isoniazide, Rifampicine).
L'antibiothérapie en cas de résistance dépend des données de l'antibiogramme, d'où l'importance de
l'isolement de la souche responsable de l'infection.
a3) Bilan au bout de 2 mois :
Effectuer une surveillance :
- hépatique
- neurologique
- vision des couleurs
- clinique (poids, température, digestion)
- bactériologique
Si apparition de sténose de la voie excrétrice ou de destruction du parenchyme rénal, on discute un
traitement chirurgical.
Surveillance du traitement : UIV 6° semaine, 2 mois, 5 mois, 1 an après le début du traitement
cahier
d'
urologie
31
La tuberculose urogénitale (TUG)
b) Chirurgicale en complément du traitement médical.
3 objectifs :
- débarrasser l'organisme des éléments détruits : néphrectomie totale ou partielle
- supprimer les foyers infectés en préservant le maximum du parenchyme : néphrectomie partielle
- rétablir la perméabilité des voies excrétrices et la capacité vésicale : iléo-urétéroplastie, iléo-cystoplastie
d'agrandissement.
Attention, on ne doit opérer qu'après la mise en route d'un traitement triple efficace.
2) Indications
Un bilan pré-thérapeutique est nécessaire :
- diffusion de la maladie
- VS
- bilan hépatique (si Rifadine)
- examen ophtalmo (si Ethambutol)
- audiogramme (si Streptomycine)
- fonction rénale.
Le traitement médical est instauré après preuve bactériologique et/ou anatomo-pathologique.
Il faut effectuer des antibiogrammes pour déceler des résistances.
La chirurgie est indiquée si persistance d'une bacillurie ou apparition d'une sténose.
Pour les lésions génitales, l'épididymectomie peut être proposée.
3) Résultats
Bon pronostic mais récidives possibles.
Les critères de guérison :
- reprise du travail sans perte de poids
- absence de BK dans les urines à 3 reprises
- images radio stables
- absence de pyurie.
cahier
d'
urologie
32
La tuberculose urogénitale (TUG)
SCHEMA 1
PHYSIOPATHOLOGIE DES LESIONS TUBERCULEUSES
Caverne tuberculeuse
Nodule tuberculeux sous cortical
Nodule juxta-glomérulaire
Ulcération du calice
Sténose tige calicielle en épine de rosier
• pyélite
• retrécissement jonction PU
• retrécissement tubaire
• ulcération de vessie
• petite vessie fibreuse avec rétraction
Prostatite avec nodule
Epididymite avec nodule
Urétérite tuberculeuse
Déférentite tuberculeuse
cahier
d'
urologie
33
La tuberculose urogénitale (TUG)
SCHEMA 2
CLICHES D'UIV
Caverne
Image d'amputation
(épine de rosier)
Calice gommé
Encoche
Dilatation du calice
en amont de la sténose