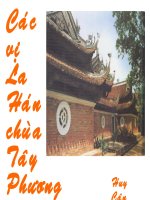La pollution lumineuse
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.61 KB, 5 trang )
La pollution lumineuse, cette méconnue
On pointe souvent les conséquences sur la vie animale de la pollution lumineuse engendré
par les activités humaines. Comme les tortues qui, une fois pondu, ne retrouvent pas le
chemin de la mer. Mais on évoque plus rarement l’impact des constructions humaines sur
la qualité de la lumière qui berce la nature. Selon une étude parue dans la revue Frontiers
in Ecology and the Environment, la polarisation de la lumière provoquée par la réflexion
des onde sur les infrastructures humaines perturbe gravement la vie et la reproduction de
nombreux animaux et insectes. (1)
La lumière naturelle est une onde qui vibre aléatoirement dans toutes les directions. Mais
quand elle interagit avec de la matière, certaines directions sont privilégiées. C’est par
exemple le cas des molécules d’air qui, par beau temps, polarisent la lumière et tendent à
brouiller les contrastes d’un ciel de cumulus. Les photographes le savent, qui utilisent un
filtre polariseur qui permet d’obtenir de plus belles images. Ou les marins et skieurs, qui
portent des lunettes polarisantes pour réduire la réflexion du soleil sur l’eau et la neige et
atténuer les phénomènes d’éblouissement.
De nombreux animaux, principalement des insectes, utilisent la polarisation de la lumière
pour se repérer. C’est par exemple le cas des abeilles qui s’en servent pour déterminer la
position du soleil et s’orienter. D’autres s’en servent pour leurs migrations, ou pour trouver
le meilleur endroit où se reproduire. A condition que rien ne vienne altérer
l’environnement. Car les immeubles, les routes, les voitures, les piscines et même les
nappes de pollution modifient la polarisation de la lumière et perturbent la faune,
expliquent Gabor Horvath, György Kriska et Péter Malik (Université d’Eötvös, Hongrie) et
Bruce Robertson (Université d’Etat du Michigan, Etats-Unis).
Plus les surfaces sont lisses, et plus la lumière se polarise quand elle se réfléchit dessus. Au
point, selon les chercheurs, de créer de véritables pièges écologiques. Ils relatent ainsi que
certains insectes pondent leurs œufs sur l’asphalte de routes, sans aucune chance de les voir
un jour éclore. D’autres se précipitent vers ce qu’ils croient être un étang, pour trouver une
flaque d’hydrocarbure toxique pour leurs œufs.
Cette perturbation de la vie des insectes rejaillit sur les autres espèces animales. Privés de
leur première source d’alimentation, des poissons et des batraciens pourraient en souffrir.
Parmi les solutions proposées: utiliser des matériaux moins réfléchissants pour la
construction, et recouvrir les voies de communication de revêtements plus rugueux. Mais
là, ce sont les riverains —humains— qui se plaindraient d’une autre pollution, sonore cette
fois.
(1) En novembre dernier, des chercheurs israéliens ont montré qu’un insecte suspecté
de véhiculer le choléra lorsqu’il pond choisit ses mares en se guidant sur la
polarisation de la lumière
Dans le blizzard austral, la guerre des baleines est
engagée
Chaque année, les feuilles tombent en automne, les magasines féminins proposent des
régimes à l’approche de l’été et les écologistes prennent en chasse la flotte baleinière
japonaise en décembre. Et si Greenpeace a choisi de laisser son navire à quai cette année, la
Sea Shepherd Conservation Society du pirate des mers Paul Watson a engagé le combat
dans les eaux de l’océan austral.
Cette année, le Japon avait choisi la discrétion (1) pour sa campagne australe qui vise à
capturer neuf cents baleines à des fins officiellement scientifiques. L’organisation
écologiste Greenpeace avait prévenu qu’elle ne participerait pas à la chasse aux chasseurs
de baleines. Greenpeace a choisi de rester à terre et de médiatiser le procès fait à deux de
ses militants. Ils avaient été arrêtés en juin dernier pour avoir volé des cartons de viande de
baleine dans le but de démontrer l’existence d’un trafic.(2)
En mer, le Nisshin Maru, le navire-amiral de la flotte japonaise, n’aura pas pour autant les
mains libres. Car Paul Watson est dans son sillage. Cet écologiste prêt à en découdre (il a
déjà éperonné volontairement des navires-baleiniers) a engagé les hostilités cette semaine,
non loin des eaux Antarctiques françaises. Six navires japonais seraient à l’œuvre.
Vendredi soir, le Steve Irwin, le navire conduit par Paul Watson, a tenté une première
attaque en envoyant une vedette s’approcher d’un navire japonais pour y jeter des bombes
puantes. Devant le durcissement des conditions météorologiques (vents de 50 nœuds, soit
90 km/h), les militants ont renoncé. L’an dernier, deux d’entre eux avaient été capturés par
les chasseurs japonais après être montés à bord de l’un de leurs navires. Ils avaient été
relâchés deux jours plus tard. De son côté, Paul Watson avait essuyé un tir d’arme à feu,
sans dommages parce qu’il portait un gilet pare-balles.
L’ancien co-fondateur de Greenpeace revendique ses méthodes brutales. Il est même très
fier d’être traité de pirate, un qualificatif qui lui va bien puisque le type d’actions qu’il
conduit relève —pour ses ennemis— de la piraterie internationale et des tribunaux.
Début décembre, deux ministres canadiens ont très officiellement demandé que Watson
soit remplacé à la tête de la Sea Shepherd, l’organisation qu’il a lui-même fondée en 1977.
Le Canada lui reproche ses propos très durs sur l’abattage de plusieurs centaines de narvals
emprisonnés par les glaces dans l’Etat canadien de Nunavut. Selon les autorités
canadiennes, les chasseurs inuits, qualifiés par Watson de «bouchers», les ont tués pour
éviter l’agonie tandis que l’écologiste critique l’absence de tentative de sauvetage des
animaux avant ce qu’il qualifie de massacre.
Au printemps dernier, le Farley Mowat, l’un des navires de Watson a été arraisonné et saisi
au large des côtes canadiennes, pour s’être approché trop près de navires pratiquant la
chasse au phoque. Quelques jours plus tôt, le bateau sous pavillon néerlandais avait été
attaqué par une trentaine de chasseurs en colère. Le Japon a demandé à plusieurs reprises
que les navires de la Sea Shepherd soient considérés et pourchassés comme des pirates, et
que leur pavillon leur soit retiré.
Sombres prévisions sur le front des tsunamis
La prévision des séismes est loin d’être une science exacte. Aussi, tout le monde espère que
les chercheurs qui publient leur analyse de la situation géophysique à Sumatra dans la
revue Science de cette semaine se trompent. Selon cette équipe internationale (Etats-Unis,
Indonésie, Taïwan, Singapour), plusieurs secousses de grande ampleur pourraient survenir
au cours des prochaines décennies.
En 2004, quand la terre a tremblé au large de l’Indonésie, personne n’était prêt dans cette
région de l’Océan indien à gérer l’alerte. Plus de deux cent mille personnes ont perdu la
vie. Depuis, les différents pays de la région ont engagé un important effort pour mettre sur
pied des dispositifs d’alerte. L’Indonésie s’affirme aujourd’hui capable de donner l’alerte
en moins de trois minutes. Elle a d’ailleurs rejoint le dispositif de surveillance de la
Commission préparatoire de l’Organisation des Nations-Unies pour l’interdiction des essais
nucléaires (CTBTO). Ce dernier s’appuie sur un réseau de 337 cellules de détections
souterraines, sous-marines et atmosphériques destiné à repérer les essais nucléaires.
Aussi perfectionné soit-il, un réseau d’alerte ne pourrait que réduire les pertes humaines en
cas de gros séisme générateur de tsunami. Car s’il survient près des côtes indonésiennes,
les vagues gigantesques toucheraient les côtes de bien avant les trois minutes nécessaires à
donner l’alerte. Or, de tels séismes sont annoncés au cours des prochaines décennies par les
travaux publiés dans Science.
Les chercheurs ont étudié les récifs coralliens des îles de Mentawai, à Sumatra. Ils relèvent
que dans cette région, la faille sismique de la Sonde a produit des suites de violents séismes
tous les deux siècles depuis sept cent ans. Jusqu’à un séisme survenu en septembre 2007
(Magnitude 8,4), la “section de Mentawai”, plus de sept cent kilomètres de failles,
“dormait” depuis deux forts séismes, en 1797 et 1833. Selon les chercheurs, le séisme de
septembre 2007 est le signe qu’une période active a commencé, qui pourrait voir survenir
plusieurs séismes, dont un au moins de magnitude 8,8. De quoi dévaster des régions
entières de l’océan indien. «Les pertes en vies humaines et les dégâts pourraient égaler ou
dépasser celles relevées dans la province indonésienne d’Aceh en 2004», écrivent les
chercheurs. La magnitude avait alors atteint 9…
Il reste qu’estimer la probabilité d’événements qui surviennent tous les deux siècles à partir
de relevés qui portent sur seulement sept siècles est un exercice périlleux. Ce qui est
rassurant, c’est que si un séisme géant survient au cours des prochaines décennies, tout le
monde aura encore la mémoire de la tragédie de 2004. Le réflexe de se réfugier sur les
hauteurs n’aura pas eu le temps de se dissoudre dans l’histoire.
EXICO CORRESPONDANTE
A Mexico, l'eau devient une denrée rare
Dans le minuscule jardin fleuri d'Irene Rodriguez, sur les hauteurs de la Sierra de
Guadalupe, le linge est accroché sur des fils dans l'ordre où il a été lavé : d'abord le blanc,
ensuite les vêtements de couleur claire, puis les jeans. Car l'eau brassée dans la machine à
laver doit être utilisée plusieurs fois : pour la toilette des cinq enfants, puis les différentes
lessives, avant de finir au fond des cabinets.
"Ici, cela fait huit ans que l'eau ne coule plus du robinet, raconte Irene Rodriguez, et que
nous la recevons deux fois par semaine par camion-citerne. Nous sommes obligés de la
recycler." Autour de sa maisonnette, comme dans les patios de ses voisins, une multitude
de récipients - seaux, barils, citernes en PVC - témoigne de la nécessité de stocker le
précieux liquide.
Ce dédale de constructions anarchiques, dont les pentes vertigineuses ont été pavées de
ciment par les habitants, s'appelle El Mirador. La vue serait imprenable sur la capitale si un
smog aux reflets sulfureux ne brouillait les perspectives de la vallée de Mexico. Les
quartiers chics autour du bois de Chapultepec ne sont qu'à une heure de voiture quand il n'y
a pas d'embouteillages : villas équipées de six salles de bain, larges pelouses, piscines,
garages remplis de véhicules que des escouades de domestiques aspergent au tuyau. Un
autre monde.
Les zones résidentielles ne devraient pas trop souffrir des rationnements que vient
d'annoncer la Commission nationale de l'eau (Conagua). A cause de précipitations
insuffisantes, le niveau des barrages du centre du pays a dangereusement baissé en début de
saison sèche : ils sont à 63 % de leur capacité, contre 85 % d'habitude. "Nous avons
aujourd'hui un déficit de 170 millions de mètres cubes. Il nous faudra réduire de moitié,
pendant trois jours en fin de semaine et jusqu'en mai, les quantités que nous fournissons à
la capitale et à l'Etat (limitrophe) de Mexico, explique José Ramon Arvarin, directeur
général adjoint de Conagua. Mais la répercussion de ces coupures, en soi supportables, sera
majorée par les failles du réseau urbain."
C'est la première fois que les autorités fédérales sont amenées à prendre de telles mesures
depuis la mise en service, il y a trente ans, du "système de Cutzamala", qui collecte les
réserves de sept barrages et les achemine par un aqueduc de 110 kilomètres vers la zone
urbaine où vivent 20 millions d'habitants. Or, cet apport ne couvre qu'un quart des besoins
d'une des mégapoles les plus assoiffées du monde : "Mexico consomme presque 300 litres
par jour et par habitant, le double des grandes capitales européennes", souligne Ramon
Aguirre, directeur du réseau d'adduction d'eau de la capitale.
Le rationnement n'est qu'un révélateur de problèmes anciens, résultat d'une longue incurie
des pouvoirs publics et de difficultés géologiques, notamment de graves affaissements de
terrain. Les pertes dues aux fuites domestiques comme aux failles du réseau atteignent 38
% (contre 26 % en moyenne dans le reste du pays). Les eaux de pluie vont droit à l'égout,
et 6 % seulement des eaux usées sont traitées. Une énorme unité d'assainissement est en
projet dans l'Etat d'Hidalgo, au nord-est de Mexico.
En attendant, les tensions vont s'accentuer autour d'une distribution très inégalitaire : à
peine 15 % des 2 millions d'habitants d'Ecatepec (la plus grosse municipalité de la région,
dont El Mirador est un des quartiers) sont desservis en permanence. Les autres sont
tributaires de 40 camions-citernes, qui mettront encore plus de temps à se remplir les jours
où le débit va diminuer.
"Ça promet !", soupire Jorge Padilla, ingénieur depuis dix ans au Sepase, le service public
de l'eau d'Ecatepec, souvent confronté à des manifestations d'usagers, voire des menaces de
lynchage. Selon lui, l'eau est un thème sensible dans cette banlieue populaire contrôlée par
la gauche, mais que convoitent la droite, au pouvoir au niveau fédéral, et le Parti
révolutionnaire institutionnel (PRI, centre), qui gouverne l'Etat de Mexico. "Jamais nous
n'avions eu autant de coupures d'eau et d'électricité, remarque-t-il. Tout cela est manipulé, à
quelques mois des élections."
Certains espèrent que le rationnement va marquer le début d'une prise de conscience. "Il
faut améliorer les canalisations, mais aussi diminuer la demande en modifiant la structure
des tarifs, affirme Ramon Aguirre. Nous devons changer des habitudes de consommation
excessive. Barcelone s'en sort avec 114 litres par jour et par habitant."
Joëlle Stolz