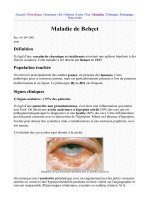MALADIES INFECTIEUSES - PART 10 ppt
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.48 MB, 22 trang )
2
Pour lever ces obstacles et offrir les services dont
ils ont besoin, il est important de s’attarder à
mieux connaître leur réalité et réfléchir à l’adap-
tation de nos services.
1) Ces jeunes ne consultent pas, à moins d’y être
vraiment obligés. Lors de ces visites, certains
d’entre eux peuvent être accompagnés d’un
adulte : travailleur de rue, intervenant commu-
nautaire, policier ou encore ambulancier. Ces
personnes soutiennent le jeune dans ses
démarches actuelles et futures pour que la rue
ne soit qu’un espace de transition et non un
domicile fixe.
2) Afin de bénéficier de certains services, princi-
palement les services de santé, il faut fournir
des papiers que les jeunes de la rue n’ont pas
nécessairement. C’est la même chose pour le
fonctionnement des services avec rendez-vous qui
ne correspond pas à leur mode de vie, ceux-ci
n’ayant ni agenda, ni téléphone et ayant souvent
perdu la notion du temps.
3) La recherche quotidienne de réponses à leurs
besoins essentiels (trouver un lit à chaque jour,
des repas, des vêtements, etc.) dans un contexte
où leurs moyens sont extrêmement réduits
(déplacements à pied, recherche de téléphone
gratuit) exige beaucoup plus de temps et
d’énergie qu’on ne pourrait l’imaginer. Cet aspect
complexifie leurs relations avec l’organisation
des services.
Consultent-ils?
De par leurs conditions et leur style de vie, ces
jeunes risquent de contracter des infections
transmissibles sexuellement ainsi que des
infections transmissibles par le sang. On cons-
tate également l’ampleur des problèmes de
santé mentale et physique qui les affectent
ainsi que les possibilités de consommation
inquiétante d’alcool et de drogues. Malgré ces
situations susceptibles de les amener à la cli-
nique ou à l’urgence, plusieurs tardent à consulter.
Interrogés sur leurs rapports aux services, ils
identifient certaines barrières institutionnelles
qui en freinent, selon eux, l’accessibilité.
Les barrières institutionnelles
sont entre autres:
• les heures d’ouverture,
• l’exigence de posséder une carte d’assurance-
maladie,
• la disponibilité et les attitudes du personnel.
Des études soulèvent aussi certaines barrières
individuelles à l’accessibilité aux services telles :
• l’organisation personnelle des jeunes,
• leurs attitudes,
• leurs perceptions,
• leurs connaissances.
Prévenir l’itinérance
Lorsque vous rencontrez un jeune
homme ou une jeune fille qui
présente une histoire de vie le
plaçant à risque pour l’itinérance,
vous pouvez intervenir précocement
afin d’influencer sa trajectoire de vie
et lui proposer des avenues pour faire
d’autres choix. L’entrevue Savoir-
Vouloir-Pouvoir (SVP) et l’orientation
vers des ressources répondant aux
divers besoins de ces jeunes sont
deux gestes faciles à poser et qui
sont susceptibles de produire des
résultats positifs. Si chaque inter-
venant de la santé et des services
sociaux met ses habiletés profession-
nelles et personnelles au service des
jeunes, le passage à la rue constituera
un espace de vie transitoire et non un
chemin vers l’itinérance.
L’omnipraticien, en plus de tenir compte de la réalité de la vie dans la rue, doit
faire preuve de tolérance et de souplesse, un geste important pour créer un lien
significatif avec le jeune. Une telle relation se construit délicatement et exige du
temps.
Les jeunes de la rue ont besoin de rencontrer un médecin « correct », c’est à dire
qui ne porte pas de jugement sur leur façon de vivre, qui les respecte et prend le
temps de leur expliquer la maladie, l’évolution de celle-ci, le traitement et les
effets secondaires des médicaments. Le fait que plusieurs d’entre eux aient été
victimes ou exploités les rend circonspects face aux professionnels de la santé,
d’où l’importance de tenter de développer un lien de confiance avec eux.
Établir une relation significative et assurer un suivi
Prévenir l’itinérance
Source: Images de rue.
Bien qu’ils puissent paraître de
« mauvais clients » leurs besoins
sont réels et demandent souvent
des interventions rapides.
Ne vaut-il pas mieux les
recevoir que de les envoyer
ailleurs, sans savoir ce qui
leur adviendra?
Prévention en pratique médicale, Septembre 2002
Le modèle SVP consiste en une tripe évaluation faite systématiquement au cours de chacune des consultations : est-ce que le jeune sait (S), veut
(V), peut (P) utiliser les ressources et les services proposés pour prévenir son arrivée dans la rue, le soutenir pendant ses périodes d’errance et
favoriser sa sortie de la rue. Cette méthode se divise donc en trois phases.
Phase 1 : (S) Est-ce que le jeune sait? (Objectif : évaluer les connaissances)
L’entrevue s’amorce par une période de vérification des connaissances, et celles-ci sont complétées, corrigées ou transmises de nouveau, au besoin. Cette première phase suppose une
écoute empathique, l’utilisation de termes communs compréhensibles pour le jeune, une attitude ouverte et sans jugement. Les éléments de connaissances à évaluer ont trait aux risques
associés au mode de vie de la rue, tels les difficultés de santé mentale, les idéations suicidaires, l’abus d’alcool et de drogues, la transmission du VIH/Sida et des ITS, ainsi que d’autres
maladies infectieuses.
Phase 2 : (V) Est-ce que le jeune veut? (Objectif : évaluer la motivation)
La motivation du jeune vient avec la qualité des liens d’aide. Afin de favoriser une relation de confiance, il importe de ne pas trop mettre l’accent sur « la motivation à changer », qui
peut être perçu comme un jugement de valeur. Il est important de vérifier les attitudes du jeune face aux risques de santé associés à la rue.
Les attitudes à vérifier et à renforcer sont :
• La croyance que les services de santé et les ressources communautaires peuvent l’aider.
• La perception qu’il a en lui les capacités pour s’en sortir.
• La croyance que la confidentialité professionnelle est respectée.
• La croyance que son passage à la rue est transitoire, et non une trajectoire de vie.
Si son attitude est favorable, il doit se sentir capable de réaliser ce qui lui est proposé. Il doit croire en ses capacités d’adopter et de maintenir un certain comportement. S’il a déjà
vécu un sentiment d’échec, il doit sentir qu’une aide est disponible ou qu’une autre orientation lui est offerte.
Phase 3 : (P) Est-ce que le jeune peut? (Objectif : évaluer l’applicabilité de la solution)
Il s’agit maintenant d’évaluer la possibilité réelle du jeune de réaliser les recommandations et d’entreprendre des démarches d’aide. Pour ce faire, il faut vérifier, pour tous les
obstacles potentiels, les habiletés, la possibilité d’assumer les coûts, la disponibilité, en se rappelant qu’un seul obstacle peut suffire à empêcher une démarche d’aide.
À explorer avec le jeune :
• La capacité financière de payer les médicaments ou d’utiliser les ressources proposées.
• La disponibilité du soutien familial pour les démarches de réinsertion.
• Les contraintes d’horaire et de distance géographique.
• Les délais d’attente pour accéder aux ressources médicales et de désintoxication.
L’application du modèle Savoir-Vouloir-Pouvoir (SVP) à chacune des consultations permettra de suivre l’évolution du jeune, tout en respectant son rythme d’apprentissage.
Note : Il est utopique de penser pouvoir réaliser le modèle SVP dès la première rencontre avec le jeune. Il nécessite d’abord l’établissement d’un lien de confiance pour y arriver graduellement .
Inspiré de : Forget G., Bilodeau A., Tétreault J., Beauregard D., Dr. Gagné M. (1994), S’exprimer pour une sexualité responsable, guide d’animation, Ministère de la Santé et des Services sociaux.
3
L’attitude du professionnel de la santé peut changer bien des choses…
Un jeune se présente
pour une consultation.
A-t-il sur lui sa carte
d’assurance-maladie?
Répondre à son motif
de consultation et, si
possible, dépister les
maladies infectieuses.
Le jeune est-il
accompagné?
Si le jeune y consent,
informer l’accompa-
gnant, le tenir au
courant de la situation.
Lors de ce second
rendez-vous, pour-
suivre l’investigation
à l’aide du canevas
d’entrevue SVP.
1 2 3 4 5
OUI OUI
Offrir au jeune de le
revoir.
Contacter l’infirmière
et l’orienter vers le
CLSC des Faubourgs,
(514) 527-2361.
NON
NON
Servir et soutenir, cinq étapes
Le modèle Savoir-Vouloir-Pouvoir (SVP),
un outil de counseling avec un jeune
Pré vention en pratique mé dicale, Septembre 2002
4
Association
des Médecins
Omnipraticiens
de Montréal
Un bulletin de la Direction de santé publique
de Montréal-Centre publié avec la collaboration de
l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal
dans le cadre du programme Prévention en pratique médicale
coordonné par le docteur Jean Cloutier.
Ce numéro est une réalisation de l’unité
Écologie humaine et sociale.
Responsable de l’unité : Marie-Claire Laurendeau
Rédacteur en chef : D
r
Serge Nault
Édition : Yves Laplante
Infographie : Manon Girard
Rédacteurs : Gilles Forget, Mireille Desrochers
Collaborateurs : Laurence Barraud, D
r
Anne Bruneau,
D
r
Manon Duchesne, D
r
Nancy Haley
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1M3
Téléphone : (514) 528-2400
Courriel :
Dépôt légal – 3
e
trimestre 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1481-3734
Numéro de convention : 40005583
révention
en pratique médicale
Un phénomène urbain qui
en touche déjà plusieurs
et qui augmente
constamment.
Ressources générales
Urgence psychosociale du CLSC du quartier
Consulter l’Association des CLSC et des CHSLD du
Québec (514) 931-1448
Ressources médicales
CLSC des Faubourgs
(514) 527-2361
1250 rue Sanguinet
Équipe Jeunes de la rue
Consultations médicales et psychologiques
sans carte d’assurance-maladie, 14 à 25 ans,
sans rendez-vous (lundi au vendredi 13 h à 17 h)
Chez POPS
(514) 526-POPS
1662, Ontario Est
Consultations médicales et psychologiques
sans carte d’assurance-maladie
Centre de jour 16-25 ans
(lundi, mardi et jeudi 10 h à 17 h, mercredi et
vendredi 12 h à 16 h)
Hôpital Ste-Justine
(514) 345-4722
3175 Ch. Côte Ste-Catherine
Clinique de l’adolescence
L’Hôpital de Montréal pour enfants
(514) 412-4481
2300 Tupper
Programme de médecine pour adolescents
et gynécologie
Santé mentale
Centre Dollard-Cormier
(514) 982-4531
3530 St-Urbain
Programme jeunesse
Accueil sans rendez-vous des moins de 21 ans
(lundi au jeudi 9 h à 21 h, vendredi 9 h à 20 h)
Suicide-Action Montréal
(514) 723-4000
Intervention téléphonique 24/7, référence
Hébergement
Regroupement les Auberges du cœur
(514) 523-8559
Regroupement de maisons d’hébergement pour
jeunes en difficulté de 12 à 30 ans
Réinsertion en emploi
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) du quartier
Consulter le Réseau des CJE du Québec
(514) 393-9155
Réinsertion scolaire
Commission scolaire de Montréal
(514) 596-6000
Programme de réinsertion scolaire pour les jeunes
Commission scolaire English Montreal,
1-877-512-7522
Programme de réinsertion scolaire pour les jeunes
Toxicomanie
Centre Dollard-Cormier
(514) 982-4531
3530 St-Urbain
Programme Jeunesse
Accueil sans rendez-vous des moins de 21 ans
(lundi au jeudi 9 h à 21 h, vendredi 9 h à 20 h)
C.R.A.N. Centre de recherche et d’aide pour
narcomanes de Montréal
(514) 527-6939
Programme de méthadone
Soutien aux médecins pour le suivi des patients
héroïnomanes
Hôpital Général Juif
Centre de médecine familiale Herzl
Édifice Sir Mortimer B. Davis
(514) 340-8273
Programme de méthadone
Pour d’autres ressources, consulter les fiches
#1, 8, 9, 10, 11 et 12 du cartable Prévention
en pratique médicale.
Quelques ressources
Pour de plus amples informations sur les jeunes de la rue,
consulter les bulletins de réflexion
Freiner la marginalisation, un effort collectif,
de la Direction de santé publique de Montréal-Centre réalisé grâce au soutien de
STRATÉGIE NATIONALE SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LA PRÉVENTION DU CRIME
Pour recevoir des exemplaires : Danielle Fortin, (514) 528-2400 poste 3395,
www.santepub-mtl.qc.ca
révention
en pratique médicale
c’est aussi une chronique
bimensuelle Internet
Consulter aussi la section jeunesse du site WEB de la santé publique, www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse.
Pré vention en pratique mé dicale, Septembre 2002
Si rộponse inadộquate
ou intolộrance
OUI
Septembre 2004 Direction de santộ publique de Montrộal
Source : Choquette D, Bessette L, et le groupe CURATA.
Traitement de l'arthrose: arbre dộcisionnel. Version 2003 en cours de rộvision.
A - FACTEURS DE RISQUE DE COMPLICATIONS DIGESTIVES
(perforation, obstruction, saignement)
ge > 65 ans
ATCD dulcốres peptiques non compliquộs
ATCD de complications digestives
(perforation, obstruction, saignement)
Prise de corticostộroùdes
Prise danticoagulant
Prise dautres AINS incluant lA.A.S. petite dose
ATCD maladie cardiovasculaire
B - AINS ET INSUFFISANCE RẫNALE
Calculer la Clairance de crộatinine (ml/min) :
(140-õge) x poids (kg) x 1,2 (x 0,85 si femme)
S Cr (umol/l)
Si Cl crộatinine < 30 ml/min, ộviter AINS
Si Cl crộatinine 30-60 ml/min, surveillance
Suivi biologique :
ẫlectrolytes, urộe et crộatinine q 5-7 jours x 2 lorsquon initie le
traitement et q 3 mois par la suite. Si augmentation de la dose
dAINS, reprendre la mờme sộquence de contrụles.
C - AINS ET INSUFFISANCE CARDIAQUE
Si de la rộtention hydrosodộe, risque de dộcompensation car-
diaque chez les patients avec dysfonction ventriculaire gauche
sộvốre.
+ Linsuffisance est sộvốre + le risque est ộlevộ
Informer le patient de surveiller les signes et symptụmes
suivants : dyspnộe, apparition ddốme, poids
Traitement de larthrose : Arbre dộcisionnel
Modalitộs non pharmacologiques (enseignement, diốte, physio/ergothộrapie)
Utiliser lacộtaminophốne jusqu une dose maximale (1 gm QID)
Application dun AINS topique
Injection intra-articulaire si possible (corticostộroùdes ou viscosupplộance)
Si rộponse inadộquate
Facteurs de risque de complications digestives
(perforation-obstruction-saignement) Tableau A
Utiliser un COXIB
OUI
NON
ATCD dulcốres compliquộs,
danticoagulant ou õge 75 ans
Favoriser lutilisation dun AINS
non-sộlectif
Pas de
gastro-protecteur
NON
Ajouter un
gastro-protecteur
Si rộponse inadộquate
ou intolộrance
Utiliser un autre AINS
non-sộlectif ou un COXIB
Utiliser un AINS non-sộlectif
avec un gastro-protecteur
Si rộponse inadộquate, considộrer rộfộrence en spộcialitộ
R
x
Rộộvaluer rộguliốrement
lindication et les risques
associộs au traitement
avec un AINS (Tableau E),
la T.A. (Tableau D), les
fonctions cardiaque
(Tableau C) et rộnale
(Tableau B)
Rộộvaluer rộguliốrement le traitement
D - AINS ET TENSION ARTẫRIELLE
Prise de TA q 7 jours x 2 puis q 3 mois
Si de la dose AINS, ou changement dAINS,
reprendre surveillance
Si de TA > 140/90, cesser AINS si possible. Si AINS essentiel,
traiter HTA selon lignes de conduite habituelles
Chez patients diabộtiques : viser TA < 130/80
Si protộinurie de > 1 g/j, viser TA < 125/75
(diabộtique ou non)
E - ẫVALUATION DU RISQUE
GASTRO-INTESTINAL ET CARDIAQUE
Bas Moyen ẫlevộ
Bas
AINS Coxib Coxib + GP
non-sộlectif
Moyen
AINS Coxib Coxib + GP
non-sộlectif
ẫlevộ
Coxib + AAS Coxib + AAS Coxib + AAS
+ GP
Cardiovasculaire
Adaptộ de : C. Baigent, C. Patrono. Selective cyclooxygenase 2 inhibitors, aspirin,
and cardiovascular disease. Arthritis and Rheumatism 2003 48 : 12-20
rộvention
en pratique mộdicale
Gastro-intestinal
Association
des Mộdecins
Omnipraticiens
de Montrộal
Un bulletin de la Direction de santộ publique
de Montrộal publiộ avec la collaboration de
lAssociation des mộdecins omnipraticiens de Montrộal
dans le cadre du programme Prộvention en pratique mộdicale
coordonnộ par le docteur Jean Cloutier.
Ce numộro est une rộalisation de lunitộ Santộ au travail
et santộ environnementale.
Responsable dunitộ : D
r
Louis Drouin
Rộdacteur en chef : D
r
Louis Patry
ẫdition : Deborah Bonney
Infographie : Julie Milette
Auteurs : D
r
Michel Rossignol, D
r
Louis Patry, D
r
Martine
Ballargeon, Ghislaine Tougas, Direction de santộ publique
de Montrộal
Collaboration spộciale : La Sociộtộ darthrite, Division du
Quộbec et les Docteurs Monique Camerlain, rhumatologue
conseil, Centre hospitaler de lUniversitộ de Sherbrooke et
ẫric Rich, Professeur adjoint de rhumatologie, Hụpital
Notre-Dame du CHUM, Universitộ de Montrộal
1301, rue Sherbrooke Est, Montrộal (Quộbec) H2L 1M3
Tộlộphone : (514) 528-2400
courriel:
ISSN : 1481-3734 (version imprimộe)
ISSN : 1712-2937 (version en ligne)
Dộpụt lộgal Bibliothốque nationale du Quộbec, 2004
Dộpụt lộgal Bibliothốque nationale du Canada, 2004
Numộro de convention : 40005583
rộvention
en pratique mộdicale
Forum sur l'arthrite
Jeudi le 21 octobre 2004
de 8 h 00 16 h 30
Hụtel Intercontinental de Montrộal
Organisộ par
La Sociộtộ d'arthrite, Division du Quộbec
Thốmes
Arthrite juvộnile
Impacts psychosociaux
Arthrite et alimentation
Prộvention et enjeux de santộ publique
Diffộrentes formes d'arthrite et d'arthrose
Programme
www.arthrite.ca/quebec
Inscriptions
Montrộal 514-846-8840 poste 221;
extộrieur de Montrộal 1-800-321-1433
4
Prộvention en pratique mộdicale, Septembre 2004
Exercices pour larthrose du
genou et de la hanche
Exercices dont lefficacitộ thộrapeutique
est prouvộe scientifiquement :
Entraợnement aộrobique sur bicyclette
stationnaire ou tapis roulant.
Exercices de musculation (quadriceps,
membres supộrieurs et tronc).
Exercices favorisant la mobilitộ normale
de larticulation.
Principes dapplication :
La prise en charge optimale requiert
une combinaison de modalitộs pharma-
cologiques et non pharmacologiques.
Lapproche devrait comprendre lộduca-
tion des patients et la rộduction du poids
lorsque appropriộe.
Individualiser selon lõge, les co-
morbiditộs (cardiaques et autres limitant
la tolộrance lexercice) et lexcốs
de poids.
Les exercices doivent ờtre rộalisộs sous
la supervision dune personne qualifiộe
au moins au dộbut.
Le niveau doit tenir compte de la stabi-
litộ articulaire, du degrộ de douleur et de
la prộsence de signes inflammatoires.
Choisir et varier les exercices selon le
niveau dactivitộ et de motivation.
Rộfộrences
1. Lagacộ C, et collab., Impact de larthrite sur les Canadiens. dans : Larthrite au
Canada : une bataille gagner. Ottawa : Santộ Canada, 2003. PDF tộlộchargeable :
/>2. Felson DT, ôOsteoarthritis: New Insights: Part I: The Disease and Its Risk
Factors.ằ Annals of Internal Medecine, vol 133, N 8, octobre 2000, p. 635-646.
PDF tộlộchargeable : />3. Lievense AM, Bierma-Zeinstra SM, Verhagen AP, Bernsen RM, Verhaar JA,
Koes BW. ôInfluence of sporting activities on the development of osteoarthritis
of the hip: a systematic review.ằ Arthritis & Rheumatism 2003; 49(2):228-236.
4. Maetzel A, Makela M, Hawker G, Bombardier C. ôOsteoarthritis of the hip and
knee and mechanical occupational exposure a systematic overview of the
evidence.ằ Journal of Rheumatology 1997; 24(8):1599-1607.
5. Camerlain M. ôLa douleur chronique et larthrite: comment y remộdier?ằ
Le Clinicien 2002; nov :73-81.
communications/journals/leclinicien/archive.html
6. Stucki G, Sangha O, Stucki S, Michel BA, Tyndall A, Dick W, Theiler R.
ôComparison of the WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities)
osteoarthritis index and a self-report format of the self-administered
Lequesne-Algofunctional index in patients with knee and hip osteoarthritis.ằ
Osteoarthritis Cartilage 1998;6:79-86.
7. Garnier E. Programme CURATA : quel AINS oser pour larthrose. Mộdecin du
Quộbec 2001; 36 (10) : 26-28. www.fmoq.org/medecin_du_quebec.htm.
8. Recommendations for the Medical Management of Osteoarthritis of the Hip and
Knee. American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis
Guidelines. Arthritis & Rheumatism, vol 43, N 9, septembre 2000, 43(9) : 1905-
1915. Disponible : />mgmt/oa-mgmt.asp?aud=mem
Rộfộrences
rộvention
en pratique mộdicale
1
Septembre 2004
Larthrose
Un dộfi nouveau pour le mộdecin
L Organisation mondiale de la santộ estime que 10 % de la population mondiale
de plus de 60 ans est atteinte darthrose dune faỗon cliniquement significative,
faisant de ce problốme de santộ un des plus frộquents. Au Quộbec, larthrose
occupe le tout premier rang avec 12 % des Quộbộcois qui sen disent affectộs,
une augmentation de prốs de 2 % depuis 1987. Outre les problốmes de la
colonne vertộbrale, larthrose touche, en ordre dộcroissant, les articulations du
genou,de la hanche et de la main.
Larthrose se manifeste cliniquement deux fois plus frộquemment chez les
femmes et sa prộvalence augmente avec lõge. Toutefois, les auteurs dun rap-
port canadien sur le sujet concluent : ô Alors que larthrite (arthrose) est
frộquemment perỗue comme une maladie de la vieillesse,prốs de trois sujets sur
cinq ayant signalộ souffrir darthrite ou de rhumatisme en 2000 avaient en rộa-
litộ moins de 65 ans ằ.
1
Les consộquences de larthrose sont majeures. Elle limite la mobilitộ la marche
chez plus du tiers des patients et les activitộs quotidiennes chez prốs de la
moitiộ. Aprốs le cancer, larthrose est la cause la plus frộquente de douleurs
chroniques. Elle est aussi une cause importante de perturbations du sommeil,
de dộpression et de baisse de la qualitộ de vie. Les personnes arthrosiques
rapportent deux fois plus dabsences au travail pour cause de maladie et ces
absences sont plus longues.
Le bilan des connaissances actuelles nous indique que larthrose est causộe,
dans un nombre non nộgligeable de cas, par des facteurs de risque qui sont
modifiables. Aujourdhui, avec la majoritộ des patients qui sont jeunes et actifs,
la prộvention prend une importance nouvelle et les pratiques cliniques prộven-
tives deviennent prioritaires. Le mộdecin de premiốre ligne est appelộ, dans les
annộes venir, jouer un rụle accru de conseiller auprốs de ses patients.
Faits saillants
L'arthrose est la premiốre cause
d'incapacitộ et de perte de qualitộ de
la vie en Amộrique du Nord.
L'arthrose nest plus considộrộe
comme une maladie de la vieillesse
avec trois patients sur cinq ayant
signalộ le dộbut de leurs problốmes
avant l'õge de 65 ans.
L'arthrose n'est plus considộrộe par les
experts mộdicaux comme une maladie
inộluctable mais qui se dộveloppe,
comme les maladies cardio-vascu-
laires, partir des facteurs de risque
dont certains sont modifiables.
L'obộsitộ, l'inactivitộ physique et les
stress articulaires au travail ou dans
la pratique sportive de haut niveau,
sont les trois facteurs modifiables
principaux sur lesquels le clinicien et
son patient peuvent agir.
La pratique d'une activitộ physique
rộguliốre selon la tolộrance est un ộlộ-
ment clộ dans la prộvention des inca-
pacitộs et pertes de qualitộ de la vie
chez les patients arthrosiques.
L'ộlimination des stress articulaires
au travail ou dans les sports de haut
niveau est recommandộe dans la
mesure oự ces stress produisent les
signes et symptụmes, particuliốre-
ment pendant les ộpisodes aigus et
chez les jeunes sujets.
Les facteurs de risque
La confộrence de consensus du National
Institute of Health sur larthrose concluait
en 2000 que larthrose ne doit plus ờtre
considộrộe comme une maladie du vieil-
lissement mais comme une maladie qui se
dộveloppe en fonction de facteurs de
risque dont certains peuvent ờtre modifiộs.
2
Il importe donc dagir dốs les premiốres
manifestations cliniques.
Non modifiables
Les facteurs de risque non modifiables
comprennent, en premier lieu, lõge et le
sexe. Chez les femmes, le risque est
deux fois supộrieur, surtout aprốs la
mộnopause. Pour les deux sexes, la prộva-
lence augmente jusqu la septiốme
dộcennie et atteint un plateau. Cette aug-
mentation est en grande partie expliquộe
Un dộfi nouveau pour le mộdecin
Les facteurs de risque
Faits saillants
2
Prévention en pratique médicale, Septembre 2004
Tableau 1
Facteurs de risque de l’arthrose
Facteurs non modifiables Description
Âge et sexe Deux femmes pour un homme
Statut oestrogénique
Augmentation avec l’âge
Génétique Anatomie axiale
Race noire plus à risque
Biomarqueurs
Antécédents Traumatisme articulaire
médicaux Maladie ostéoarticulaire
Nodules d’Heberden
Facteurs modifiables Description
Obésité Indice de masse corporelle supérieur à 27 kg/m
2
Inactivité physique : Moins d’une session par semaine d’activité
physique de moins de 20 à 30 minutes
Stress articulaire Au travail
Pratique sportive de haut niveau
par la nature chronique de l’arthrose.
Mais ne nous y trompons pas, c’est pen-
dant la vie active qu’apparaît l’arthrose
dans la majorité des cas. Comme autre
facteur non modifiable mentionnons la
génétique qui peut comprendre des élé-
ments raciaux, anatomiques et biochi-
miques qui sont sans application pratique
pour la prévention en première ligne.
Enfin, il y a plusieurs maladies ostéoarti-
culaires et les antécédents de traumatismes
articulaires qui peuvent s’accompagner
d’arthrose. Pour les traumatismes,
le médecin de famille doit informer son
patient arthrosique du risque encouru
s’il pratique un sport l’exposant à des
traumatismes.
Modifiables
Les facteurs de risque modifiables incluent
l’obésité, l’inactivité physique et le stress
articulaire au travail et dans certaines pra-
tiques sportives de haut niveau.
L’obésité, qui résulte de deux facteurs liés
aux habitudes de vie, l’alimentation et
l’inactivité physique, joue un très grand
rôle dans le développement de l’arthrose,
non seulement de la hanche et du genou
mais aussi de la main par un effet sys-
témique qui est mal connu. On sait aussi
que la réduction du poids chez les
arthrosiques obèses modifie favorablement
l’évolution naturelle de la maladie. Le
risque d’arthrose est surtout observé chez
les personnes dont l’indice de poids cor-
porel est supérieur à 27 kg/m
2
, soit un
poids de 180 livres pour une personne de
taille moyenne (5 pieds et 8 pouces).
L’inactivité physique peut aussi être asso-
ciée à l’arthrose du genou indépendam-
ment de l’obésité, par un effet de faiblesse
musculaire du quadriceps. En résumé, pour
les habitudes de vie, la réduction du poids
et la promotion de l’activité physique sont
deux éléments clés et synergiques dans la
prévention de l’arthrose.
Arthrose, travail et sport
Les stress biomécaniques imposés aux arti-
culations dans certains types d’emplois et de
pratique sportive de haut niveau contribuent
à l’apparition et à l’aggravation de l’arthrose
(tableau 2)
3,4
. Il importe de signaler que
les connaissances scientifiques sur le sujet
confirment que ce sont les activités de
travail ou de sport pratiquées profession-
nellement qui sont associées à l’arthrose
et non la pratique ludique d’une activité
même si c’est de façon régulière.
L’hypothèse courante pour expliquer la
contribution du travail et du sport dans
l’arthrose est l’accumulation au cours de
la vie de microtraumatismes qui favorisent
une réponse inflammatoire ou immunitaire
chronique. En corollaire de cette hypothèse,
le développement et l’aggravation de
l’arthrose peuvent être évités si la fréquence
des microtraumatismes peut être réduite.
Même si les éléments de preuve sont suf-
fisants pour lier l’arthrose aux stress articu-
laires en milieu de travail, on ne connaît
pas précisément la nature de ces stress.
Pour la main et le poignet, ils seraient
principalement associés à la répétition de
mouvements particulièrement lorsque le
rythme de travail est imposé de façon
rigide. Pour le genou et la hanche, le
travail de force comme la manutention
d’objets lourds, le maintien prolongé de la
posture à genou et l’exposition aux vibra-
tions du corps entier contribueraient au
développement de l’arthrose.
Le défi du médecin
Comme clinicien, l’anamnèse détaillée des
signes et symptômes articulaires récurrents
ou chroniques revêt une grande importance
pour la prévention parce que c’est ainsi
Tableau 2
Arthrose, travail et sport
Si on exclut les problèmes d’arthrose
de la colonne vertébrale, des preuves
scientifiques existent pour lier arthrose
et travail, ou arthrose et sport.
Des exemples de métiers ayant
démontré un excès d’arthrose :
• Cultivateurs (hanche)
• Poseurs de planchers et de
revêtements (genou)
• Travailleurs de chantier naval (genou)
• Bûcherons (non spécifié)
• Mineurs (genou)
• Préposés à l’entretien ménager
(non spécifié)
• Chauffeurs de camions (non spécifié)
Des exemples de sports professionnels
ayant démontré un excès d’arthrose :
• Course de fond (niveau compétitif)
(hanche)
• Soccer professionnel (hanche)
• Danseurs de ballet (hanche)
3
Prévention en pratique médicale, Septembre 2004
Fiche 1
Anamèse des facteurs de risque d’arthrose
Sexe : ______________________________ Âge : __________________________________
Localisation de l’arthrose : ______________________________________________________
Âge au début des symptômes : ________________ Taille et poids : ____________________
Antécédent de blessure, maladie ou difformité articulaire : ____________________________
____________________________________________________________________________
Type de travail et horaires de travail : ______________________________________________
Activité sportive professionnelle ou compétitive : ____________________________________
Pratique d’activité physique régulière : ____________________________________________
Au travail
Dans les sports
et loisirs
Tâche(s)/
mouvement(s)
Nature des
signes/symptômes
Articulation(s)
affectée(s)
Durée du
problème
Anamnèse des stress articulaires qui produisent
les signes et les symptômes au travail ou dans les sports
(Séances d’un minimum de 20 à 30 minutes, au moins deux ou trois fois par semaine sur une
période continue d’au moins trois mois dans la dernière année.)
* Cette fiche est disponible en format PDF sur le site Internet de la Direction de santé
publique : www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdfppm/ppmsept04fiche.pdf
qu’on pourra identifier avec le patient des
sources de stress articulaire. La fiche ci-
dessus résume les éléments d’anamnèse
qui aident à identifier chez un patient les
facteurs modifiables et non modifiables
associés à l’arthrose. Dans les cas où le
clinicien identifie des tâches ou des mou-
vements qui reproduisent les signes et les
symptômes, soit au travail ou dans les
sports, il convient de conseiller au patient
d’éviter ces stress au moins pendant les
épisodes aigus. Par ailleurs, un patient
arthrosique doit être encouragé à poursui-
vre toutes ses activités normales de travail
et de loisir dans la mesure où ces activités
n’induisent pas de douleur.
Soigner c’est
prévenir
prévenir c’est
aussi soigner!
La raison de consultation du malade
arthrosique est généralement la douleur, la
raideur et les difficultés fonctionnelles
dans la vie de tous les jours. Le premier
défi posé par l’arthrose est le contrôle de la
douleur qui est souvent persistante. Une
évaluation du patient, à l’aide d’une échelle
du statut fonctionnel (voir encart)
5-6
permet
de faire un choix judicieux des traitements
pharmacologiques et non pharma-
cologiques. Le programme québécois
CURATA (Concertation pour une utilisation
raisonnée des anti-inflammatoires dans le
traitement de l’arthrose) vient en aide au
médecin traitant en proposant un arbre
décisionnel pour relever ce défi thérapeu-
tique (voir encart).
7
Toutefois, comme il n’existe pas de
traitement médical curatif de l’arthrose,
la prévention doit aussi être considérée
comme une façon de soigner à long
terme. Bouger tout en protégeant l’arti-
culation touchée, voilà ce que le
médecin doit expliquer à son patient
ainsi que la complémentarité de ces
deux principes. Pour bien conseiller son
patient, le médecin doit connaître les
facteurs de risque en cause et identifier
les stress biomécaniques qui semblent
associés aux signes et symptômes (fiche
d’anamnèse). En questionnant bien son
patient, le médecin qui identifie une
source de stress articulaire au travail
peut faire une recommandation pour
réduire ce stress temporairement ou
l’éliminer si les signes et symptômes
sont récurrents ou chroniques. Plus cette
recommandation sera précise, plus elle
sera applicable.
Un régime personnalisé d’exercices,
enseigné et suivi au début par des profes-
sionnels du domaine, fait partie des
recommandations nord-américaines et
européennes pour la prise en charge du
patient arthrosique.
8
Le recours à des pro-
fessionnels qualifiés aide le patient à
respecter le principe de protection articu-
laire tout en maintenant ses activités le
plus normalement possible. Les modalités
d’application de ces recommandations
sont fondées sur le rôle central de l’omni-
praticien en raison de sa connaissance du
patient, de son état général, de sa motiva-
tion, de l’évolution de sa maladie et de la
présence de facteurs de risque modifiables
et non modifiables.
Soigner c’est
prévenir
prévenir c’est
aussi soigner!
Exploration de l’incapacité fonctionnelle
Indice de Lequesne • Coxarthrose
1. Douleur ou gène
• La nuit ?
Non 0
Seulement en remuant ou selon la posture 1
Même immobile 2
• Lors du dérouillage matinal ?
Moins d’une minute 0
Pendant 1 à 15 min 1
Pendant plus de 15 min 2
• Lors de la station debout une demi-heure ?
Non 0
Oui 1
• Lorsque vous marchez ?
Non 0
Seulement après une certaine distance 1
Très rapidement et de façon croissante 2
• Votre hanche vous gêne-t-elle lorsque vous restez assis longtemps (2 heures) et avant de vous relever ?
Non 0
Oui 1
2. Périmètre de marche maximal
Aucune limitation 0
Limite mais supérieur à 1 km 1
Environ 1 km (environ 15 min) 2
500 à 900 m (environ 8 à 15 min) 3
300 à 500 m 4
100 à 300 m 5
Moins de 100 m 6
Une canne ou une béquille nécessaire +1
Deux cannes ou deux béquilles nécessaires +2
3. Difficultés dans la vie quotidienne (
Cotation : 0 = Néant; 0,5 = Petite; 1 = Moyenne; 1,5 = Grande; 2 = Impossibilité)
Mettre vos chaussures? 0 à 2
Ramasser un objet à terre? 0 à 2
Monter ou descendre un étage? 0 à 2
Sortir d’une voiture ou d’un fauteuil profond? 0 à 2
*Score obtenu :
Indice de Lequesne • Gonarthrose
1. Douleur ou gène
• La nuit ?
Non 0
Seulement en remuant ou selon la posture 1
Même immobile 2
• Lors du dérouillage matinal ?
Moins d’une minute 0
Pendant 1 à 15 min 1
Pendant plus de 15 min 2
• Lors de la station debout une demi-heure ?
Non 0
Oui 1
• Lorsque vous marchez ?
Non 0
Seulement après une certaine distance 1
Très rapidement et de façon croissante 2
• Pour vous relevez d’un siège sans l’aide des bras ?
Non 0
Oui 1
2. Périmètre de marche maximal
Aucune limitation 0
Limite mais supérieur à 1 km 1
Environ 1 km (environ 15 min) 2
500 à 900 m (environ 8 à 15 min) 3
300 à 500 m 4
100 à 300 m 5
Moins de 100 m 6
Une canne ou une béquille nécessaire +1
Deux cannes ou deux béquilles nécessaires +2
3. Difficultés dans la vie quotidienne (
Cotation : 0 = Néant; 0,5 = Petite; 1 = Moyenne; 1,5 = Grande; 2 = Impossibilité)
Monter un étage? 0 à 2
Descendre un étage? 0 à 2
Vous accroupir? 0 à 2
Marcher en terrain irrégulier? 0 à 2
*Score obtenu :
* On peut considérer une gonarthrose/coxarthrose cliniquement significative à partir de 6 à 8 points
(1-4 = minime; 5-7 = moyenne; 8-10 = importante; 11 ou plus = très importante)
Septembre 2004 • Direction de santé publique de Montréal
2
Prévention en pratique médicale, Septembre 2004
Tableau 1
Facteurs de risque de l’arthrose
Facteurs non modifiables Description
Âge et sexe Deux femmes pour un homme
Statut oestrogénique
Augmentation avec l’âge
Génétique Anatomie axiale
Race noire plus à risque
Biomarqueurs
Antécédents Traumatisme articulaire
médicaux Maladie ostéoarticulaire
Nodules d’Heberden
Facteurs modifiables Description
Obésité Indice de masse corporelle supérieur à 27 kg/m
2
Inactivité physique : Moins d’une session par semaine d’activité
physique de moins de 20 à 30 minutes
Stress articulaire Au travail
Pratique sportive de haut niveau
par la nature chronique de l’arthrose.
Mais ne nous y trompons pas, c’est pen-
dant la vie active qu’apparaît l’arthrose
dans la majorité des cas. Comme autre
facteur non modifiable mentionnons la
génétique qui peut comprendre des élé-
ments raciaux, anatomiques et biochi-
miques qui sont sans application pratique
pour la prévention en première ligne.
Enfin, il y a plusieurs maladies ostéoarti-
culaires et les antécédents de traumatismes
articulaires qui peuvent s’accompagner
d’arthrose. Pour les traumatismes,
le médecin de famille doit informer son
patient arthrosique du risque encourru
s’il pratique un sport l’exposant à des
traumatismes.
Modifiables
Les facteurs de risque modifiables incluent
l’obésité, l’inactivité physique et le stress
articulaire au travail et dans certaines pra-
tiques sportives de haut niveau.
L’obésité, qui résulte de deux facteurs liés
aux habitudes de vie, l’alimentation et
l’inactivité physique, joue un très grand
rôle dans le développement de l’arthrose,
non seulement de la hanche et du genou
mais aussi de la main par un effet sys-
témique qui est mal connu. On sait aussi
que la réduction du poids chez les
arthrosiques obèses modifie favorablement
l’évolution naturelle de la maladie. Le
risque d’arthrose est surtout observé chez
les personnes dont l’indice de poids cor-
porel est supérieur à 27 kg/m
2
, soit un
poids de 180 livres pour une personne de
taille moyenne (5 pieds et 8 pouces).
L’inactivité physique peut aussi être asso-
ciée à l’arthrose du genou indépendam-
ment de l’obésité, par un effet de faiblesse
musculaire du quadriceps. En résumé, pour
les habitudes de vie, la réduction du poids
et la promotion de l’activité physique sont
deux éléments clés et synergiques dans la
prévention de l’arthrose.
Arthrose, travail et sport
Les stress biomécaniques imposés aux arti-
culations dans certains types d’emplois et de
pratique sportive de haut niveau contribuent
à l’apparition et à l’aggravation de l’arthrose
(tableau 2)
3,4
. Il importe de signaler que
les connaissances scientifiques sur le sujet
confirment que ce sont les activités de
travail ou de sport pratiquées profession-
nellement qui sont associées à l’arthrose
et non la pratique ludique d’une activité
même si c’est de façon régulière.
L’hypothèse courante pour expliquer la
contribution du travail et du sport dans
l’arthrose est l’accumulation au cours de
la vie de microtraumatismes qui favorisent
une réponse inflammatoire ou immunitaire
chronique. En corollaire de cette hypothèse,
le développement et l’aggravation de
l’arthrose peuvent être évités si la fréquence
des microtraumatismes peut être réduite.
Même si les éléments de preuve sont suf-
fisants pour lier l’arthrose aux stress articu-
laires en milieu de travail, on ne connaît
pas précisément la nature de ces stress.
Pour la main et le poignet, ils seraient
principalement associés à la répétition de
mouvements particulièrement lorsque le
rythme de travail est imposé de façon
rigide. Pour le genou et la hanche, le
travail de force comme la manutention
d’objets lourds, le maintien prolongé de la
posture à genou et l’exposition aux vibra-
tions du corps entier contribueraient au
développement de l’arthrose.
Le défi du médecin
Comme clinicien, l’anamnèse détaillée des
signes et symptômes articulaires récurrents
ou chroniques revêt une grande importance
pour la prévention parce que c’est ainsi
Tableau 2
Arthrose, travail et sport
Si on exclut les problèmes d’arthrose
de la colonne vertébrale, des preuves
scientifiques existent pour lier arthrose
et travail, ou arthrose et sport.
Des exemples de métiers ayant
démontré un excès d’arthrose :
• Cultivateurs (hanche)
• Poseurs de planchers et de
revêtements (genou)
• Travailleurs de chantier naval (genou)
• Bûcherons (non spécifié)
• Mineurs (genou)
• Préposés à l’entretien ménager
(non spécifié)
• Chauffeurs de camions (non spécifié)
Des exemples de sports professionnels
ayant démontré un excès d’arthrose :
• Course de fond (niveau compétitif)
(hanche)
• Soccer professionnel (hanche)
• Danseurs de ballet (hanche)
3
Prévention en pratique médicale, Septembre 2004
Fiche 1
Anamnèse des facteurs de risque d’arthrose
Sexe : ______________________________ Âge : __________________________________
Localisation de l’arthrose : ______________________________________________________
Âge au début des symptômes : ________________ Taille et poids : ____________________
Antécédent de blessure, maladie ou difformité articulaire : ____________________________
____________________________________________________________________________
Type de travail et horaires de travail : ______________________________________________
Activité sportive professionnelle ou compétitive : ____________________________________
Pratique d’activité physique régulière : ____________________________________________
Au travail
Dans les sports
et loisirs
Tâche(s)/
mouvement(s)
Nature des
signes/symptômes
Articulation(s)
affectée(s)
Durée du
problème
Anamnèse des stress articulaires qui produisent
les signes et les symptômes au travail ou dans les sports
(Séances d’un minimum de 20 à 30 minutes, au moins deux ou trois fois par semaine sur une
période continue d’au moins trois mois dans la dernière année.)
* Cette fiche est disponible en format PDF sur le site Internet de la Direction de santé
publique : www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdfppm/ppmsept04fiche.pdf
qu’on pourra identifier avec le patient des
sources de stress articulaire. La fiche ci-
dessus résume les éléments d’anamnèse
qui aident à identifier chez un patient les
facteurs modifiables et non modifiables
associés à l’arthrose. Dans les cas où le
clinicien identifie des tâches ou des mou-
vements qui reproduisent les signes et les
symptômes, soit au travail ou dans les
sports, il convient de conseiller au patient
d’éviter ces stress au moins pendant les
épisodes aigus. Par ailleurs, un patient
arthrosique doit être encouragé à poursui-
vre toutes ses activités normales de travail
et de loisir dans la mesure où ces activités
n’induisent pas de douleur.
Soigner c’est
prévenir
prévenir c’est
aussi soigner!
La raison de consultation du malade
arthrosique est généralement la douleur, la
raideur et les difficultés fonctionnelles
dans la vie de tous les jours. Le premier
défi posé par l’arthrose est le contrôle de la
douleur qui est souvent persistante. Une
évaluation du patient, à l’aide d’une échelle
du statut fonctionnel (voir encart)
5-6
permet
de faire un choix judicieux des traitements
pharmacologiques et non pharma-
cologiques. Le programme québécois
CURATA (Concertation pour une utilisation
raisonnée des anti-inflammatoires dans le
traitement de l’arthrose) vient en aide au
médecin traitant en proposant un arbre
décisionnel pour relever ce défi thérapeu-
tique (voir encart).
7
Toutefois, comme il n’existe pas de
traitement médical curatif de l’arthrose,
la prévention doit aussi être considérée
comme une façon de soigner à long
terme. Bouger tout en protégeant l’arti-
culation touchée, voilà ce que le
médecin doit expliquer à son patient
ainsi que la complémentarité de ces
deux principes. Pour bien conseiller son
patient, le médecin doit connaître les
facteurs de risque en cause et identifier
les stress biomécaniques qui semblent
associés aux signes et symptômes (fiche
d’anamnèse). En questionnant bien son
patient, le médecin qui identifie une
source de stress articulaire au travail
peut faire une recommandation pour
réduire ce stress temporairement ou
l’éliminer si les signes et symptômes
sont récurrents ou chroniques. Plus cette
recommandation sera précise, plus elle
sera applicable.
Un régime personnalisé d’exercices,
enseigné et suivi au début par des profes-
sionnels du domaine, fait partie des
recommandations nord-américaines et
européennes pour la prise en charge du
patient arthrosique.
8
Le recours à des pro-
fessionnels qualifiés aide le patient à
respecter le principe de protection articu-
laire tout en maintenant ses activités le
plus normalement possible. Les modalités
d’application de ces recommandations
sont fondées sur le rôle central de l’omni-
praticien en raison de sa connaissance du
patient, de son état général, de sa motiva-
tion, de l’évolution de sa maladie et de la
présence de facteurs de risque modifiables
et non modifiables.
Soigner c’est
prévenir
prévenir c’est
aussi soigner!
Exploration de l’incapacité fonctionnelle
Indice de Lequesne • Coxarthrose
1. Douleur ou gène
• La nuit ?
Non 0
Seulement en remuant ou selon la posture 1
Même immobile 2
• Lors du dérouillage matinal ?
Moins d’une minute 0
Pendant 1 à 15 min 1
Pendant plus de 15 min 2
• Lors de la station debout une demi-heure ?
Non 0
Oui 1
• Lorsque vous marchez ?
Non 0
Seulement après une certaine distance 1
Très rapidement et de façon croissante 2
• Votre hanche vous gêne-t-elle lorsque vous restez assis longtemps (2 heures) et avant de vous relever ?
Non 0
Oui 1
2. Périmètre de marche maximal
Aucune limitation 0
Limite mais supérieur à 1 km 1
Environ 1 km (environ 15 min) 2
500 à 900 m (environ 8 à 15 min) 3
300 à 500 m 4
100 à 300 m 5
Moins de 100 m 6
Une canne ou une béquille nécessaire +1
Deux cannes ou deux béquilles nécessaires +2
3. Difficultés dans la vie quotidienne (
Cotation : 0 = Néant; 0,5 = Petite; 1 = Moyenne; 1,5 = Grande; 2 = Impossibilité)
Mettre vos chaussures? 0 à 2
Ramasser un objet à terre? 0 à 2
Monter ou descendre un étage? 0 à 2
Sortir d’une voiture ou d’un fauteuil profond? 0 à 2
*Score obtenu :
Indice de Lequesne • Gonarthrose
1. Douleur ou gène
• La nuit ?
Non 0
Seulement en remuant ou selon la posture 1
Même immobile 2
• Lors du dérouillage matinal ?
Moins d’une minute 0
Pendant 1 à 15 min 1
Pendant plus de 15 min 2
• Lors de la station debout une demi-heure ?
Non 0
Oui 1
• Lorsque vous marchez ?
Non 0
Seulement après une certaine distance 1
Très rapidement et de façon croissante 2
• Pour vous relevez d’un siège sans l’aide des bras ?
Non 0
Oui 1
2. Périmètre de marche maximal
Aucune limitation 0
Limite mais supérieur à 1 km 1
Environ 1 km (environ 15 min) 2
500 à 900 m (environ 8 à 15 min) 3
300 à 500 m 4
100 à 300 m 5
Moins de 100 m 6
Une canne ou une béquille nécessaire +1
Deux cannes ou deux béquilles nécessaires +2
3. Difficultés dans la vie quotidienne (
Cotation : 0 = Néant; 0,5 = Petite; 1 = Moyenne; 1,5 = Grande; 2 = Impossibilité)
Monter un étage? 0 à 2
Descendre un étage? 0 à 2
Vous accroupir? 0 à 2
Marcher en terrain irrégulier? 0 à 2
*Score obtenu :
* On peut considérer une gonarthrose/coxarthrose cliniquement significative à partir de 6 à 8 points
(1-4 = minime; 5-7 = moyenne; 8-10 = importante; 11 ou plus = très importante)
Septembre 2004 • Direction de santé publique de Montréal
Si rộponse inadộquate
ou intolộrance
OUI
Septembre 2004 Direction de santộ publique de Montrộal
Source : Choquette D, Bessette L, et le groupe CURATA.
Traitement de l'arthrose: arbre dộcisionnel. Version 2003 en cours de rộvision.
A - FACTEURS DE RISQUE DE COMPLICATIONS DIGESTIVES
(perforation, obstruction, saignement)
ge > 65 ans
ATCD dulcốres peptiques non compliquộs
ATCD de complications digestives
(perforation, obstruction, saignement)
Prise de corticostộroùdes
Prise danticoagulant
Prise dautres AINS incluant lA.A.S. petite dose
ATCD maladie cardiovasculaire
B - AINS ET INSUFFISANCE RẫNALE
Calculer la Clairance de crộatinine (ml/min) :
(140-õge) x poids (kg) x 1,2 (x 0,85 si femme)
S Cr (umol/l)
Si Cl crộatinine < 30 ml/min, ộviter AINS
Si Cl crộatinine 30-60 ml/min, surveillance
Suivi biologique :
ẫlectrolytes, urộe et crộatinine q 5-7 jours x 2 lorsquon initie le
traitement et q 3 mois par la suite. Si augmentation de la dose
dAINS, reprendre la mờme sộquence de contrụles.
C - AINS ET INSUFFISANCE CARDIAQUE
Si de la rộtention hydrosodộe, risque de dộcompensation car-
diaque chez les patients avec dysfonction ventriculaire gauche
sộvốre.
+ Linsuffisance est sộvốre + le risque est ộlevộ
Informer le patient de surveiller les signes et symptụmes
suivants : dyspnộe, apparition ddốme, poids
Traitement de larthrose : Arbre dộcisionnel
Modalitộs non pharmacologiques (enseignement, diốte, physio/ergothộrapie)
Utiliser lacộtaminophốne jusqu une dose maximale (1 gm QID)
Application dun AINS topique
Injection intra-articulaire si possible (corticostộroùdes ou viscosupplộance)
Si rộponse inadộquate
Facteurs de risque de complications digestives
(perforation-obstruction-saignement) Tableau A
Utiliser un COXIB
OUI
NON
ATCD dulcốres compliquộs,
danticoagulant ou õge 75 ans
Favoriser lutilisation dun AINS
non-sộlectif
Pas de
gastro-protecteur
NON
Ajouter un
gastro-protecteur
Si rộponse inadộquate
ou intolộrance
Utiliser un autre AINS
non-sộlectif ou un COXIB
Utiliser un AINS non-sộlectif
avec un gastro-protecteur
Si rộponse inadộquate, considộrer rộfộrence en spộcialitộ
R
x
Rộộvaluer rộguliốrement
lindication et les risques
associộs au traitement
avec un AINS (Tableau E),
la T.A. (Tableau D), les
fonctions cardiaque
(Tableau C) et rộnale
(Tableau B)
Rộộvaluer rộguliốrement le traitement
D - AINS ET TENSION ARTẫRIELLE
Prise de TA q 7 jours x 2 puis q 3 mois
Si de la dose AINS, ou changement dAINS,
reprendre surveillance
Si de TA > 140/90, cesser AINS si possible. Si AINS essentiel,
traiter HTA selon lignes de conduite habituelles
Chez patients diabộtiques : viser TA < 130/80
Si protộinurie de > 1 g/j, viser TA < 125/75
(diabộtique ou non)
E - ẫVALUATION DU RISQUE
GASTRO-INTESTINAL ET CARDIAQUE
Bas Moyen ẫlevộ
Bas
AINS Coxib Coxib + GP
non-sộlectif
Moyen
AINS Coxib Coxib + GP
non-sộlectif
ẫlevộ
Coxib + AAS Coxib + AAS Coxib + AAS
+ GP
Cardiovasculaire
Adaptộ de : C. Baigent, C. Patrono. Selective cyclooxygenase 2 inhibitors, aspirin,
and cardiovascular disease. Arthritis and Rheumatism 2003 48 : 12-20
rộvention
en pratique mộdicale
Gastro-intestinal
Association
des Mộdecins
Omnipraticiens
de Montrộal
Un bulletin de la Direction de santộ publique
de Montrộal publiộ avec la collaboration de
lAssociation des mộdecins omnipraticiens de Montrộal
dans le cadre du programme Prộvention en pratique mộdicale
coordonnộ par le docteur Jean Cloutier.
Ce numộro est une rộalisation de lunitộ Santộ au travail
et santộ environnementale.
Responsable dunitộ : D
r
Louis Drouin
Rộdacteur en chef : D
r
Louis Patry
ẫdition : Deborah Bonney
Infographie : Julie Milette
Auteurs : D
r
Michel Rossignol, D
r
Louis Patry, D
r
Martine
Ballargeon, Ghislaine Tougas, Direction de santộ publique
de Montrộal
Collaboration spộciale : La Sociộtộ darthrite, Division du
Quộbec et les Docteurs Monique Camerlain, rhumatologue
conseil, Centre hospitaler de lUniversitộ de Sherbrooke et
ẫric Rich, Professeur adjoint de rhumatologie, Hụpital
Notre-Dame du CHUM, Universitộ de Montrộal
1301, rue Sherbrooke Est, Montrộal (Quộbec) H2L 1M3
Tộlộphone : (514) 528-2400
courriel:
ISSN : 1481-3734 (version imprimộe)
ISSN : 1712-2937 (version en ligne)
Dộpụt lộgal Bibliothốque nationale du Quộbec, 2004
Dộpụt lộgal Bibliothốque nationale du Canada, 2004
Numộro de convention : 40005583
rộvention
en pratique mộdicale
Forum sur l'arthrite
Jeudi le 21 octobre 2004
de 8 h 00 16 h 30
Hụtel Intercontinental de Montrộal
Organisộ par
La Sociộtộ d'arthrite, Division du Quộbec
Thốmes
Arthrite juvộnile
Impacts psychosociaux
Arthrite et alimentation
Prộvention et enjeux de santộ publique
Diffộrentes formes d'arthrite et d'arthrose
Programme
www.arthrite.ca/quebec
Inscriptions
Montrộal 514-846-8840 poste 221;
extộrieur de Montrộal 1-800-321-1433
4
Prộvention en pratique mộdicale, Septembre 2004
Exercices pour larthrose du
genou et de la hanche
Exercices dont lefficacitộ thộrapeutique
est prouvộe scientifiquement :
Entraợnement aộrobique sur bicyclette
stationnaire ou tapis roulant.
Exercices de musculation (quadriceps,
membres supộrieurs et tronc).
Exercices favorisant la mobilitộ normale
de larticulation.
Principes dapplication :
La prise en charge optimale requiert
une combinaison de modalitộs pharma-
cologiques et non pharmacologiques.
Lapproche devrait comprendre lộduca-
tion des patients et la rộduction du poids
lorsque appropriộe.
Individualiser selon lõge, les co-
morbiditộs (cardiaques et autres limitant
la tolộrance lexercice) et lexcốs
de poids.
Les exercices doivent ờtre rộalisộs sous
la supervision dune personne qualifiộe
au moins au dộbut.
Le niveau doit tenir compte de la stabi-
litộ articulaire, du degrộ de douleur et de
la prộsence de signes inflammatoires.
Choisir et varier les exercices selon le
niveau dactivitộ et de motivation.
Rộfộrences
1. Lagacộ C, et collab., Impact de larthrite sur les Canadiens. dans : Larthrite au
Canada : une bataille gagner. Ottawa : Santộ Canada, 2003. PDF tộlộchargeable :
/>2. Felson DT, ôOsteoarthritis: New Insights: Part I: The Disease and Its Risk
Factors.ằ Annals of Internal Medecine, vol 133, N 8, octobre 2000, p. 635-646.
PDF tộlộchargeable : />3. Lievense AM, Bierma-Zeinstra SM, Verhagen AP, Bernsen RM, Verhaar JA,
Koes BW. ôInfluence of sporting activities on the development of osteoarthritis
of the hip: a systematic review.ằ Arthritis & Rheumatism 2003; 49(2):228-236.
4. Maetzel A, Makela M, Hawker G, Bombardier C. ôOsteoarthritis of the hip and
knee and mechanical occupational exposure a systematic overview of the
evidence.ằ Journal of Rheumatology 1997; 24(8):1599-1607.
5. Camerlain M. ôLa douleur chronique et larthrite: comment y remộdier?ằ
Le Clinicien 2002; nov :73-81.
communications/journals/leclinicien/archive.html
6. Stucki G, Sangha O, Stucki S, Michel BA, Tyndall A, Dick W, Theiler R.
ôComparison of the WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities)
osteoarthritis index and a self-report format of the self-administered
Lequesne-Algofunctional index in patients with knee and hip osteoarthritis.ằ
Osteoarthritis Cartilage 1998;6:79-86.
7. Garnier E. Programme CURATA : quel AINS oser pour larthrose. Mộdecin du
Quộbec 2001; 36 (10) : 26-28. www.fmoq.org/medecin_du_quebec.htm.
8. Recommendations for the Medical Management of Osteoarthritis of the Hip and
Knee. American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis
Guidelines. Arthritis & Rheumatism, vol 43, N 9, septembre 2000, 43(9) : 1905-
1915. Disponible : />mgmt/oa-mgmt.asp?aud=mem
Rộfộrences
rộvention
en pratique mộdicale
1
Septembre 2004
Larthrose
Un dộfi nouveau pour le mộdecin
L Organisation mondiale de la santộ estime que 10 % de la population mondiale
de plus de 60 ans est atteinte darthrose dune faỗon cliniquement significative,
faisant de ce problốme de santộ un des plus frộquents. Au Quộbec, larthrose
occupe le tout premier rang avec 12 % des Quộbộcois qui sen disent affectộs,
une augmentation de prốs de 2 % depuis 1987. Outre les problốmes de la
colonne vertộbrale, larthrose touche, en ordre dộcroissant, les articulations du
genou,de la hanche et de la main.
Larthrose se manifeste cliniquement deux fois plus frộquemment chez les
femmes et sa prộvalence augmente avec lõge. Toutefois, les auteurs dun rap-
port canadien sur le sujet concluent : ô Alors que larthrite (arthrose) est
frộquemment perỗue comme une maladie de la vieillesse,prốs de trois sujets sur
cinq ayant signalộ souffrir darthrite ou de rhumatisme en 2000 avaient en rộa-
litộ moins de 65 ans ằ.
1
Les consộquences de larthrose sont majeures. Elle limite la mobilitộ la marche
chez plus du tiers des patients et les activitộs quotidiennes chez prốs de la
moitiộ. Aprốs le cancer, larthrose est la cause la plus frộquente de douleurs
chroniques. Elle est aussi une cause importante de perturbations du sommeil,
de dộpression et de baisse de la qualitộ de vie. Les personnes arthrosiques
rapportent deux fois plus dabsences au travail pour cause de maladie et ces
absences sont plus longues.
Le bilan des connaissances actuelles nous indique que larthrose est causộe,
dans un nombre non nộgligeable de cas, par des facteurs de risque qui sont
modifiables. Aujourdhui, avec la majoritộ des patients qui sont jeunes et actifs,
la prộvention prend une importance nouvelle et les pratiques cliniques prộven-
tives deviennent prioritaires. Le mộdecin de premiốre ligne est appelộ, dans les
annộes venir, jouer un rụle accru de conseiller auprốs de ses patients.
Faits saillants
L'arthrose est la premiốre cause
d'incapacitộ et de perte de qualitộ de
la vie en Amộrique du Nord.
L'arthrose nest plus considộrộe
comme une maladie de la vieillesse
avec trois patients sur cinq ayant
signalộ le dộbut de leurs problốmes
avant l'õge de 65 ans.
L'arthrose n'est plus considộrộe par les
experts mộdicaux comme une maladie
inộluctable mais qui se dộveloppe,
comme les maladies cardio-vascu-
laires, partir des facteurs de risque
dont certains sont modifiables.
L'obộsitộ, l'inactivitộ physique et les
stress articulaires au travail ou dans
la pratique sportive de haut niveau,
sont les trois facteurs modifiables
principaux sur lesquels le clinicien et
son patient peuvent agir.
La pratique d'une activitộ physique
rộguliốre selon la tolộrance est un ộlộ-
ment clộ dans la prộvention des inca-
pacitộs et pertes de qualitộ de la vie
chez les patients arthrosiques.
L'ộlimination des stress articulaires
au travail ou dans les sports de haut
niveau est recommandộe dans la
mesure oự ces stress produisent les
signes et symptụmes, particuliốre-
ment pendant les ộpisodes aigus et
chez les jeunes sujets.
Les facteurs de risque
La confộrence de consensus du National
Institute of Health sur larthrose concluait
en 2000 que larthrose ne doit plus ờtre
considộrộe comme une maladie du vieil-
lissement mais comme une maladie qui se
dộveloppe en fonction de facteurs de
risque dont certains peuvent ờtre modifiộs.
2
Il importe donc dagir dốs les premiốres
manifestations cliniques.
Non modifiables
Les facteurs de risque non modifiables
comprennent, en premier lieu, lõge et le
sexe. Chez les femmes, le risque est
deux fois supộrieur, surtout aprốs la
mộnopause. Pour les deux sexes, la prộva-
lence augmente jusqu la septiốme
dộcennie et atteint un plateau. Cette aug-
mentation est en grande partie expliquộe
Un dộfi nouveau pour le mộdecin
Les facteurs de risque
Faits saillants
Si rộponse inadộquate
ou intolộrance
OUI
Septembre 2004 Direction de santộ publique de Montrộal
Source : Choquette D, Bessette L, et le groupe CURATA.
Traitement de l'arthrose: arbre dộcisionnel. Version 2003 en cours de rộvision.
A - FACTEURS DE RISQUE DE COMPLICATIONS DIGESTIVES
(perforation, obstruction, saignement)
ge > 65 ans
ATCD dulcốres peptiques non compliquộs
ATCD de complications digestives
(perforation, obstruction, saignement)
Prise de corticostộroùdes
Prise danticoagulant
Prise dautres AINS incluant lA.A.S. petite dose
ATCD maladie cardiovasculaire
B - AINS ET INSUFFISANCE RẫNALE
Calculer la Clairance de crộatinine (ml/min) :
(140-õge) x poids (kg) x 1,2 (x 0,85 si femme)
S Cr (umol/l)
Si Cl crộatinine < 30 ml/min, ộviter AINS
Si Cl crộatinine 30-60 ml/min, surveillance
Suivi biologique :
ẫlectrolytes, urộe et crộatinine q 5-7 jours x 2 lorsquon initie le
traitement et q 3 mois par la suite. Si augmentation de la dose
dAINS, reprendre la mờme sộquence de contrụles.
C - AINS ET INSUFFISANCE CARDIAQUE
Si de la rộtention hydrosodộe, risque de dộcompensation car-
diaque chez les patients avec dysfonction ventriculaire gauche
sộvốre.
+ Linsuffisance est sộvốre + le risque est ộlevộ
Informer le patient de surveiller les signes et symptụmes
suivants : dyspnộe, apparition ddốme, poids
Traitement de larthrose : Arbre dộcisionnel
Modalitộs non pharmacologiques (enseignement, diốte, physio/ergothộrapie)
Utiliser lacộtaminophốne jusqu une dose maximale (1 gm QID)
Application dun AINS topique
Injection intra-articulaire si possible (corticostộroùdes ou viscosupplộance)
Si rộponse inadộquate
Facteurs de risque de complications digestives
(perforation-obstruction-saignement) Tableau A
Utiliser un COXIB
OUI
NON
ATCD dulcốres compliquộs,
danticoagulant ou õge 75 ans
Favoriser lutilisation dun AINS
non-sộlectif
Pas de
gastro-protecteur
NON
Ajouter un
gastro-protecteur
Si rộponse inadộquate
ou intolộrance
Utiliser un autre AINS
non-sộlectif ou un COXIB
Utiliser un AINS non-sộlectif
avec un gastro-protecteur
Si rộponse inadộquate, considộrer rộfộrence en spộcialitộ
R
x
Rộộvaluer rộguliốrement
lindication et les risques
associộs au traitement
avec un AINS (Tableau E),
la T.A. (Tableau D), les
fonctions cardiaque
(Tableau C) et rộnale
(Tableau B)
Rộộvaluer rộguliốrement le traitement
D - AINS ET TENSION ARTẫRIELLE
Prise de TA q 7 jours x 2 puis q 3 mois
Si de la dose AINS, ou changement dAINS,
reprendre surveillance
Si de TA > 140/90, cesser AINS si possible. Si AINS essentiel,
traiter HTA selon lignes de conduite habituelles
Chez patients diabộtiques : viser TA < 130/80
Si protộinurie de > 1 g/j, viser TA < 125/75
(diabộtique ou non)
E - ẫVALUATION DU RISQUE
GASTRO-INTESTINAL ET CARDIAQUE
Bas Moyen ẫlevộ
Bas
AINS Coxib Coxib + GP
non-sộlectif
Moyen
AINS Coxib Coxib + GP
non-sộlectif
ẫlevộ
Coxib + AAS Coxib + AAS Coxib + AAS
+ GP
Cardiovasculaire
Adaptộ de : C. Baigent, C. Patrono. Selective cyclooxygenase 2 inhibitors, aspirin,
and cardiovascular disease. Arthritis and Rheumatism 2003 48 : 12-20
rộvention
en pratique mộdicale
Gastro-intestinal
Association
des Mộdecins
Omnipraticiens
de Montrộal
Un bulletin de la Direction de santộ publique
de Montrộal publiộ avec la collaboration de
lAssociation des mộdecins omnipraticiens de Montrộal
dans le cadre du programme Prộvention en pratique mộdicale
coordonnộ par le docteur Jean Cloutier.
Ce numộro est une rộalisation de lunitộ Santộ au travail
et santộ environnementale.
Responsable dunitộ : D
r
Louis Drouin
Rộdacteur en chef : D
r
Louis Patry
ẫdition : Deborah Bonney
Infographie : Julie Milette
Auteurs : D
r
Michel Rossignol, D
r
Louis Patry, D
r
Martine
Ballargeon, Ghislaine Tougas, Direction de santộ publique
de Montrộal
Collaboration spộciale : La Sociộtộ darthrite, Division du
Quộbec et les Docteurs Monique Camerlain, rhumatologue
conseil, Centre hospitaler de lUniversitộ de Sherbrooke et
ẫric Rich, Professeur adjoint de rhumatologie, Hụpital
Notre-Dame du CHUM, Universitộ de Montrộal
1301, rue Sherbrooke Est, Montrộal (Quộbec) H2L 1M3
Tộlộphone : (514) 528-2400
courriel:
ISSN : 1481-3734 (version imprimộe)
ISSN : 1712-2937 (version en ligne)
Dộpụt lộgal Bibliothốque nationale du Quộbec, 2004
Dộpụt lộgal Bibliothốque nationale du Canada, 2004
Numộro de convention : 40005583
rộvention
en pratique mộdicale
Forum sur l'arthrite
Jeudi le 21 octobre 2004
de 8 h 00 16 h 30
Hụtel Intercontinental de Montrộal
Organisộ par
La Sociộtộ d'arthrite, Division du Quộbec
Thốmes
Arthrite juvộnile
Impacts psychosociaux
Arthrite et alimentation
Prộvention et enjeux de santộ publique
Diffộrentes formes d'arthrite et d'arthrose
Programme
www.arthrite.ca/quebec
Inscriptions
Montrộal 514-846-8840 poste 221;
extộrieur de Montrộal 1-800-321-1433
4
Prộvention en pratique mộdicale, Septembre 2004
Exercices pour larthrose du
genou et de la hanche
Exercices dont lefficacitộ thộrapeutique
est prouvộe scientifiquement :
Entraợnement aộrobique sur bicyclette
stationnaire ou tapis roulant.
Exercices de musculation (quadriceps,
membres supộrieurs et tronc).
Exercices favorisant la mobilitộ normale
de larticulation.
Principes dapplication :
La prise en charge optimale requiert
une combinaison de modalitộs pharma-
cologiques et non pharmacologiques.
Lapproche devrait comprendre lộduca-
tion des patients et la rộduction du poids
lorsque appropriộe.
Individualiser selon lõge, les co-
morbiditộs (cardiaques et autres limitant
la tolộrance lexercice) et lexcốs
de poids.
Les exercices doivent ờtre rộalisộs sous
la supervision dune personne qualifiộe
au moins au dộbut.
Le niveau doit tenir compte de la stabi-
litộ articulaire, du degrộ de douleur et de
la prộsence de signes inflammatoires.
Choisir et varier les exercices selon le
niveau dactivitộ et de motivation.
Rộfộrences
1. Lagacộ C, et collab., Impact de larthrite sur les Canadiens. dans : Larthrite au
Canada : une bataille gagner. Ottawa : Santộ Canada, 2003. PDF tộlộchargeable :
/>2. Felson DT, ôOsteoarthritis: New Insights: Part I: The Disease and Its Risk
Factors.ằ Annals of Internal Medecine, vol 133, N 8, octobre 2000, p. 635-646.
PDF tộlộchargeable : />3. Lievense AM, Bierma-Zeinstra SM, Verhagen AP, Bernsen RM, Verhaar JA,
Koes BW. ôInfluence of sporting activities on the development of osteoarthritis
of the hip: a systematic review.ằ Arthritis & Rheumatism 2003; 49(2):228-236.
4. Maetzel A, Makela M, Hawker G, Bombardier C. ôOsteoarthritis of the hip and
knee and mechanical occupational exposure a systematic overview of the
evidence.ằ Journal of Rheumatology 1997; 24(8):1599-1607.
5. Camerlain M. ôLa douleur chronique et larthrite: comment y remộdier?ằ
Le Clinicien 2002; nov :73-81.
communications/journals/leclinicien/archive.html
6. Stucki G, Sangha O, Stucki S, Michel BA, Tyndall A, Dick W, Theiler R.
ôComparison of the WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities)
osteoarthritis index and a self-report format of the self-administered
Lequesne-Algofunctional index in patients with knee and hip osteoarthritis.ằ
Osteoarthritis Cartilage 1998;6:79-86.
7. Garnier E. Programme CURATA : quel AINS oser pour larthrose. Mộdecin du
Quộbec 2001; 36 (10) : 26-28. www.fmoq.org/medecin_du_quebec.htm.
8. Recommendations for the Medical Management of Osteoarthritis of the Hip and
Knee. American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis
Guidelines. Arthritis & Rheumatism, vol 43, N 9, septembre 2000, 43(9) : 1905-
1915. Disponible : />mgmt/oa-mgmt.asp?aud=mem
Rộfộrences
rộvention
en pratique mộdicale
1
Septembre 2004
Larthrose
Un dộfi nouveau pour le mộdecin
L Organisation mondiale de la santộ estime que 10 % de la population mondiale
de plus de 60 ans est atteinte darthrose dune faỗon cliniquement significative,
faisant de ce problốme de santộ un des plus frộquents. Au Quộbec, larthrose
occupe le tout premier rang avec 12 % des Quộbộcois qui sen disent affectộs,
une augmentation de prốs de 2 % depuis 1987. Outre les problốmes de la
colonne vertộbrale, larthrose touche, en ordre dộcroissant, les articulations du
genou,de la hanche et de la main.
Larthrose se manifeste cliniquement deux fois plus frộquemment chez les
femmes et sa prộvalence augmente avec lõge. Toutefois, les auteurs dun rap-
port canadien sur le sujet concluent : ô Alors que larthrite (arthrose) est
frộquemment perỗue comme une maladie de la vieillesse,prốs de trois sujets sur
cinq ayant signalộ souffrir darthrite ou de rhumatisme en 2000 avaient en rộa-
litộ moins de 65 ans ằ.
1
Les consộquences de larthrose sont majeures. Elle limite la mobilitộ la marche
chez plus du tiers des patients et les activitộs quotidiennes chez prốs de la
moitiộ. Aprốs le cancer, larthrose est la cause la plus frộquente de douleurs
chroniques. Elle est aussi une cause importante de perturbations du sommeil,
de dộpression et de baisse de la qualitộ de vie. Les personnes arthrosiques
rapportent deux fois plus dabsences au travail pour cause de maladie et ces
absences sont plus longues.
Le bilan des connaissances actuelles nous indique que larthrose est causộe,
dans un nombre non nộgligeable de cas, par des facteurs de risque qui sont
modifiables. Aujourdhui, avec la majoritộ des patients qui sont jeunes et actifs,
la prộvention prend une importance nouvelle et les pratiques cliniques prộven-
tives deviennent prioritaires. Le mộdecin de premiốre ligne est appelộ, dans les
annộes venir, jouer un rụle accru de conseiller auprốs de ses patients.
Faits saillants
L'arthrose est la premiốre cause
d'incapacitộ et de perte de qualitộ de
la vie en Amộrique du Nord.
L'arthrose nest plus considộrộe
comme une maladie de la vieillesse
avec trois patients sur cinq ayant
signalộ le dộbut de leurs problốmes
avant l'õge de 65 ans.
L'arthrose n'est plus considộrộe par les
experts mộdicaux comme une maladie
inộluctable mais qui se dộveloppe,
comme les maladies cardio-vascu-
laires, partir des facteurs de risque
dont certains sont modifiables.
L'obộsitộ, l'inactivitộ physique et les
stress articulaires au travail ou dans
la pratique sportive de haut niveau,
sont les trois facteurs modifiables
principaux sur lesquels le clinicien et
son patient peuvent agir.
La pratique d'une activitộ physique
rộguliốre selon la tolộrance est un ộlộ-
ment clộ dans la prộvention des inca-
pacitộs et pertes de qualitộ de la vie
chez les patients arthrosiques.
L'ộlimination des stress articulaires
au travail ou dans les sports de haut
niveau est recommandộe dans la
mesure oự ces stress produisent les
signes et symptụmes, particuliốre-
ment pendant les ộpisodes aigus et
chez les jeunes sujets.
Les facteurs de risque
La confộrence de consensus du National
Institute of Health sur larthrose concluait
en 2000 que larthrose ne doit plus ờtre
considộrộe comme une maladie du vieil-
lissement mais comme une maladie qui se
dộveloppe en fonction de facteurs de
risque dont certains peuvent ờtre modifiộs.
2
Il importe donc dagir dốs les premiốres
manifestations cliniques.
Non modifiables
Les facteurs de risque non modifiables
comprennent, en premier lieu, lõge et le
sexe. Chez les femmes, le risque est
deux fois supộrieur, surtout aprốs la
mộnopause. Pour les deux sexes, la prộva-
lence augmente jusqu la septiốme
dộcennie et atteint un plateau. Cette aug-
mentation est en grande partie expliquộe
Un dộfi nouveau pour le mộdecin
Les facteurs de risque
Faits saillants
2
Prévention en pratique médicale, Septembre 2004
Tableau 1
Facteurs de risque de l’arthrose
Facteurs non modifiables Description
Âge et sexe Deux femmes pour un homme
Statut oestrogénique
Augmentation avec l’âge
Génétique Anatomie axiale
Race noire plus à risque
Biomarqueurs
Antécédents Traumatisme articulaire
médicaux Maladie ostéoarticulaire
Nodules d’Heberden
Facteurs modifiables Description
Obésité Indice de masse corporelle supérieur à 27 kg/m
2
Inactivité physique : Moins d’une session par semaine d’activité
physique de moins de 20 à 30 minutes
Stress articulaire Au travail
Pratique sportive de haut niveau
par la nature chronique de l’arthrose.
Mais ne nous y trompons pas, c’est pen-
dant la vie active qu’apparaît l’arthrose
dans la majorité des cas. Comme autre
facteur non modifiable mentionnons la
génétique qui peut comprendre des élé-
ments raciaux, anatomiques et biochi-
miques qui sont sans application pratique
pour la prévention en première ligne.
Enfin, il y a plusieurs maladies ostéoarti-
culaires et les antécédents de traumatismes
articulaires qui peuvent s’accompagner
d’arthrose. Pour les traumatismes,
le médecin de famille doit informer son
patient arthrosique du risque encourru
s’il pratique un sport l’exposant à des
traumatismes.
Modifiables
Les facteurs de risque modifiables incluent
l’obésité, l’inactivité physique et le stress
articulaire au travail et dans certaines pra-
tiques sportives de haut niveau.
L’obésité, qui résulte de deux facteurs liés
aux habitudes de vie, l’alimentation et
l’inactivité physique, joue un très grand
rôle dans le développement de l’arthrose,
non seulement de la hanche et du genou
mais aussi de la main par un effet sys-
témique qui est mal connu. On sait aussi
que la réduction du poids chez les
arthrosiques obèses modifie favorablement
l’évolution naturelle de la maladie. Le
risque d’arthrose est surtout observé chez
les personnes dont l’indice de poids cor-
porel est supérieur à 27 kg/m
2
, soit un
poids de 180 livres pour une personne de
taille moyenne (5 pieds et 8 pouces).
L’inactivité physique peut aussi être asso-
ciée à l’arthrose du genou indépendam-
ment de l’obésité, par un effet de faiblesse
musculaire du quadriceps. En résumé, pour
les habitudes de vie, la réduction du poids
et la promotion de l’activité physique sont
deux éléments clés et synergiques dans la
prévention de l’arthrose.
Arthrose, travail et sport
Les stress biomécaniques imposés aux arti-
culations dans certains types d’emplois et de
pratique sportive de haut niveau contribuent
à l’apparition et à l’aggravation de l’arthrose
(tableau 2)
3,4
. Il importe de signaler que
les connaissances scientifiques sur le sujet
confirment que ce sont les activités de
travail ou de sport pratiquées profession-
nellement qui sont associées à l’arthrose
et non la pratique ludique d’une activité
même si c’est de façon régulière.
L’hypothèse courante pour expliquer la
contribution du travail et du sport dans
l’arthrose est l’accumulation au cours de
la vie de microtraumatismes qui favorisent
une réponse inflammatoire ou immunitaire
chronique. En corollaire de cette hypothèse,
le développement et l’aggravation de
l’arthrose peuvent être évités si la fréquence
des microtraumatismes peut être réduite.
Même si les éléments de preuve sont suf-
fisants pour lier l’arthrose aux stress articu-
laires en milieu de travail, on ne connaît
pas précisément la nature de ces stress.
Pour la main et le poignet, ils seraient
principalement associés à la répétition de
mouvements particulièrement lorsque le
rythme de travail est imposé de façon
rigide. Pour le genou et la hanche, le
travail de force comme la manutention
d’objets lourds, le maintien prolongé de la
posture à genou et l’exposition aux vibra-
tions du corps entier contribueraient au
développement de l’arthrose.
Le défi du médecin
Comme clinicien, l’anamnèse détaillée des
signes et symptômes articulaires récurrents
ou chroniques revêt une grande importance
pour la prévention parce que c’est ainsi
Tableau 2
Arthrose, travail et sport
Si on exclut les problèmes d’arthrose
de la colonne vertébrale, des preuves
scientifiques existent pour lier arthrose
et travail, ou arthrose et sport.
Des exemples de métiers ayant
démontré un excès d’arthrose :
• Cultivateurs (hanche)
• Poseurs de planchers et de
revêtements (genou)
• Travailleurs de chantier naval (genou)
• Bûcherons (non spécifié)
• Mineurs (genou)
• Préposés à l’entretien ménager
(non spécifié)
• Chauffeurs de camions (non spécifié)
Des exemples de sports professionnels
ayant démontré un excès d’arthrose :
• Course de fond (niveau compétitif)
(hanche)
• Soccer professionnel (hanche)
• Danseurs de ballet (hanche)
3
Prévention en pratique médicale, Septembre 2004
Fiche 1
Anamèse des facteurs de risque d’arthrose
Sexe : ______________________________ Âge : __________________________________
Localisation de l’arthrose : ______________________________________________________
Âge au début des symptômes : ________________ Taille et poids : ____________________
Antécédent de blessure, maladie ou difformité articulaire : ____________________________
____________________________________________________________________________
Type de travail et horaires de travail : ______________________________________________
Activité sportive professionnelle ou compétitive : ____________________________________
Pratique d’activité physique régulière : ____________________________________________
Au travail
Dans les sports
et loisirs
Tâche(s)/
mouvement(s)
Nature des
signes/symptômes
Articulation(s)
affectée(s)
Durée du
problème
Anamnèse des stress articulaires qui produisent
les signes et les symptômes au travail ou dans les sports
(Séances d’un minimum de 20 à 30 minutes, au moins deux ou trois fois par semaine sur une
période continue d’au moins trois mois dans la dernière année.)
* Cette fiche est disponible en format PDF sur le site Internet de la Direction de santé
publique : www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdfppm/ppmsept04fiche.pdf
qu’on pourra identifier avec le patient des
sources de stress articulaire. La fiche ci-
dessus résume les éléments d’anamnèse
qui aident à identifier chez un patient les
facteurs modifiables et non modifiables
associés à l’arthrose. Dans les cas où le
clinicien identifie des tâches ou des mou-
vements qui reproduisent les signes et les
symptômes, soit au travail ou dans les
sports, il convient de conseiller au patient
d’éviter ces stress au moins pendant les
épisodes aigus. Par ailleurs, un patient
arthrosique doit être encouragé à poursui-
vre toutes ses activités normales de travail
et de loisir dans la mesure où ces activités
n’induisent pas de douleur.
Soigner c’est
prévenir
prévenir c’est
aussi soigner!
La raison de consultation du malade
arthrosique est généralement la douleur, la
raideur et les difficultés fonctionnelles
dans la vie de tous les jours. Le premier
défi posé par l’arthrose est le contrôle de la
douleur qui est souvent persistante. Une
évaluation du patient, à l’aide d’une échelle
du statut fonctionnel (voir encart)
5-6
permet
de faire un choix judicieux des traitements
pharmacologiques et non pharma-
cologiques. Le programme québécois
CURATA (Concertation pour une utilisation
raisonnée des anti-inflammatoires dans le
traitement de l’arthrose) vient en aide au
médecin traitant en proposant un arbre
décisionnel pour relever ce défi thérapeu-
tique (voir encart).
7
Toutefois, comme il n’existe pas de
traitement médical curatif de l’arthrose,
la prévention doit aussi être considérée
comme une façon de soigner à long
terme. Bouger tout en protégeant l’arti-
culation touchée, voilà ce que le
médecin doit expliquer à son patient
ainsi que la complémentarité de ces
deux principes. Pour bien conseiller son
patient, le médecin doit connaître les
facteurs de risque en cause et identifier
les stress biomécaniques qui semblent
associés aux signes et symptômes (fiche
d’anamnèse). En questionnant bien son
patient, le médecin qui identifie une
source de stress articulaire au travail
peut faire une recommandation pour
réduire ce stress temporairement ou
l’éliminer si les signes et symptômes
sont récurrents ou chroniques. Plus cette
recommandation sera précise, plus elle
sera applicable.
Un régime personnalisé d’exercices,
enseigné et suivi au début par des profes-
sionnels du domaine, fait partie des
recommandations nord-américaines et
européennes pour la prise en charge du
patient arthrosique.
8
Le recours à des pro-
fessionnels qualifiés aide le patient à
respecter le principe de protection articu-
laire tout en maintenant ses activités le
plus normalement possible. Les modalités
d’application de ces recommandations
sont fondées sur le rôle central de l’omni-
praticien en raison de sa connaissance du
patient, de son état général, de sa motiva-
tion, de l’évolution de sa maladie et de la
présence de facteurs de risque modifiables
et non modifiables.
Soigner c’est
prévenir
prévenir c’est
aussi soigner!
Exploration de l’incapacité fonctionnelle
Indice de Lequesne • Coxarthrose
1. Douleur ou gène
• La nuit ?
Non 0
Seulement en remuant ou selon la posture 1
Même immobile 2
• Lors du dérouillage matinal ?
Moins d’une minute 0
Pendant 1 à 15 min 1
Pendant plus de 15 min 2
• Lors de la station debout une demi-heure ?
Non 0
Oui 1
• Lorsque vous marchez ?
Non 0
Seulement après une certaine distance 1
Très rapidement et de façon croissante 2
• Votre hanche vous gêne-t-elle lorsque vous restez assis longtemps (2 heures) et avant de vous relever ?
Non 0
Oui 1
2. Périmètre de marche maximal
Aucune limitation 0
Limite mais supérieur à 1 km 1
Environ 1 km (environ 15 min) 2
500 à 900 m (environ 8 à 15 min) 3
300 à 500 m 4
100 à 300 m 5
Moins de 100 m 6
Une canne ou une béquille nécessaire +1
Deux cannes ou deux béquilles nécessaires +2
3. Difficultés dans la vie quotidienne (
Cotation : 0 = Néant; 0,5 = Petite; 1 = Moyenne; 1,5 = Grande; 2 = Impossibilité)
Mettre vos chaussures? 0 à 2
Ramasser un objet à terre? 0 à 2
Monter ou descendre un étage? 0 à 2
Sortir d’une voiture ou d’un fauteuil profond? 0 à 2
*Score obtenu :
Indice de Lequesne • Gonarthrose
1. Douleur ou gène
• La nuit ?
Non 0
Seulement en remuant ou selon la posture 1
Même immobile 2
• Lors du dérouillage matinal ?
Moins d’une minute 0
Pendant 1 à 15 min 1
Pendant plus de 15 min 2
• Lors de la station debout une demi-heure ?
Non 0
Oui 1
• Lorsque vous marchez ?
Non 0
Seulement après une certaine distance 1
Très rapidement et de façon croissante 2
• Pour vous relevez d’un siège sans l’aide des bras ?
Non 0
Oui 1
2. Périmètre de marche maximal
Aucune limitation 0
Limite mais supérieur à 1 km 1
Environ 1 km (environ 15 min) 2
500 à 900 m (environ 8 à 15 min) 3
300 à 500 m 4
100 à 300 m 5
Moins de 100 m 6
Une canne ou une béquille nécessaire +1
Deux cannes ou deux béquilles nécessaires +2
3. Difficultés dans la vie quotidienne (
Cotation : 0 = Néant; 0,5 = Petite; 1 = Moyenne; 1,5 = Grande; 2 = Impossibilité)
Monter un étage? 0 à 2
Descendre un étage? 0 à 2
Vous accroupir? 0 à 2
Marcher en terrain irrégulier? 0 à 2
*Score obtenu :
* On peut considérer une gonarthrose/coxarthrose cliniquement significative à partir de 6 à 8 points
(1-4 = minime; 5-7 = moyenne; 8-10 = importante; 11 ou plus = très importante)
Septembre 2004 • Direction de santé publique de Montréal
Fiche 1
Anamnèse des facteurs de risque d’arthrose
Sexe : _____________________________________ Âge :__________________________________________
Localisation de l’arthrose : ____________________________________________________________________
Âge au début des symptômes : ____________________ Taille et poids : ______________________________
Antécédent de blessure, maladie ou difformité articulaire : ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Type de travail et horaires de travail : __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Activité sportive professionnelle ou compétitive : ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Pratique d’activité physique régulière : ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Au travail
Dans les sports
et loisirs
Tâche(s)/
mouvement(s)
Nature des
signes/symptômes
Articulation(s)
affectée(s)
Durée du
problème
Anamnèse des stress articulaires qui produisent
les signes et les symptômes au travail ou dans les sports
(Séances d’un minimum de 20 à 30 minutes, au moins deux ou trois fois par semaine sur une période continue
d’au moins trois mois dans la dernière année.)
Septembre 2004 - Direction de santé publique de Montréal
révention
en pratique médicale
Chart 1
History of risk factors for osteoarthritis
Sex: ______________________________________ Age: ___________________________________________
Location of osteoarthritis: ____________________________________________________________________
Age at onset of symptoms:____________________ Height and weight: ______________________________
History of injury, disease or joint deformity:______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Type of work and work schedule: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Professional or competitive sport activities:______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Regular physical activity: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
At work
When practising
sports or leisure
activities
Task(s)/
movement(s)
Nature of
signs/symptoms
Joint(s)
affected
Duration
History of joint strain resulting in signs
and symptoms at work or when practising sports
(Sessions lasting a minimum of 20 to 30 minutes, at least two or three times a week over an uninterrupted period of
three months during the last year.)
September 2004 - Direction de santé publique de Montréal
révention
en pratique médicale
Au niveau international
Les taux de grossesse chez les adolescentes de 15 à 19 ans
montrent des écarts importants entre les pays. Ces taux
oscillent de 101,7⁄1000 dans la Fédération russe, à
83,6⁄1000 chez nos voisins américains, 12,2⁄1000 aux Pays-
Bas et 10,2⁄1000 au Japon. Le Québec, comme le Canada, se
situe aux niveaux intermédiaires alors que Montréal se
rapproche davantage des taux les plus élevés.
Au Québec
En 1997, en excluant les taux au Nunavik (174,6⁄1000) et
dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James (152,3⁄1000), c'est
dans la région de Montréal que les taux de grossesse des 15-
19 ans sont les plus hauts (58,9 pour 1000), le Bas-Saint-
Laurent ayant les plus faibles (22,2⁄1000). Par contre, la
proportion d'avortement est la plus élevée pour les adoles-
centes résidant à Laval (67,1 %), suivie de Montréal (64,2 %),
alors que les adolescentes autochtones poursuivent en
majorité leur grossesse (15,2 % et 11,1 % d'avortement).
À Montréal
D'importants écarts dans les taux de grossesse et d'avorte-
ment existent entre les territoires de CLSC montréalais, bien
que, dans la métropole, les adolescentes aient un accès assez
facile aux services de contraception et d'avortement. Or, les
taux de grossesse chez les 14-19 ans varient de 105,9⁄1000
à 19,2⁄1000 suivant une corrélation inverse avec le niveau
socio-économique des territoires de CLSC. Des différences
locales sont aussi à prévoir au sein des autres régions.
1
révention
en pratique médicale
Septembre 2003
PRÉVENIR LA GROSSESSE À L’ADOLESCENCE
Défi ou illusion ?
Définitions
•Grossesse à l'adolescence : grossesse chez les moins de 20 ans.
•Taux de grossesse (niveau international) : naissances + avortements.
•Taux de grossesse (Québec, Montréal) : naissances + avortements +
fausses couches + mortinaissances.
Grossesses et issues chez les adolescentes de 15 à 19 ans,
pays développés, (taux pour 1000 adolescentes)
Grossesses et issues chez les adolescentes de 14 à 19 ans,
CLSC de Montréal, 1995 à 1998
(taux pour 1000 adolescentes)
Source : Teenage Sexual and Reproductive Behavior in Developed Countries,
Can More Progress Be Made ?, Nov. 2001. The Alan Guttmacher Institute
Source : Pour Québec et Montréal : MSSS, fichier grossesses, 1996
Problèmes d’une grossesse
à l’adolescence
De multiples déterminants
Les grandes variations statistiques des taux de grossesse et de leurs
issues originent de causes complexes allant des politiques publiques aux
conditions sociologiques, économiques et culturelles diverses. Celles-ci
génèrent des conditions de vie et des normes sociales qui influencent
les comportements sexuels des jeunes, filles et garçons, et s'imbriquent
à leurs expériences et à leurs caractéristiques individuelles.
2
P révention en pratique médicale, Septembre 2003
Taux de grossesse stables depuis près de 10 ans au Québec
Selon les tendances des données 1993-1998, les taux de grossesse sont
demeurés stables dans la dernière décennie dans tous les groupes d'âge
(<15 ans, 15-17 et 18-19 ans) au Québec et chez les 15-17 ans et les
18-19 ans à Montréal. Dans tous les groupes d'âge, les taux montréalais
dépassent constamment ceux de la province même si ceux des moins de
15 ans ont diminué (de 8,8/1000 à 5,3/1000) pour se rapprocher des
taux du Québec (4,3/1000). Notons que les taux de grossesse chez les
18-19 ans dépassent toujours ceux des plus jeunes.
Taux d’avortement en augmentation chez les 18-19 ans
La progression constante des taux d'avortement est la particularité
do-minante chez les 18-19 ans à Montréal (52,5/1000 à 58,3/1000) et
au Québec (33,5/1000 à 38,6/1000) de 1995 à 1998. L'effet net se
traduit par une diminution des naissances dans cette population
(31,6/1000 à Montréal; 26,7/1000 au Québec). Chez les adolescentes de
15 à 17 ans, les taux d’avortement sont demeurés constants depuis 1995
à Montréal (24,4/1000) alors qu’ils augmentent pour l’ensemble du
Québec (17,4/1000, 1998).
Des issues de grossesse différentes selon l’âge et le milieu
Ce qui distingue les groupes d'âge, c'est surtout la proportion d'avorte-
ment par rapport aux grossesses. Plus les adolescentes sont jeunes, plus
souvent elles font le choix de l'avortement : près de 79 % chez les moins
de 15 ans, près de 70 % entre 15 et 17 ans et 60 % entre 18-19 ans
(62.3 % Montréal, 56.4 % Québec). Pour l'ensemble du groupe des 15-
19 ans, la moyenne de 61% du Québec tend de plus en plus à rejoindre
celle observée à Montréal (65 %).
De plus, l'augmentation du niveau socio-économique s'accompagne de
moins de grossesses et d'une proportion plus grande d'avortements. On
observe le phénomène inverse dans les milieux défavorisés où les ado-
lescentes choisissent en plus grand nombre de donner naissance. La
culture et l'origine ethnique sont des facteurs d'influence additionnels.
Un choix non délibéré
La grossesse à l'adolescence n'est pas un choix délibéré pour la très grande
majorité des adolescentes, comme l'indiquent les taux élevés de recours à
l'avortement. En général, ce dernier ne laisse pas de séquelles psy-
chologiques, à moins que l'adolescente n'y ait été contrainte. Même si les
risques cliniques sont minimes, il n'est cependant pas un acte banalisé par
les jeunes filles.
Seules quelques-unes d’entre-elles décident consciemment de devenir
enceintes et d'avoir un bébé. D'autres, devant le constat de leur grossesse,
la poursuivront pour des motifs très variables allant du fatalisme à des
raisons morales en passant par le sens du devoir.
Pauvreté chronique à l’horizon
Les adolescentes qui poursuivent leur grossesse n'ont pas plus de compli-
cations obstétricales que les femmes adultes dans notre système de santé,
et elles ont moins de césariennes. Par contre, plus elles sont jeunes, plus
leur nouveau-né naît prématurément (de 8,5 % pour les 18-19 ans à 9,5 %
pour les 15-17 ans et 10,7 % chez les moins de 15 ans). Le pourcentage
plus élevé de retard de croissance intra-utérine (11,5 % < 20 ans) semble
surtout relié aux conditions socio-économiques défavorables avant et pen-
dant la grossesse, et particulièrement à l'absence de réseaux d'entre-aide.
En raison de leur immaturité psychologique, de leurs habiletés de parentage
encore peu développées, de leur grande vulnérabilité économique et du con-
texte souvent difficile dans lequel plusieurs vivent, ce sont de futures mères
qui risquent d'être rapidement confrontées à des conditions de vie
exigeantes et stressantes. Elles bénéficient souvent de peu de soutien pour
combiner soins à l'enfant, poursuite des études ou l'amélioration de leur
situation. Après quelque temps, elles sont aussi fréquemment délaissées par
leur partenaire, si elles en avaient un.
▼
▼
▼
▼
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998
Montréal Québec Grossesses Avortements
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
Taux pour 1000
15-17 ans
15-17 ans
15-17 ans
15-17 ans
18-19 ans
18-19 ans
18-19 ans
▼
Taux de grossesse et d’avortement pour 1000 adolescentes
de 15-17 ans et 18-19 ans, Montréal et Québec, 1993-1998
La pauvreté : une cause fréquente et un risque important
d'une grossesse menée à terme à l'adolescence.
18-19 ans
Pour une approche globale
Pour mieux comprendre et apprécier la potentialité d'une grossesse pré-
coce ou de comportements à risque et faciliter l'identification des
éléments les plus pertinents à considérer en clinique et ce, tant pour les
filles que les gars, le schéma ci-contre présente une synthèse des
principaux déterminants de la grossesse à l'adolescence.
Les cercles concentriques, de l'extérieur vers le centre, illustrent l’influence
grandissante de ces déterminants sur les décisions individuelles. Il est
cependant clair qu'il existe une interdépendance entre chacun, tant à
l'intérieur de chaque cercle qu'entre les cercles eux-mêmes, et que tous
n'interpellent pas le médecin au même degré. Il faut aussi reconnaître
que les choix et les décisions ultimes de chaque jeune, bien qu'influencés
par ces déterminants, ne peuvent se réduire au seul effet de ces
derniers.
3
P révention en pratique médicale, Septembre 2003
Cercle 1 • Au cœur de l’intervention médicale
Motivation et capacité, des incontournables
L'évaluation de la motivation de l'adolescente et de ses capacités est
essentielle afin de proposer une méthode contraceptive la mieux adap-
tée aux besoins de la jeune fille et d'offrir des recommandations appro-
priées pour une sexualité saine et une diminution des risques potentiels.
Motivation
Capacité
A
c
c
è
s
a
u
x
s
e
r
v
i
c
e
s
d
e
s
a
n
t
é
V
a
l
e
u
r
s
Les principaux déterminants de la grossesse à l’adolescence
C
u
l
t
u
r
e
A
c
c
è
s
à
l
’
é
d
u
c
a
t
i
o
n
s
e
x
u
e
l
l
e
E
n
t
o
u
r
a
g
e
e
t
m
i
l
i
e
u
d
e
v
i
e
T
r
a
v
a
i
l
•
S
c
o
l
a
r
i
s
a
t
i
o
n
•
R
e
v
e
n
u
T
y
p
e
d
e
r
e
l
a
t
i
o
n
•
P
r
o
j
e
t
s
d
’
a
v
e
n
i
r
R
i
s
q
u
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
•
C
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
s
,
m
y
t
h
e
s
•
Â
g
e
35
2
4
1
3524
Pour évaluer la motivation :
• vérifier d'abord la fermeté de l'intention de ne pas devenir enceinte
durant son adolescence;
• en valider la concordance avec ses actions si elle est déjà sexuellement
active;
• discuter des mesures de protection utilisées et de leur constance;
• questionner sur les difficultés rencontrées dans leur utilisation,
personnellement ou avec le partenaire;
• dépister l'
ambivalence, dont les indices peuvent être :
- l'indifférence d'avoir un bébé durant l'adolescence. « Ça m'est égal »;
- la crainte d'infertilité;
- le signe de passage à la vie adulte et l'amélioration du statut dans
la famille et avec les pairs;
- le désir conscient d'un enfant mais ambivalence à ce sujet —
vérifier les motifs.
Quant aux
capacités ou habiletés personnelles, c'est à travers l'ensemble
de la consultation qu'elles pourront se dégager. Elles se composent d'élé-
ments tels que :
• l'estime de soi et l'autodétermination;
• la capacité de négocier avec le partenaire (le rapport de force de
l’adolescente avec son partenaire peut être moindre s’il est plus âgé);
• la maîtrise des méthodes utilisées — du condom aux contraceptifs;
• ne pas oublier la capacité financière de payer des contraceptifs !
Source : Mireille Lajoie, 2003
Cercle 2 • Pour y voir plus clair
Cinq facteurs influencent particulièrement la motivation et les capacités
et méritent une attention spécifique au moment de l'entrevue.
1. Pas encore une adulte !
La capacité de reproduction précède la maturation psychologique. Celle-
ci dépend de l'accélération de la complexification du système cérébral
au début de l'adolescence dans les régions reliées à l'impulsivité, la
motivation et la capacité de planification et d'abstraction.
L'immaturité peut se traduire par une inconscience des enjeux, une notion
imprécise du temps (date des dernières menstruations, oublis de pilules ou
de rendez-vous); des habiletés non développées (quoi faire avec une pres-
cription, comment la faire remplir ?); des priorités et un budget différents
d'une adulte (la contraception perd en compétition avec d'autres « néces-
sités » tel un vidéo, ); l'impulsivité d'une relation sexuelle, etc.
2. Quels sont ses projets d’avenir ?
Le jeune est en quête de sens et de reconnaissance dans son passage à
la vie adulte.
La présence de projets d'avenir précis appuyés sur la croyance en ses
possibilités d'y arriver est un facteur protecteur. Lorsque les options
semblent limitées (décrochage scolaire), qu'il n'y a pas de projets
d'avenir d'envisagés ou qu'ils ne sont pas perçus comme possibles, le
choix de la naissance d'un enfant et la création d'une famille peut
donner un sens à la vie et une place dans la société.
3. Des connaissances
à rectifier, des mythes à débusquer ?
• Les connaissances erronées ou insuffisantes et les appréhensions des
effets secondaires de la contraception : (fait grossir — motif le plus
fréquent de la cessation de la contraception ;
spotting, aménorrhée et
crainte d'infertilité surtout avec les méthodes progestatives et la
contraception orale combinée ou COC; peur du cancer, ).
• Des mythes tels que :
- n'a pas besoin de contraception puisque n'est pas fertile n'étant
pas devenue enceinte même si aucune protection depuis
Vrai aussi chez les garçons qui se pensent infertiles dans les
mêmes conditions;
- se pense trop jeune pour devenir enceinte;
- ne prévoit pas être active sexuellement (même si l'a déjà été);
- pas de grossesse si pas d'orgasme.
Un rappel : 15 % des jeunes de 15 à 19 ans ont eu une première rela-
tion sexuelle avant l'âge de 15 ans et, en moyenne, 58,7 % de ce
groupe d'âge sont actifs sexuellement (Enquête 1998). De plus, dans
l'Enquête de 1999, 4,2 % des jeunes de 13 ans avaient déjà eu une
première relation sexuelle.
4
P révention en pratique médicale, Septembre 2003
Attention aux messages qui font peur ! Si vous dites que son infection
au chlamydia est une cause d'infertilité (≈10 % à une 1
re
atteinte inflam-
matoire pelvienne — AIP), l'adolescente peut en déduire : « Je n'ai plus
besoin de me protéger » ou « Je vais vérifier si je suis encore fertile » !
4. Une vie d
éjà chargée ?
Des situations de risque de grossesse précoce à reconnaître :
• un avortement antérieur accepté sous pression, être déjà mère
adolescente (30 % à 50 % à nouveau enceintes dans les 2 ans) ou être
dépressive;
• la présence de risques multiples (décrochage scolaire, dépendances
aux drogues, à l’alcool ou aux jeux de hasard, amis ou partenaires
eux-mêmes à risque, viol, première relation précoce et souvent non
désirée, violence et abus dans l'enfance ou violence dans la relation
amoureuse);
• plus ils sont jeunes, plus ils ont de partenaires, plus ils sont à risque.
5. ITS et/ou grossesse ?
Prévenir les grossesses et prévenir les infections transmises
sexuellement (ITS et SIDA) : deux préoccupations concomitantes pour
le médecin et l'adolescente. D'où l'importance de regarder la nature et
la durée des relations avec leur(s) partenaire(s) et de voir ensemble les
facteurs de risques potentiels. Beaucoup d'adolescentes modulent
d'ailleurs leur mode de contraception (condom et/ou contraception
hormonale) selon leur propre appréciation des risques de ITS et de
grossesse, la prévention des grossesses étant leur souci principal.
• Dans les
relations occasionnelles, avec de nouveaux partenaires et
lorsqu'elles en ont plusieurs, de même lors de la toute première
relation sexuelle, l'usage du condom est plus fréquent et souvent le
seul mode de protection chez les plus jeunes du moins .
• C'est dans le cadre d'une
relation continue que la grossesse est
plus fréquente. Plus des 2/3 des jeunes de 16 ans n'avaient eu qu'un
partenaire au cours de l'année précédant l'Enquête de 1999. Comme
preuve de confiance mutuelle et avec la perception d'un risque moindre
de ITS, les adolescentes passent souvent du condom à la contraception
orale uniquement. Par contre, si son partenaire est plus vieux et
qu'elle pense qu'il désire un enfant, il peut être difficile de négocier une
contraception (avec condom surtout).
• Cependant, 12 % n'utilisent aucune contraception (85-90 % de
« chance » de devenir enceinte à l'intérieur d'un an). Si 80 % des
garçons et 75,7 % des filles de 16 ans se sont protégés contre une
grossesse à leur première et dernière relations sexuelles (partenaires
occasionnels ou réguliers), cette protection n'est pas constante avec
le condom. Les oublis sont fréquents avec la contraception orale : 20 %
des adolescentes oublient de la prendre au moins 2 fois par mois ! Or
combien savent vraiment recourir à une contraception orale d'urgence
(COU) en cas d'imprévu ?
5
P révention en pratique médicale, Septembre 2003
Comment les Hollandais réussissent-ils à avoir les taux de grossesse
parmi les plus bas (12,2/1000, 15-19 ans) ? Cette situation s'expli-
querait d'abord par une attitude libérale face à la sexualité à l'adoles-
cence associée à des messages sociétaux clairs du type : «Parlons-en
ouvertement et si vous décidez d'être actifs, protégez-vous, vous êtes
trop jeunes pour assumer les responsabilités de parents». À celle-ci, s'a-
joutent une bonne éducation sexuelle, la gratuité des contraceptifs et la
légalisation des avortements. En somme : accessibilité élargie à des
services pour les jeunes, ouverture et éducation. Il reste encore beau-
coup à faire au Québec !
La qualité des services, une tâche à la portée du médecin
Le médecin, un guide pour des jeunes en phase d’apprentissage
Non, ils ne savent pas tout ! Pour contrer les effets de l'immaturité, il
faut de la sensibilité aux difficultés rencontrées par ces jeunes adoles-
centes. Il peut être nécessaire d’envisager un encadrement, un
« pilotage » plus étroit, de vérifier la bonne compréhension des instruc-
tions fournies et d’adapter les modes de contraception surtout lorsque
l'activité sexuelle débute tôt.
Cela peut impliquer un travail étroit avec les infirmières pour les accom-
pagner et leur offrir du
counselling. Des ententes avec des pharmaciens
peuvent être indiquées.
Une structure d’accueil accessible
Clinique ouverte aux jeunes (posters, dépliants d'information), horaires
les plus flexibles possibles (il faut parfois « attraper au vol » les ado-
lescentes à risque multiples, les plus jeunes ou celles très impulsives).
Être attentif à ses propres attitudes
Si vous êtes mal à l'aise comme médecin à traiter de sexualité avec les
jeunes, mieux vaut les orienter vers des collègues. Votre malaise et vos
questionnements pourraient interférer avec le développement d'un lien
de confiance avec la jeune fille, lien nécessaire à une bonne com-
préhension de ses besoins.
Confidentialité
Rassurer l’adolescente sur la confidentialité de l'entrevue tout en pré-
conisant, surtout chez les moins de 17 ans, de la rencontrer avec ses
parents. Ces derniers peuvent être des alliés. Pour les moins de 14 ans,
c'est le jugement clinique sur l'urgence de la situation qui déterminera
la meilleure façon d'aviser les parents.
Donner une information juste
Les jeunes n'aiment pas se faire dire quoi faire mais ils apprécient pou-
voir choisir leur mode de contraception à partir d'informations claires et
pertinentes à leur situation.
Devant l'ambivalence, clarifier la méfiance vis-à-vis la contraception,
souligner l'impact de la naissance d'un enfant sur la fin de la vie d'adoles-
cente et ses conséquences à court et à long terme, et les exigences —
temps, énergie, finances — pour donner des soins adéquats à l'enfant.
L’amener à s’ouvrir à d'autres options de projets de vie et l’orienter vers un
soutien ou du
counselling.
Contraception, quelques pistes
• L'examen pelvien : non essentiel pour une première visite en vue d'une
contraception si aucun facteur de risque. Cause fréquente de délai de con-
sultation chez les adolescentes.
Cercles 4 et 5 • Valeurs, culture et clinique ?
Cercle 3 • Signaux d’alerte pour le médecin
Les facteurs sociologiques et économiques contribuent à différencier les
groupes de jeunes dans leurs comportements sexuels et leur exploration
peut alerter le médecin sur les niveaux de risque de grossesse précoce.
Connaissez-vous son milieu et son entourage ?
Des relations sexuelles hâtives et l'usage ou non de moyens de protection
peuvent être influencés par différentes situations.
« Tout le monde le fait »
• Des normes sociales locales et la pression des pairs (besoin d'appar-
tenance et développement d'identité par l'expérimentation, perception
d'un gain de statut) et l'impression d'une grande prévalence du nom-
bre de jeunes sexuellement actifs à l'école ou dans le milieu (suresti-
mation fréquente).
« On se parle ? »
• La qualité des relations et des communications avec les parents et la
perception par les adolescentes des attentes de ces derniers à retarder
la première relation sexuelle ou à se protéger : des facteurs de protection.
• L'origine ethnique et la durée d'immigration (1re relation avant 20 ans :
18,7 % si nées à l'étranger; 49,4 % si nées au Canada) : un écartèlement
entre deux cultures, un sujet tabou chez les parents, une activité à
nier, une ignorance des façons de se protéger ou encore des
« pilules » à cacher et ainsi trop souvent oubliées.
« La place d'une fille, c'est »
• La valorisation, par la famille ou le milieu, d'une famille rapidement
commencée plutôt que la performance et la réalisation individuelle;
ou une sœur ou amie qui ont eu un bébé à l'adolescence.
« Y'a-t-il quelqu'un ? »
• La supervision du temps libre des jeunes, des loisir et des sports avec
coaching et appui d'adultes : valorise les jeunes tout en minimisant
les occasions à risque.
Travail, scolarisation et niveau de revenu, quels impacts ?
Quelques exemples d'effets de certaines conditions socio-économiques
sur des aspects du comportement sexuel.
Comportements
Si aux études
seulement
Si au travail
seulement
Revenus
familiaux
élevés
Revenus
familiaux
faibles
Filles
sexuellement actives
(15-17 ans)
Usage du
condom
(filles)
(15-19 ans)
Plus d’un
partenaire
(filles)
(15-19 ans)
31,7 %
79,8 %
16,2 %
56,6 %
60,8 %
26,8 %
35,2 %
76 %*
18,9 %
50,6 %
81 %*
35,9 %
* Différence non significative
Source :
The Canadian Journal of Human Sexuality, Vol.9(1) Spring 2000.
6
Association
des Médecins
Omnipraticiens
de Montréal
P révention en pratique médicale, Septembre 2003
Aucune amélioration significative en prévention de la grossesse à l'ado-
lescence n'a eu lieu depuis 10 ans au Québec en dépit des changements
de cohorte de jeunes. L'absence de gratuité des contraceptifs est une
barrière majeure auprès des jeunes. Les cliniques pour adolescents sont
insuffisantes et les services d'éducation sexuelle et de marketing socié-
tal aléatoires. Dans ce presque vacuum, le rôle du médecin peut être un
facteur déterminant d'une grossesse évitée.
Un défi de société, une contribution
médicale indispensable
Toute consultation d'une adolescente ou d'un adolescent — quel que
soit le motif — devrait être vue comme une opportunité pour explorer
la sphère de l'activité sexuelle et les mesures de protection et de
contraception prises ou envisagées. Si les raisons de consultation
d'une adolescente sont vagues, une crainte de grossesse pourrait bien
en être la source !
• />• Anda, Robert F. et al, « Adverse Childhood Experiences and Risk of Paternity in Teen
Pregnancy », Obstetric & Gynecology 2002, vol. 100, no 1, p. 37-45.
• Bérubé, Jocelyn, « Prévention des grossesses non désirés : comment intervenir ? »
Le
médecin du Québec 1999, vol. 34, no 6, p. 63-68.
• Burns, Vicki Ellison, « Factors Influencing Teenage Mother’s Participation in
Unprotected Sex »,
JOGNN 1999, vol. 28, no 5, p. 493-500.
• Dechêne, Geneviève. « Les nouveautés en contraception ».
Le Clinicien, avril 2003, vol.
18, no 4, p. 121-128.
• Donovan, Basil, « Never underestimate the force of reproduction: Effective contracep-
tion for teenagers requires a change in medical culture »,
British Medical Journal 2000,
vol. 321, p. 461-462.
• Guilbert,Édith, Francine Dufort, Louise Saint-Laurent. « L'usage de la contraception à
l'adolescence; perceptions des adolescents et des professionnels ».
PRO-ADO, volume 11
numéro 1 & 2, juin 2002 (traduction de Journal SOGC, vol. 23, no 4, Avril 2001, p. 329-
333).
• Institut de la statistique du Québec. Enquête sociale et de santé auprès des enfants et
des adolescents québécois 1999. Chapitre 12, Sexualité et mesures préventives contre
les MTS et la grossesse et Enquête sociale et de santé 1998.
• Stevens-Simon, Catherine et al., « To Be Rather Than Not To Be — That Is the Problem
With the Questions We Ask Adolescents About Their Childbearing Intentions ».
Arch
Pediatr Adolesc Med. 2001 ; 155:1298-1300.
•
Société des obstétriciens et gynécologues du
Canada.
•
Donne accès à d'autres sites pour les
jeunes et les professionnels.
•
The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy —
USA.
•
h03-01.htm La contraception d'urgence,
Société canadienne de pédiatrie, mars 2003.
•
Adolescents and OCs. Paula J. Adams
Hillard, MD (statistiques américaines).
Quelques références
révention
en pratique médicale
Un bulletin de la Direction de santé publique de Montréal-Centre publié
avec la collaboration de l’Association des médecins omnipraticiens de
Montréal dans le cadre du programme Prévention en pratique médicale
coordonné par le docteur Jean Cloutier.
Ce numéro est une réalisation de l’unité Écologie humaine et sociale.
Responsable de l’unité : Francine Trickey
Rédacteur en chef : D
r
Jean Cloutier
Édition : Yves Laplante, Deborah Bonney
Infographie : Julie Milette
Rédactrice : D
re
Mireille Lajoie
Collaboratrice : D
re
Monique Letellier
Consultants : D
re
Louise Charbonneau, D
re
Suzanne De Blois,
D
re
Manon Duchesne, Gilles Forget, D
re
Marie-José Legault
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1M3
Téléphone : (514) 528-2400
Courriel :
Dépôt légal – 3
e
trimestre 2003
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1481-3734
Numéro de convention : 40005583
• La contraception d'urgence
Contraception orale d'urgence — peut réduire de 60 % les avortements.
-Prescrire — lévonorgestrel —
(Plan B
MC
) pour plusieurs fois à toutes
les adolescentes. Assure une disponibillité immédiate et épargne les
frais de consultation du pharmacien. Les deux comprimés
(Plan B
MC
)
ont la même efficacité pris en même temps qu'à 12 heures d'intervalle.
- Fournir des informations sur les circonstances d'utilisation (relations
non protégées, bris de condom, oubli de CO), le moment de la prise
du médicament et sur le niveau d'efficacité selon le temps écoulé.
Stérilet cuivré post coïtal
- Informer l'adolescente de cette possibilité en cas de besoin si elle
n'a pas utilisé de COU (3 à 7 jours après une relation).
•
La double contraception : le meilleur choix à cet âge (condom plus
contraception prolongée); à recommander absolument lors de toute relation
occasionnelle ou sans engagement à long terme (moins de 3 mois).
Le condom devrait être systématiquement encouragé auprès des garçons
dans toutes leurs relations sexuelles s'ils n'ont pas de désir de paternité —
facilement démontrée par un test d'ADN. Seule certitude pour eux de
diminuer les risques de grossesse sans avoir à être certain que la jeune
fille utilise déjà ou adéquatement ses moyens de contraception. Aussi un
moyen de protection contre les ITS et le Sida.
•
La contraception prolongée : penser au Depo-Provera lorsque plusieurs
facteurs de risque sont présents, notamment face à une adolescente
ambivalente, très jeune ou immature psychologiquement. Le manque de
fidélité (compliance) aux contraceptifs oraux est alors fréquent. Prévoir
un système de rappel peut s’avérer essentiel. D'autres alternatives pour-
raient être intéressantes dans un avenir prochain : implants, timbres, et
même le stérilet dans certaines conditions.
•
Solution de rechange : si l'activité sexuelle diminue, par exemple à la
fin d'une relation ou lorsqu'il y a seulement des relations sporadiques, la
CO — comme le Dépo-Provera — est souvent délaissée. Rappelez-lui
d'utiliser condom et COU
(Plan B
MC
) mais que cette méthode n’est pas
une substitution à une contraception prolongée.
•
Suivi périodique adapté aux besoins de l'adolescente et de l'adolescent.
Privilégier des rencontres avec le couple lorsque pertinent et possible.
Comment évaluer les troubles musculosquelettiques (TMS) reliés au travail ?
Les troubles musculosqueletti-
ques (TMS) représentent de 10 à
12 % des raisons de consultation
médicale en première ligne. Ils
constituent la cause principale
d’incapacité dans la population
québécoise et 55 % des TMS se-
raient reliés au travail. Les TMS
sont considérés comme reliés au
travail lorsque l’environnement de
travail et les exigences de la tâche
sont, parmi les différents facteurs
possibles, ceux qui contribuent de
façon prépondérante à la lésion.
Rôle du médecin face au travailleur
Le rôle du médecin, face à un
travailleur qui consulte pour un
TMS, ne concerne pas unique-
ment les aspects diagnostiques
et thérapeutiques mais aussi les
aspects préventifs. L’histoire pro-
fessionnelle est l’élément clé de
la démarche clinique d’évalua-
tion. Elle permet de recueillir des
informations sur les divers fac-
teurs de risque et d’en apprécier
l’importance dans le dévelop-
pement d’un TMS. Elle permet
également de savoir si d’autres
travailleurs sont exposés aux
1
S e p t e m b r e 2 0 0 6
1
révention
en pratique médicale
mêmes facteurs de risque de
façon à situer l’importance d’un
problème dans une entreprise.
Les connaissances acquises sur
les exigences du travail pendant
l’évaluation clinique seront égale-
ment utiles lors du retour au tra-
vail an de prévenir une rechute
ou une aggravation d’un TMS.
Le médecin doit également être
familier avec les différents as-
pects touchant l’indemnisation,
la prise en charge et le suivi des
travailleurs qui acheminent une
réclamation à la Commission de
la santé et sécurité du travail du
Québec (CSST).
Démarche d’évaluation médicale et histoire professionnelle
La démarche d’évaluation comprend trois étapes principales :
1. Évaluation de l’atteinte musculosquelettique
a. Établir le diagnostic
b. Documenter le mode d’apparition des symptômes
c. Revoir les antécédents médicaux et traumatiques
2. Identification des facteurs de risque professionnels et non professionnels et documentation de
l’importance de ces expositions
3. Formulation de l’opinion médicale concernant l’influence des facteurs de risque sur l’atteinte
musculosquelettique
L’histoire professionnelle est le meilleur outil pour dépister les TMS et les prévenir
Ce questionnaire de dépistage peut vous aider à évaluer tout travailleur :
≈Que faites-vous comme travail?
≈Votre travail nécessite-t-il :
Le maintien de postures inconfortables?
L’exécution d’efforts musculaires soutenus?
La répétition des mêmes mouvements?
≈Croyez vous que vos problèmes de santé sont reliés au travail?
≈Vos symptômes sont-ils différents au travail ou à la maison?
•
•
2
P r é v e n t i o n e n p r a t i q u e m é d i c a l e , S e p t e m b r e 2 0 0 6
1
E n c a r t d a n s « P r é v e n t i o n e n p r a t i q u e m é d i c a l e , S e p t e m b r e 2 0 0 6 »
A
Étapes de la démarche d’évaluation d’un TMS
Tableau 1 Principaux facteurs de risque professionnels associés aux TMS
1. ÉVALUATION DE L’ATTEINTE MUSCULOSQUELETTIQUE
A. ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic doit être le plus spécique possible. Il devrait, à tout le moins, préciser les structures atteintes,
le type de tissu, la localisation anatomique (ex : tendinite de la coiffe des rotateurs). Il est préférable d’éviter
des termes peu précis (ex. tendinite du bras) ou se référant au mécanisme lésionnel (ex. lésions attribuables
au travail répétitif).
B. DOCUMENTER LE MODE D’APPARITION DES SYMPTÔMES
La documentation des circonstances entourant le début des symptômes (subit ou progressif) et l’apprécia-
tion des divers facteurs qui déclenchent, accentuent ou soulagent la symptomatologie sont des éléments
clés à considérer. Les TMS liés à une hypersollicitation s’installent habituellement de façon progressive. Il
faut porter une attention particulière aux impacts fonctionnels pouvant découler d’un TMS aussi bien dans
les activités professionnelles que dans celles de la vie courante. Ces informations permettent d’apprécier la
sévérité d’une atteinte et d’établir des éléments de comparaison dans le suivi du patient.
C. REVOIR LES ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET TRAUMATIQUES
La nature multifactorielle des TMS impose de considérer les antécédents traumatiques, les maladies sys-
témiques et certains troubles inammatoires ou métaboliques ayant pu contribuer à leur développement.
Toutefois, la présence de conditions de santé particulières n’exclut pas une relation avec les activités de
travail mais risque d’augmenter la vulnérabilité des structures musculosquelettiques lorsqu’elles sont sou-
mises à des sollicitations.
2. IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUE ET DOCUMENTER L’IMPORTANCE DE
L’EXPOSITION.
L’identication des activités sollicitantes, aussi bien récréatives que professionnelles, devrait être faite pour
tout travailleur qui consulte pour un TMS.
A. ACTIVITÉS HORS TRAVAIL
Les activités sportives, récréatives ou domestiques peuvent être impliquées dans l’apparition d’un TMS. Il
importe donc de documenter l’intensité de la pratique de ces activités et de s’informer si elles sont accom-
pagnées d’une symptomatologie spécique.
B. ACTIVITÉS DE TRAVAIL
Les facteurs de risque correspondent à des conditions associées aux exigences de la tâche et du milieu de
travail. Ils peuvent être directement responsables de l’apparition d’un TMS ou agir comme éléments dé-
clencheurs. Le risque de développer un TMS augmente en fonction du nombre et de l’intensité des facteurs
de risque ainsi que de la durée de l’exposition. (Tableau 1)
Facteurs biomécaniques
force / effort
posture
répétitivité
temps de récupération
Facteurs physiques
vibrations
pressions locales
chocs / impacts
Facteur thermique
froid
•
•
•
•
•
•
•
•
Facteurs organisationnels
répartition du temps de travail
modes d’exécution du travail
cadence de production
modes de rémunération
Facteurs psychosociaux
perception de stress élevé ou de sur-
charge
rythme de travail rapide
exigences de production élevées
travail monotone
manque de soutien au travail
faible satisfaction au travail
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Approche thérapeutique et prise en charge
L’approche thérapeutique d’un travailleur atteint d’un TMS vise la reprise des activités socioprofessionnelles
le plus précocement possible et ce, dans les meilleures conditions.
De façon générale, la pierre angulaire du traitement repose sur le contrôle de la douleur et la diminution
des sollicitations tant au niveau professionnel que personnel. La récupération de la fonction doit se faire
en trois étapes :
la restauration de la flexibilité
le renforcement progressif des structures
l’amélioration de l’endurance.
Dans certains cas, l’apparition d’un syndrome douloureux viendra affecter la prise en charge. Une telle évo-
lution peut empêcher une reprise précoce du travail et conduire à une stratégie individuelle d’évitement (fear
avoidance). Ce type de comportement se caractérise par une stratégie d’anticipation face à toute situation
physique et psychologique qui pourrait provoquer une douleur. La reconnaissance précoce de ce phénomène
est essentielle dans la prise en charge d’un travailleur présentant un syndrome douloureux.
•
•
•
3. FORMULATION DE L’OPINION MÉDICALE CONCERNANT L’INFLUENCE DES
FACTEURS DE RISQUE SUR L’ATTEINTE MUSCULOSQUELETTIQUE
La formulation d’une opinion médicale sur les facteurs étiologiques devrait faire partie de l’évaluation d’un
travailleur qui consulte pour un TMS pouvant être relié au travail. Elle vise à cerner la contribution du
travail dans le développement ou l’aggravation d’un TMS, et non à déterminer l’admissibilité à un système
d’indemnisation. La formulation de l’opinion doit être basée sur l’histoire professionnelle, la documentation
de la symptomatologie et l’identification des différents facteurs de risque. Étant donné la nature multifac-
torielle des TMS, la formulation d’une opinion sur l’association entre un TMS et le travail doit s’exprimer
davantage en termes de probabilité plutôt que de certitude.
Histoire professionnelle
Le titre d’emploi est habituellement peu représentatif du travail effectué et
des risques auxquels le travailleur est exposé.
Il importe donc de questionner davantage le travailleur sur ses tâches, les
outils qu’il utilise et les postures qu’il adopte pour faire son travail.
On peut lui demander, de mimer au besoin, les gestes qu’il fait. Même si
l’évaluation des risques faite lors de la consultation clinique est de nature
qualitative et subjective, elle permet, dans bien des cas, de recueillir suf-
samment d’informations pour que le médecin puisse se faire une bonne
représentation du niveau de sollicitation subi par les structures atteintes.
Étapes de la démarche d’évaluation d’un TMS
1
P r é v e n t i o n e n p r a t i q u e m é d i c a l e , S e p t e m b r e 2 0 0 6
3
Un bulletin de la Direction de santé publique
de Montréal publié avec la collaboration de
l’ Association des médecins omnipraticiens de Montréal
dans le cadre du programme Prévention en pratique
médicale, Volet Information.
Ce numéro est une réalisation du secteur
Services préventifs en milieux cliniques
Auteurs : Dr Louis Patry, Dre Martine Baillargeon
Responsable du secteur : Dr Jacques Durocher
Édition : Élisabeth Pérès
Infographie : Javier Valdés
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)
H2L 1M3
Téléphone : (514) 528-2400
courriel:
ISSN (version imprimée) : 1481-3734
ISSN (version en ligne) : 1712-2937
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2006
Bibliothèque et Archives du Canada, 2006
Numéro de convention : 40005583
révention
en pratique médicale
Association
des Médecins
Omnipraticiens
de Montréal
4
P r é v e n t i o n e n p r a t i q u e m é d i c a l e , S e p t e m b r e 2 0 0 6
Réintégration au travail et limitations fonctionnelles
La réintégration peut nécessiter une
évaluation des contraintes profes-
sionnelles afin de s’assurer que les
exigences de la tâche correspondent
aux capacités du travailleur. Dans
certains cas, il peut être nécessaire
de suggérer certaines modifications
au poste de travail ou des moda-
lités favorisant une réintégration
progressive au travail.
Lorsque des limitations fonction-
nelles sont émises, il importe qu’el-
les correspondent aux incapaci-
tés spécifiques du travailleur. Les
recommandations transmises à la
Ressources : Réseau publique des services de santé au travail
Médecins responsables en santé au travail
1. CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord ( anciennement CLSC Montréal-Nord)
75, rue de Port-Royal Est, bureau 430
Montréal, (Québec) H3L 3T1
Tél:514- 858-2471 FAX: 858-6568
2. CSSS Jeanne-Mance (anciennement CLSC des Faubourgs)
2260, rue Parthenais
Montréal, (Québec) H2K 3T5
Tél: 514-527-4072 FAX: 527-9770
3. CSSS de la Montagne (anciennement CLSC Côte-des-Neiges
)
5700 chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal, (Québec) H3T 2A8
Tél: 514-731-1386 FAX: 739-8132
4. CSSS de l’Ouest-de-l’île ( anciennement CLSC Lac Saint-Louis)
180 avenue Cartier
Pointe-Claire, (Québec) H9S 4S1
Tél: 514- 697-4111 FAX: 697 0647
5. CSSS de la Pointe-de-l’île ( anciennement CLSC Pointe-aux-Trembles / Montréal Est)
13,926 rue Notre-Dame Est
Montréal, (Québec) H1A 1T5
Tél:514- 642-2121 FAX: 642-1684
Clinique en santé au travail
Clinique interuniversitaire de santé au travail et de santé environnementale
3650 rue St-Urbain Montréal H2X 2P4
Tél : 514 934-1934 poste 32622
Internet
Institut National de recherche et de sécurité (INRS France)
/>National Institut of Occupational and Safety Health (NIOSH)
/>•
•
direction d’une entreprise, doivent
être claires et concises et ne pas faire
référence au diagnostic ou à toute
autre information médicale. Elles
doivent tenir compte, selon le cas,
des limites de charge à soulever,
des amplitudes articulaires à ne pas
dépasser, de la fréquence des mou-
vements ou de la durée maximale
du maintien d’une posture.
Les recommandations générales et
imprécises, du type « peut faire un
travail léger » sont une source de
confusion et doivent être évitées.
Approche préventive lors
de l’évaluation d’un tra-
vailleur
L’évaluation d’un travailleur
consultant pour un TMS consti-
tue une excellente occasion pour
un médecin de s’interroger sur
l’ampleur du problème dans une
entreprise et de suggérer la mise
en place de programmes de préven-
tion. Ces programmes ont pour but
la diminution du niveau de risque,
la surveillance et le dépistage des
travailleurs symptomatiques avant
qu’ils ne développent une lésion sur
le plan clinique.
Références :
/>
mdprevention/index.html
1
E n c a r t d a n s « P r é v e n t i o n e n p r a t i q u e m é d i c a l e , S e p t e m b r e 2 0 0 6 »
A
Questionnaire détaillé
Troubles musculosquelettiques
1. Emploi actuel ou le plus récent
Quel est votre emploi actuel? _________________________________________________________
Dans quel type d’entreprise? __________________________________________________________
Depuis combien de temps faites-vous ce travail? _________________________________________
Nombre de jours / semaine? ___________________________________________________________
Quels sont vos principaux outils de travail ? _____________________________________________
Quelle est votre principale posture de travail ? ___________________________________________
Devez-vous maintenir une posture : ____________________________________________________
° avec la tête ou le dos incliné? ______________________________________________________
° avec les bras ou les mains loin du corps? ____________________________________________
Manipulez-vous des objets ou outils au-dessus de vos épaules ou loin du corps? _______________
Effectuez-vous des mouvements répétés avec les bras ou les mains? __________________________
° en connaissez-vous la fréquence? __________________________________________________
Manipulez-vous des charges? _________________________________________________________
° en connaissez-vous le poids? ______________________________________________________
° combien d’heures par jour? _______________________________________________________
Indiquez, parmi les tâches que vous faites, celles que vous trouvez les plus difficiles : ___________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Y a-t-il eu des changements récemment dans votre travail (poste, tâche, outils)? _______________
Utilisez-vous des outils vibrants ou à percussion? ________________________________________
Travaillez-vous en ambiance froide? ___________________________________________________
Travaillez-vous sous contrainte de temps? _______________________________________________
Avez-vous des quotas de production? __________________________________________________
2. Emplois antérieurs (s’il y a lieu)
Énumérez vos emplois antérieurs en commençant par le plus récent : ________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’histoire professionnelle d’un travailleur peut se faire en deux étapes, à l’aide :
d’un questionnaire de dépistage pour évaluer tout travailleur qui consulte pour un TMS;
d’un questionnaire détaillé lorsqu’il y a suspicion d’un TMS associé au travail. Ce questionnaire peut
être complété, en grande partie, par le travailleur lui-même.
•
•
Que faites-vous comme travail?
Votre travail nécessite-t-il :
- Le maintien de postures inconfortables?
- L’exécution d’efforts musculaires soutenus?
- La répétition des mêmes mouvements?
Croyez vous que vos problèmes de santé sont reliés au travail?
Vos symptômes sont-ils différents au travail ou à la maison?
•
•
•
•
Questionnaire de dépistage
révention
en pratique médicale